Il faisait beau cet après-midi sur le port du Guilvinec. Les bateaux de pêche rentraient, lourds encore des dernières caisses de langoustines, et la vedette orange des sauveteurs oscillait mollement à son poste d’amarrage. J’étais au bar des Brisants, la lumière dorée se reflétait sur les verres, et dans le murmure des conversations montait, sur l’écran de mon téléphone, la voix d’un journaliste anglais parlant d’Enoch Powell. Cinquante-sept ans après son discours de Birmingham, l’ombre du tribun hante encore les îles britanniques, comme si sa parole n’avait jamais cessé de couver sous la cendre.
L’article du Times sous la plume de Dominic Sandbrook rappelait les mots de ce député érudit, classique, tragique, qui cita Virgile pour annoncer que le fleuve Tibre écumerait de sang. Cette image, d’une beauté violente, valut à Powell d’être chassé du temple parlementaire et d’entrer dans la légende des damnés. En Grande-Bretagne, il demeure l’exemple même de celui qui a vu, et que l’on a puni d’avoir vu. On le traite de raciste, de dément, de romantique égaré, pourtant, à relire ses phrases aujourd’hui, on n’y trouve ni haine ni mépris, mais une inquiétude presque métaphysique : que devient une civilisation lorsqu’elle cesse d’aimer sa propre forme ?
La France, aujourd’hui, répond à cette question sans le savoir. Ses banlieues, que les ministres visitent en gilet pare-balles, sont devenues le laboratoire de cette mutation silencieuse qu’il avait pressentie. Powell n’était pas un prophète de malheur, il était un lecteur d’Homère. Comme l’a évoqué Ortega y Gasset, « l’homme moderne ne sait plus ce qu’il est, parce qu’il a oublié d’où il vient ». L’Angleterre de 1968 et la France de 2025 ont ceci en commun : elles ont cessé de se percevoir comme des patries, et se rêvent comme des parkings d’humanité. On ne leur demande plus d’engendrer, mais d’accueillir, non plus d’enseigner, mais de tolérer.
Je songe souvent à cette phrase de Carl Schmitt : « Est souverain celui qui décide de l’exception. » Or nos démocraties ont cessé d’être souveraines, précisément parce qu’elles refusent toute exception. Le réel, pour elles, n’est plus qu’un scandale. Celui qui décrit ce qu’il voit, un quartier où les visages ont changé, une langue qui s’efface, devient aussitôt un suspect. Powell fut l’un des premiers à comprendre que la liberté de dire n’est pas un luxe, mais l’ultime barrière avant la dissolution.
À cette heure, sur le plan incliné devant le bar, un marin nettoie sa coque au jet d’eau. Le bruit régulier du moteur du compresseur couvre les rires du comptoir. Tout paraît tranquille, et pourtant le pays, sous cette lumière limpide, glisse lentement vers une forme d’amnésie heureuse. En France, on n’a pas eu de Powell, non parce que nous sommes plus sages, mais parce que nous avons tué nos prophètes avant qu’ils parlent. Ceux qui osent dire que la France devient méconnaissable sont réduits au silence par des rires convenus, comme si l’évidence était obscène.
Powell disait qu’« il est des temps où ne pas parler serait la plus grande des trahisons ». Il avait raison, et son malheur fut d’avoir vécu dans un siècle où la lucidité était déjà un délit. J’aimerais croire que les Anglais sauront encore se souvenir de lui autrement qu’en repoussoir. Chez nous, il n’en resterait même pas le nom ; la mémoire française, saturée d’absolutions et d’excuses, ne conserve que les coupables qu’elle invente.
Il faut le dire, la France ne manque pas d’hommes clairvoyants. Simplement, elle les exile à domicile. Les voix de ceux qui pressentaient l’effondrement, Alain de Benoist, Guillaume Faye, Renaud Camus, furent marginalisées non pour leurs erreurs, mais pour leurs précisions. Comme Powell, ils ont nommé ce que la société refusait de voir. Faye parlait d’« archéofuturisme » comme d’un sursaut vital, une manière de concilier la mémoire et la puissance, la racine et la technique. Camus, dans un style plus douloureux, évoqua le « Grand Remplacement » non comme une thèse politique, mais comme une intuition poétique, celle d’un écrivain voyant s’éteindre le paysage de son enfance. De Benoist, quant à lui, je l’ai entendu dire que l’Europe ne mourrait pas d’un déficit de moraline, mais d’un excès de peur.
Le drame n’est pas que ces hommes aient eu raison trop tôt, c’est que leur parole soit devenue inaudible. Dans un pays qui préfère la liturgie de la tolérance à la rigueur de la vérité, toute observation devient offense. La France d’aujourd’hui, saturée de sermons moraux, vit dans la crainte perpétuelle de la phrase de trop. L’époque n’interdit pas les idées, elle interdit les nuances. Dire qu’un quartier change, qu’un peuple s’inquiète, qu’une langue recule, c’est déjà franchir la ligne invisible qui sépare le dicible du répréhensible. La liberté d’expression n’y est plus un droit, mais une tolérance conditionnelle, soumise au bon vouloir de l’émotion dominante.
C’est là, sans doute, la victoire posthume de la morale sur la pensée. Enoch Powell parlait encore en homme antique, conscient que la parole est un acte. Nous parlons, nous, comme des comptables de communication. Chaque mot est pesé, neutralisé, vidé de sa sève. Il ne reste que la liturgie molle des “valeurs républicaines”, ces formules où l’on enferme la peur du réel sous des rubans tricolores. Carl Schmitt l’avait pensé : quand les nations cessent de nommer leurs ennemis, elles perdent la faculté de se défendre.
Dans cette asphyxie du verbe, le destin de Powell et celui des intellectuels dissidents français se rejoignent. On leur reproche non pas d’avoir eu tort, mais d’avoir eu du style. L’époque ne tolère plus les phrases qui blessent, elle réclame des slogans qui rassurent. Ce qui fut jadis le sel de la politique, la parole vive, la dispute, la prophétie, est remplacé par un sabir d’administration, un langage aseptisé où le vrai disparaît dans la crainte du scandale.
Au bar des Brisants, un rayon de soleil vient frapper le zinc. On entend la radio locale annoncer une « opération de sécurisation » dans un quartier périphérique. L’expression, déjà, hésite entre l’hygiénique et le militaire. Tout est dans le choix du mot. Enoch Powell, Faye, Camus ou de Benoist savaient que le destin des peuples se joue aussi dans la manière de dire les choses. Quand les mots se corrompent, les réalités se dérobent.
En quittant le bar, je me suis rendu sur le cordon lunaire qui sépare Lechiagat de l’Atlantique. La mer s’est retirée un peu plus loin, laissant sur la vase les traces d’un ancien ordre. Peut-être qu’un jour, dans un avenir plus lucide, on relira ces voix bannies comme on relit les oracles. Non pour y chercher la haine, mais pour y retrouver la noblesse d’un langage qui voulait encore sauver le monde en le nommant.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
`Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



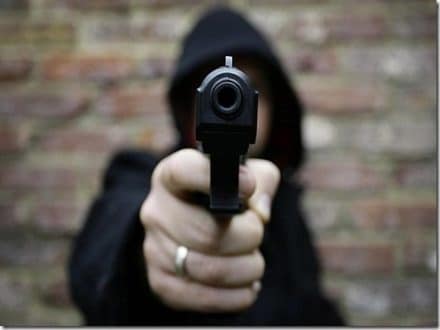

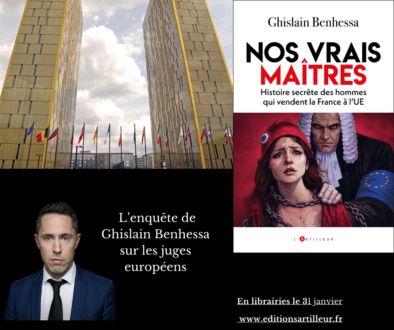








6 réponses à “Enoch Powell. Le silence des prophètes”
On parlait peu d’Enoch lorsque j’étais gamin car on lisait peu d’article dans Ouest Torchon mais le problème c’est que sur photos lorsqu’ils apparaissait lui et son épouse eh bien on le voyait avec son épouse faire le salut nazi et 20 ans après la guerre cela ne passait pas. Nous sommes chez nous nous gardons nos héros et à l’ouest nos héros bretons!
« Discours des fleuves de sang » fascicule d’Enoch Powell dans lequel, tel un visionnaire, il prévient des dangers de l’immigration extra-européenne …
Vision ô combien prophétique qui à présent se réalise dans l’indifférence et soumission quasi générale !!!!
Merci, M Katz de l’avoir rappelé !
Il n’est jamais bon d’avoir raison trop tôt .
Juste hommage à Enoch Powell. L’histoire du Royaume-Uni aurait sans doute été différente si le Parti conservateur, au lieu d’exclure Powell, avait reconnu la justesse de ses vues. Powell se trompait cependant quand il décrivait les « fleuves de sang », même sous forme allégorique, à travers une citation latine. Son discours évoquait plus ou moins une guerre civile à un horizon relativement proche, il ne pensait apparemment pas que la submersion constatée dans des localités comme Wolverhampton pourrait se généraliser à tout le pays.
@NEVEU Raymond : je ne vois pas à quelles photos vous faites allusion et je ne parviens pas à en trouver la moindre trace en ligne. ChatGPT non plus. Powell s’est engagé dans l’armée britannique en 1939 et dans son discours de Birmingham lui-même fait allusion à la montée du nazisme comme à un danger. Par ailleurs, Pamela Powell n’a jamais participé publiquement à l’action politique de son mari. Vous devez confondre avec quelqu’un d’autre.
« En France, on n’ a pas eu de Powell ». dites vous. Mais nous avons eu un Jean-Marie Le Pen !
Erick dit: En 1968 je passais mon bac puis travaillais quelques mois avant d’aller accomplir mon service militaire (quinze mois). Certes j’avais vaguement entendu citer le nom d’Enoch Powell, sans doute sur deux radios encore sérieuses: RTL et Europe n° 1, mais sans y prêter attention. A vingt ans j’avais d’autres chats à fouter… ou courtiser. Merci Monsieur Katz de m’enseigner ce que j’ignorais à l’époque. Dommage que je réside à 580 km du bar des Brisants car votre prose est toujours si agréable à lire que je serai bien passer vous saluer. Merci encore