En rentrant à pied du bar des Brisants, à la pointe de Lechiagat, à une encablure de la maison où était née ma mère en 1923, je me disais qu’il fut un temps où l’Américain naissait avec deux certitudes : la liberté et le plein d’essence. Aujourd’hui, il n’a plus les moyens de payer ni l’une ni l’autre. On découvre, stupéfaits, mais point surpris, qu’outre-Atlantique, les ménages cessent de rembourser leurs prêts automobiles. C’est un détail d’apparence comptable, un de ces signaux faibles qui annoncent les effondrements de civilisation : l’Américain moyen, celui des highways et des drive-in, n’a plus de voiture. Ou plutôt, il n’a plus de voiture à lui.
Les chiffres publiés par The Telegraph feraient pâlir un courtier de Wall Street : 1,7 million de véhicules saisis l’an dernier, des défauts de paiement à un niveau jamais vu depuis la crise de 2008, et des banques paniquées devant la faillite en chaîne des sociétés de crédit auto. Jadis, on perdait sa maison, aujourd’hui on perd son pick-up. Le rêve américain tient désormais dans un abonnement Uber.
On oublie souvent que l’Amérique fut bâtie sur la roue, non sur la pierre. Son espace, sa mythologie, sa liberté se sont toujours confondus avec le moteur à combustion. L’homme libre s’y mesure à la cylindrée. Dans les années cinquante, la Ford représentait ce que la charrette était pour nos paysans bretons : l’extension naturelle de l’homme, son attelage existentiel. Aujourd’hui, c’est devenu un luxe, presque une vanité de riche. Le prix moyen d’une voiture neuve a dépassé les 50 000 dollars. Pour un salarié de la classe moyenne, cela signifie un paiement mensuel de 761 dollars, soit l’équivalent du loyer d’un studio à Houston. Et encore, sans assurance ni carburant.
Les Américains découvrent le coût de leur liberté mécanique comme un fumeur découvre sa facture de tabac après vingt ans d’habitude. Le pays des « freeways » s’avance vers l’ère des trottoirs. Ceux qui se moquaient jadis de l’Europe des trains et des vélos devront bientôt pédaler pour aller travailler. Dans les plaines de l’Iowa, on verra sans doute renaître le marcheur biblique, celui qui ne peut plus se permettre le diesel.
Les banques, elles, feignent la stupeur. Le président de Goldman Sachs prévient que « ce ne sera pas joli à voir ». On se croirait revenu aux sermons de 2008, où chaque financier jouait les Cassandre après avoir prêté à n’importe qui. Le comble est atteint lorsque Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, évoque « un cafard visible qui annonce les autres ». Belle formule : Wall Street, temple du capitalisme mondialisé, infesté de cafards.
Le plus cocasse est ailleurs. Les experts découvrent avec gravité que les mauvais payeurs appartiennent désormais à la classe moyenne, diplômée, employée, connectée. Autrement dit, ceux qui incarnent la réussite américaine. Ces cadres de 75 000 dollars par an, jadis prospères, paient leurs courses à crédit et leurs dettes avec d’autres dettes. L’Amérique, cette usine à mythes, fabrique désormais du prolétariat blanc sous climatisation.
Il faut dire que tout conspire contre eux : l’inflation, la hausse des taux, et ce nouvel ordre moral de la consommation, où l’on doit rouler électrique sans savoir comment la recharger. Le « rêve vert » de Washington condamne à pied ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une Tesla. L’écologie, version américaine, a le même effet que le puritanisme : elle prive les pauvres de plaisir.
Je songeais, en lisant ces chiffres, à ces mots inspirés par Oswald Spengler : « Les civilisations meurent non de pauvreté, mais d’épuisement intérieur. » L’Amérique n’est pas pauvre, elle est épuisée. Elle vit à crédit depuis un demi-siècle, sur la foi de son passé héroïque et de ses illusions technologiques. Quand la voiture s’en va, c’est le mythe qui cale.
Sous Donald Trump, le pays se rêve encore en atelier du monde, alors qu’il est devenu un grand concessionnaire d’illusions. On y vend du crédit, non des biens ; de la dette, non de la richesse. Et les mêmes banquiers qui ont transformé les maisons en « produits dérivés » transforment aujourd’hui les voitures en titres boursiers. Les Américains roulent à vide, littéralement : ils conduisent des véhicules dont la valeur est inférieure à la dette qu’ils traînent derrière eux.
Il y a quelque chose de tragique dans cette fin de cycle : le cow-boy moderne marche. Le pays des routes infinies redécouvre la poussière. À force de prêcher la mobilité, il a perdu le mouvement. Peut-être y a-t-il là une justice immanente, une ironie du destin : ce peuple qui a conquis le continent au pas de moteur devra, pour le reconquérir, apprendre à marcher.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : Wikipedia (cc)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



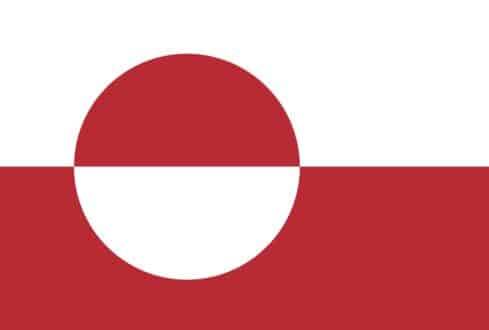

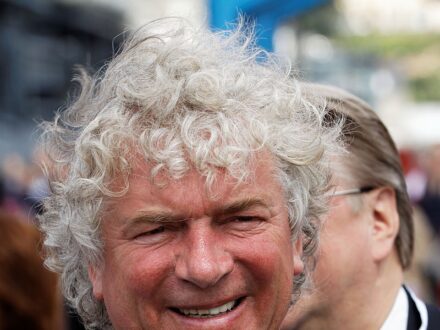








3 réponses à “Le rêve américain marche désormais à pied”
Le Telegraph fait un peu de sensationnalisme, et vous rebondissez sur son article pour en faire bien plus encore ! Notamment, affirmer que « les mauvais payeurs appartiennent désormais à la classe moyenne, diplômée, employée, connectée » est, disons, un petit ajout. L’envolée du taux d’impayés en matière de crédit automobile est un fait depuis deux ou trois ans aux Etats-Unis mais n’a pas la signification générale que vous lui donnez. D’abord, les défauts sont surtout dus aux emprunteurs « subprime » (pauvres). Les causes en sont une hausse du taux de chômage mais aussi une augmentation du prix des automobiles, et aussi les pratiques de sociétés de crédit peu exigeantes. Le nombre de voitures circulant aux Etats-Unis a augmenté d’environ 10% en dix ans. Comme tous les ménages aisés avaient déjà deux voitures, les acheteurs supplémentaires sont probablement des gens moins aisés, donc plus vulnérables. Les autres types de crédits, prêts étudiants et crédits sur carte notamment, donnent lieu aussi à des impayés plus nombreux. C’est la rançon de la prospérité. Elle comporte de grands risques de crise économique générale, c’est sûr, mais le mécanisme n’est pas celui que vous décrivez.
Je ne résiste pas au plaisir de rappeler que depuis « Ni Marx ni Jésus » on nous annonce régulièrement l’effondrement de l’ économie nord-américaine. En attendant, les dit-américains ont un multimilliardaire à leur tête et nous un multi endetté. Kenavo er werh all…
Avant d’affirmer que les américains sont à genoux, suivez le lien :
https://www.flibs.com/en/home.html
Ils semblent avoir encore de la ressource.