Il y avait, chez Tchéky Karyo, ce mélange de douceur et de fureur, d’intelligence et de rage contenue, qui en faisait un acteur à part dans le cinéma français — un visage de granit taillé dans la mélancolie. L’œil perçant, la mâchoire serrée, la voix feutrée mais grave : tout en lui respirait le paradoxe d’un homme à la fois tendre et dangereux. Né Baruh Djaki Karyo à Istanbul en 1953, il est mort le 31 octobre 2025 en Bretagne, des suites d’un cancer. Il avait 72 ans.
Du théâtre au polar : l’art de l’ambiguïté
Avant de se forger une carrière de cinéma, Karyo venait du théâtre — du dur, du vrai, celui du Théâtre national de Strasbourg. Il y apprit la discipline du plateau, la tension de la parole juste. De là, il garda toujours cette façon de jouer les silences, les regards, les pauses plus fortes que les mots.
En 1982, Bob Swaim lui offre La Balance. Le film, âpre et urbain, le révèle au grand public et lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Ce premier rôle d’homme violent mais vulnérable donne le ton : Karyo sera de ces acteurs qu’on reconnaît à la rugosité de leur humanité.
Puis viennent les années d’or : L’Ours (Jean-Jacques Annaud, 1988) et Nikita (Luc Besson, 1990). Dans le premier, il incarne un chasseur hanté par la culpabilité, dans le second, un mentor d’une froide élégance, figure paternelle d’un monde de tueurs. Ces deux films font de lui un visage familier, presque mythologique, du cinéma français de la fin du XXᵉ siècle. Derrière la brutalité, une tendresse invisible — celle d’un homme qui comprend trop bien la fragilité humaine pour la juger.
L’international sans trahir la France
Polyglotte accompli, Karyo tourne ensuite aux quatre coins du monde : 1492 : Christophe Colomb de Ridley Scott, GoldenEye, Bad Boys, Crying Freeman, The Patriot aux côtés de Mel Gibson… Hollywood le réclame pour ses visages de méchants, de militaires, de flics ambigus. Pourtant, il garde toujours cette retenue européenne, ce jeu intériorisé qui rend ses rôles crédibles jusque dans la démesure.
Dans le même temps, il continue de servir le cinéma d’auteur français : Rohmer (Les Nuits de la pleine lune), Annaud, Jeunet (Un long dimanche de fiançailles), Marchal (Les Lyonnais). Chez lui, les genres ne s’excluent pas : on pouvait le retrouver un mois dans un blockbuster américain, et le mois suivant dans un film intimiste tourné en Bretagne ou en Italie.
Ce qui frappait chez lui, c’était cette manière de ne jamais tricher. Dans Dobermann, il campe un flic dopé à la violence, caricatural et terrifiant, mais jamais ridicule. Dans Belle et Sébastien, il devient César, montagnard bourru et paternel, figure d’une France rurale qu’il rendait soudain bouleversante de vérité. Dans Kaamelott, son passage furtif suffit à rappeler qu’il pouvait imposer le silence sans hausser le ton.
Sa voix — grave, fêlée, posée — était celle d’un homme qui avait vu beaucoup, mais refusait le cynisme. Dans ses dernières interviews, il évoquait souvent l’art comme une façon d’« aller vers le meilleur de soi-même ».
Karyo, c’était aussi le musicien — deux albums (Ce lien qui nous unit, Crédo), écrits avec Zéno Bianu et Jean Fauque, entre poésie et blues. Sa carrière de chanteur, discrète mais sincère, prolongeait cette recherche d’harmonie entre la colère et la douceur.
Dans les dernières années, les Britanniques l’avaient redécouvert dans The Missing et Baptiste, où il jouait un inspecteur vieillissant, hanté par les disparus. Un rôle qui lui allait comme un gant : un homme qui cherche, obstinément, ce qui se perd.
Tchéky Karyo s’en va, laissant derrière lui une œuvre immense, plus de 80 films, une centaine de rôles au théâtre et à la télévision. Mais au-delà des titres, il laisse surtout une empreinte — celle d’un comédien qui n’a jamais cédé à la facilité, d’un homme qui a choisi la profondeur plutôt que la lumière.
Sous ses airs de dur, il y avait un poète. Sous sa voix de roc, un cœur sensible. Et dans chaque regard qu’il posait à l’écran, la promesse d’un mystère que seul le grand cinéma sait encore contenir.
YV
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



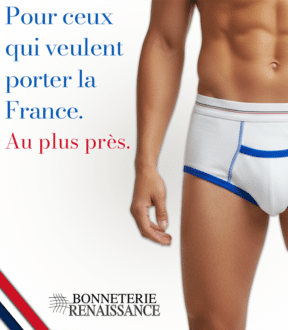











4 réponses à “Hommage à Tchéky Karyo : le feu sous la glace”
Bel éloge
merci
J’ai eu l’occasion de le croiser c’étais un homme simple, discret et d’une gentillesse.
Merci pour se très bel article qui nous fait revivre un instant de partage avec l’acteur. Cela me fait penser à l’ouvrage d’Anne Brassié « Brasilliach ou encore un instant de bonheur ». Je suis au fil des pages retourné dans l’univers de Brasilliach, de Notre avant-guerre, de ce fascisme romantique qui m’avait toujours enchanté.
Quel grand acteur qui embrasait l ‘écran !