On les appelle les twice-exceptional, ou « deux fois exceptionnels » : des enfants à haut potentiel… mais porteurs en même temps d’un trouble, d’un handicap ou d’une difficulté d’apprentissage. Longtemps ignoré, ce profil atypique fait aujourd’hui l’objet d’une recherche universitaire croissante, notamment aux États-Unis. Une récente publication académique, signée par les chercheurs Steven Pfeiffer, Farnaz Mehdipour Maralani et Renata Muniz Prado, vient rappeler combien ces élèves restent encore largement invisibles dans les systèmes éducatifs classiques.
Le paradoxe est connu : ces enfants brillent parfois dans un domaine tout en échouant dans un autre. Ils ont une mémoire prodigieuse mais peinent à lire. Un raisonnement mathématique hors norme mais une attention volatile. Une créativité fulgurante mais un trouble anxieux sévère. Cette combinaison déroute enseignants et familles, au point que les difficultés peuvent masquer le talent — et inversement. Résultat : beaucoup passent sous les radars, orientés à tort vers des dispositifs inadaptés ou laissés sans soutien concret.
L’étude, qui synthétise près d’un siècle de travaux depuis les premières observations de Leta Hollingworth dans les années 1920, décrit un constat net : faute de formation, de moyens et d’outils adaptés, les écoles identifient trop tard, ou mal, ces élèves « à double visage ». Les chercheurs appellent à des approches globales, fondées sur les forces autant que sur les fragilités, et à une meilleure coopération entre psychiatres, psychologues et enseignants.
Un phénomène largement sous-estimé
Malgré un intérêt scientifique croissant, aucune donnée internationale stable n’existe sur la proportion exacte d’élèves deux fois exceptionnels. Les estimations oscillent entre 2 et 14 % des enfants à haut potentiel, selon les critères retenus et les pays. Beaucoup échappent à toute identification, notamment dans les milieux populaires ou dans les minorités culturelles où les comportements atypiques sont souvent interprétés autrement.
Le problème, expliquent les auteurs, tient d’abord à la définition même de la « douance ». Selon les modèles retenus (intelligence analytique, créativité, intelligence pratique, talents spécifiques, etc.), un enfant peut être considéré comme « surdoué » dans une école, mais pas dans une autre. À cette diversité s’ajoute le flou entourant les troubles associés : TDAH, dyslexie, troubles anxieux, TSA, difficultés sensorielles… Chaque profil crée une configuration unique, difficile à saisir avec les outils standardisés de l’éducation nationale.
Le cœur du problème est ce que les spécialistes appellent le double masquage.
Deux cas de figure :
- Le talent masque la difficulté :
L’enfant réussit tant bien que mal grâce à ses ressources cognitives supérieures, ce qui retarde le diagnostic. Mais sa réussite repose sur un effort invisible et épuisant, qui finit souvent en effondrement scolaire ou en anxiété sévère à l’adolescence. - La difficulté masque le talent :
L’élève passe pour « lent », « perturbateur », « rêveur » ou « incapable de se concentrer ». Ses capacités, pourtant bien réelles, ne se révèlent jamais faute de conditions adaptées. Il est orienté vers le soutien plutôt que vers l’enrichissement.
Dans les deux cas, conclut l’étude, le résultat est le même : un immense gâchis, psychologique autant que scolaire.
Les auteurs soulignent le rôle crucial des enseignants dans l’identification de ces profils. Pourtant, les formations universitaires — en France comme ailleurs — abordent très peu la question du haut potentiel, et encore moins celle de la double exceptionnalité. L’étude relève :
- une confusion fréquente entre comportements liés aux troubles et comportements liés à la douance ;
- une difficulté à interpréter les signaux faibles ;
- un recours excessif aux tests de QI, jugés insuffisants seuls pour repérer ces élèves.
Les chercheurs appellent à intégrer dans la formation initiale des modules dédiés à la différenciation pédagogique et au repérage précoce des troubles neurodéveloppementaux chez les élèves brillants.
L’importance d’un accompagnement précoce
L’étude rappelle un point essentiel : plus l’intervention est précoce, meilleurs sont les résultats.
Attendre l’échec scolaire pour intervenir revient à laisser s’installer :
- perte d’estime de soi,
- troubles anxieux,
- refus scolaire,
- comportements oppositionnels,
- isolement social.
Il faut donc des évaluations plus fines, plus complètes et surtout plus régulières, capables de tenir compte :
- des talents,
- des fragilités,
- de l’environnement familial,
- du contexte culturel,
- des conditions matérielles de l’élève.
L’objectif : éviter que l’école devienne un lieu d’échec pour ces enfants qui, paradoxalement, ont souvent un potentiel exceptionnel de réussite.
Dans leur conclusion, Pfeiffer et ses collègues appellent à un changement global de perspective. Selon eux, l’erreur consiste à vouloir faire entrer ces élèves dans des cases qui n’ont jamais été conçues pour eux. Il faut au contraire adapter les systèmes éducatifs :
- pédagogies flexibles,
- programmes enrichis mais sécurisants,
- soutien psychologique structuré,
- interventions fondées sur les forces de l’élève,
- technologies éducatives adaptées,
- collaboration étroite entre école, famille et professionnels de santé.
À l’heure où beaucoup d’enfants surdoués souffrent d’incompréhension ou d’errance diagnostique, l’étude le rappelle avec force : la double exceptionnalité n’est pas un caprice, ni un luxe intellectuel — c’est une réalité scientifique qui exige une réponse éducative claire et efficace.
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine






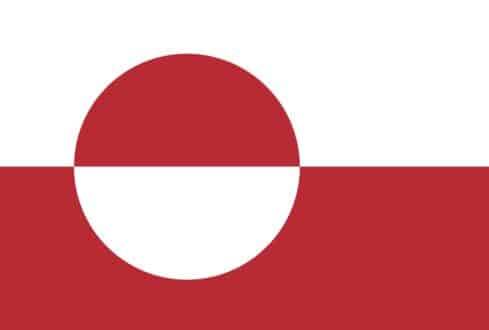







4 réponses à “Éducation : ces élèves « deux fois exceptionnels » que l’école française ne voit pas”
Oh, je rigole !
J’ai travaillé longtemps dans un établissement accueillant des élèves soi-disant précoces ou surdoués ou HP (haut potentiel).
La plupart avaient des parents qui pensaient avoir fabriqué un génie ! Les gamins portés aux nues faisaient « chier » les instituteurs qui orientaient, pour avoir la paix, les parents vers un orthophoniste. Ce dernier, business oblige, déclarait l’enfant surdoué !
Or presque tous ces enfants étaient nuls en réflexion, esprit critique, déduction. De plus, ces enfants étaient méprisants envers ceux qu’ils considéraient comme des brêles !
De la 6ème à la terminale j’ai rencontré un seul enfant extrêmement brillant, rapide et respectueux des autres élèves moins doués.
J’avais convoqué les parents pour parler de leur enfant : ils ne voulaient pas dire devant lui qu’il était surdoué et voulait qu’il soit dans des classes normales. Ils avaient bien raison !
l’école est un rouleau compresseur, la massification, écrase tout ce qui sort de l’épure.
Demandez aux enseignants, leur boulot n’est pas de repérer les talents. Pas le temps, trop compliqué !
Le surmesure est impossible dans le Système actuel. Et puis les classes sont tellement hétérogènes
le fléau du collège unique……
Ras le bol de l’invasion de ces termes de nature anglaise et pour ce qui est de ces études évidemment yankees ça déborde…Ce n’est qu’une peuplade de gros porcs imbéciles qui pille le monde entier pour trouver des cerveaux mais chez eux que de cases de vide et de courants d’air n’est-ce pas Trumpette?
Oh comme il a mille fois raisons Rycart! Et ces parents sont les mêmes qui roulent en bicyclettes et trottinettes, ne respectent rien, les partisans de l’escrologie!