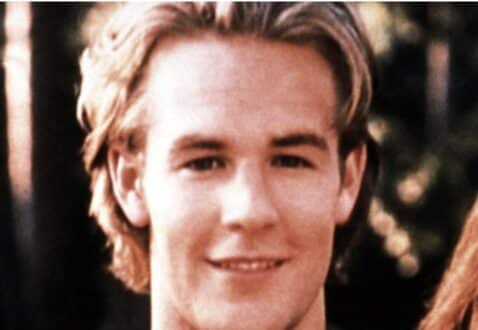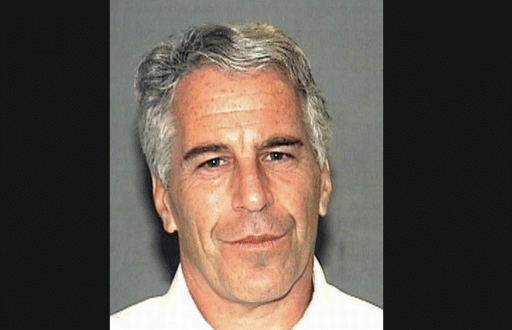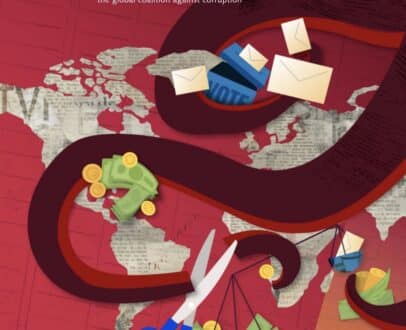Dans les arcanes feutrés du Vatican, le conclave demeure l’un des rites les plus mystérieux de l’Église catholique. Pourtant, c’est une œuvre de fiction, le film Conclave de Roland Joffé, qui a récemment capté l’imaginaire collectif, au point d’influencer la perception de cet événement sacré. Adapté du roman de Robert Harris, ce thriller politique dépeint une élection papale empreinte de tensions, de manœuvres et de secrets, loin de la solennité que l’on pourrait attendre.
Il convient de s’arrêter un instant sur l’objet esthétique et idéologique que constitue le film Conclave, réalisé par Edward Berger. Ce dernier, non content de mettre en scène les arcanes du Vatican avec un sens du clair-obscur hérité du Caravage, orchestre un huis clos tendu, peuplé de cardinaux plus madrés que spirituels, dans une scénographie savamment dramatisée. Il ne s’agit pas ici d’un documentaire, encore moins d’un exercice de piété cinématographique, mais bien d’un thriller politique où la pourpre cardinalice prend parfois les teintes du sang symbolique. Ralph Fiennes, campant un doyen scrupuleux, y donne la réplique à Stanley Tucci, incarnation du machiavélisme ecclésiastique. De l’intrigue, chacun retient le parfum de soufre plus que l’encens.
Il ne faut cependant pas s’y tromper : si la reconstitution est soignée, la mécanique dramatique surplombe la rigueur canonique. Le film, en effet, tord les règles précises du conclave avec la complaisance d’un romancier désireux d’ajouter de l’huile sur le feu de la spéculation. Intrigues de sacristie, manipulations feutrées, messes basses entre factions rivales – tout y est pour flatter l’imaginaire moderne, toujours prompt à voir dans l’Église une république de conspirateurs. Ainsi façonnée, l’image du conclave s’éloigne du silence liturgique pour épouser la dramaturgie télévisuelle. En cela, Conclave agit comme un simulacre, au sens où l’entendait Baudrillard : non une représentation du réel, mais sa substitution pure.
La dernière audace du film, à savoir la révélation que le cardinal élu, dans un ultime coup de théâtre, serait une personne intersexuée, relève moins du commentaire théologique que de l’effet de manche. Cette pirouette scénaristique, qui fit couler beaucoup d’encre dans les gazettes de gauche comme de droite, prétend introduire dans le saint des saints le ferment dissolvant de l’époque. Cela n’est pas sans rappeler la remarque d’Ernst Jünger sur le nihilisme qui, tel un ver dans le fruit, se loge dans les structures les plus anciennes pour les faire éclater de l’intérieur. Il faut alors se demander non pas ce que l’Église dit encore au monde, mais ce que le monde exige qu’elle devienne.
C’est une chose d’assister à la solennité liturgique d’une messe papale depuis les travées de Saint-Pierre ; c’en est une autre que d’être enfermé, plusieurs jours durant, sous les fresques du Jugement dernier, cerné par la mémoire du martyre et la pesanteur des siècles.
Le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster, dans une confidence rare pour un homme de sa réserve, a tenu à rectifier cette vision romancée devant un parterre de séminaristes. Participant au conclave qui a élu le pape Léon XIV, il a décrit une atmosphère « fraternelle », marquée par la patience et la prière, bien éloignée des intrigues hollywoodiennes. « À aucun moment je n’ai ressenti la moindre rancune ou tentative de promotion personnelle », a-t-il affirmé, soulignant le contraste avec la représentation cinématographique.
Le cardinal Nichols a ensuite évoqué l’exactitude des gestes, la lenteur imposée du cérémonial, les silences calculés — presque géométriques — avaient pour vertu première de désarmer l’agitation intérieure. Il ne s’agissait plus d’élire un homme, mais de consentir au mystère. « Chaque mouvement du protocole, disait-il, semblait vouloir suspendre le temps, pour que le vote ne jaillisse pas de la précipitation mais d’un discernement mûri dans l’obéissance à l’Esprit. »
La patience, loin d’être une résignation, y devenait discipline. Chaque cardinal, en procession solitaire, portait à l’autel non pas un simple nom griffonné sur un billet, mais une part de la continuité apostolique. On parlait peu. Ce mutisme n’était ni gêne ni froideur : il était condition d’une fraternité souterraine, d’un commun retour à l’essentiel. Ce que le film Conclave trahit par excès de verbe et d’intrigues, Nichols le résume en un mot anglais d’une simplicité désarmante : waiting, attente. Il ne s’agit pas seulement d’attendre un résultat, mais de s’attendre soi-même, pour que le choix ne soit pas celui d’un homme seul, mais de l’Église dans sa conscience la plus profonde.
À l’écart du vacarme mondain, le conclave se donne ainsi pour école lente. Le cardinal britannique, peu suspect d’effusion mystique, décrit une atmosphère presque monastique, où les rites empêchaient la brutalité du débat et, plus encore, les séductions du pouvoir. Nul ne s’érigeait en favori, nul ne courtisait l’encens. Ce n’était pas un scrutin de pouvoir, mais un rite de passage. Et s’il fallait un antidote à l’image falsifiée du conclave véhiculée par les fictions modernes, ce serait cette leçon de lenteur et de retenue : dans l’Église, on ne conquiert pas le trône de Pierre, on y est élevé comme à contretemps, à l’issue d’un cheminement où l’âme s’est laissée polir par le silence.
Pourtant, l’influence du film ne s’est pas arrêtée aux portes du Vatican. Le nouveau pape lui-même, Robert Francis Prevost, a admis avoir visionné Conclave avant le début du processus électoral. Une anecdote qui illustre comment la fiction peut s’immiscer dans la réalité, même au sein des institutions les plus traditionnelles.
Ce phénomène n’est pas isolé. Dans une société où les images façonnent les opinions, la frontière entre réalité et représentation devient floue. Les œuvres de fiction, en particulier celles qui abordent des sujets religieux ou politiques, ont le pouvoir de modeler notre compréhension du monde. Elles peuvent éclairer, mais aussi déformer, selon la perspective adoptée.
Il est donc essentiel de conserver un esprit critique face à ces représentations. Si Conclave offre une plongée captivante dans les coulisses du Vatican, il ne doit pas être pris pour un documentaire fidèle. La réalité, souvent plus nuancée et moins spectaculaire, mérite d’être appréhendée avec discernement.
En fin de compte, le véritable conclave, avec ses silences, ses prières et ses délibérations, reste un mystère que même le cinéma ne peut entièrement percer.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —