Dans son dernier ouvrage Polémos, notre père (à commander ici), Aristide Leucate entreprend une relecture radicale de la guerre, non comme une aberration, mais comme une constante anthropologique et civilisationnelle. À rebours du pacifisme contemporain, il convoque Héraclite, Schmitt, Clausewitz ou encore Jünger pour rappeler que la guerre, loin d’être une pathologie, structure l’histoire, le politique et l’ordre social. Dans cet entretien, l’essayiste livre une réflexion sans concession sur la conflictualité humaine, la faillite du pacifisme moderne et le désarmement mental des sociétés occidentales.
Nous l’avons interrogé ci-dessous.
Breizh-info.com : Vous affirmez dès le titre que Polémos est notre père. En quoi la guerre, loin d’être une pathologie, serait-elle selon vous une condition fondamentale, presque matricielle, de l’humanité ?
Aristide Leucate : Aussi loin que l’on a pu remonter dans le temps, notamment à l’ère préhistorique, il a été attesté que la guerre est un phénomène aussi ancien que l’humanité. La guerre est l’apanage de l’homme depuis l’affrontement de Caïn et Abel jusqu’à nos guerres de drones. En ce sens, elle est fondatrice de toute civilisation qui en est issue ou qui a péri par elle.
Breizh-info.com : Vous soutenez que la guerre est un phénomène anthropologique incontournable, au même titre que la naissance, la mort ou l’amour. Est-ce un constat tragique ou une réalité vitale ?
Aristide Leucate : C’est un constat et la dimension tragique fait partie de ce constat. Le tragique est au cœur de la vie humaine et, la guerre étant une activité typiquement humaine, il est quasi tautologique d’affirmer que la guerre est tragique par essence. Lorsque, aux premiers balbutiements de la guerre en Ukraine, les commentateurs télévisés et autres experts de plateaux ont cru faire preuve de profondeur spirituelle en proclamant « le retour du tragique », ils ont, tout bonnement, sombré dans la banalité la plus sotte. La vie et la guerre sont intrinsèquement liées et, en ce sens, le tragique n’est rien de moins qu’une ontologie.
Breizh-info.com : Peut-on dire que le pacifisme moderne, notamment issu des Lumières ou du progressisme contemporain, relève d’une illusion métaphysique ? Est-il un déni de l’histoire ?
Aristide Leucate : Le pacifisme de manière générale, pas seulement moderne, relève de l’idéologie, c’est-à-dire d’une reconstruction du réel à partir de principes décrétés in abstracto. Vous avez raison de dire que le pacifisme est une illusion dans la mesure où il part du postulat non vérifié que la paix serait le contraire de la guerre voir l’état normal de toute société. Or, guerre et paix doivent être entendues comme deux moments alternatifs, de durée plus ou moins longue et qui sont en réalité les deux faces d’une même médaille. Toute guerre ne peut déboucher que sur une paix et toute paix est porteuse d’une (prochaine) guerre. Garder constamment à l’esprit cette tension dialectique permettrait d’éviter de funestes erreurs de jugement. Ce que nous vivons en Europe occidentale depuis 80 ans ne signifie pas que nous avons gagné la paix perpétuelle. L’ensauvagement structurel endémique de nos sociétés postmodernes, la « libanisation » territoriale du pays, l’apport régulier de populations allochtones sur notre sol sont autant de facteurs polémogènes qui annoncent de futurs conflits sanglants.
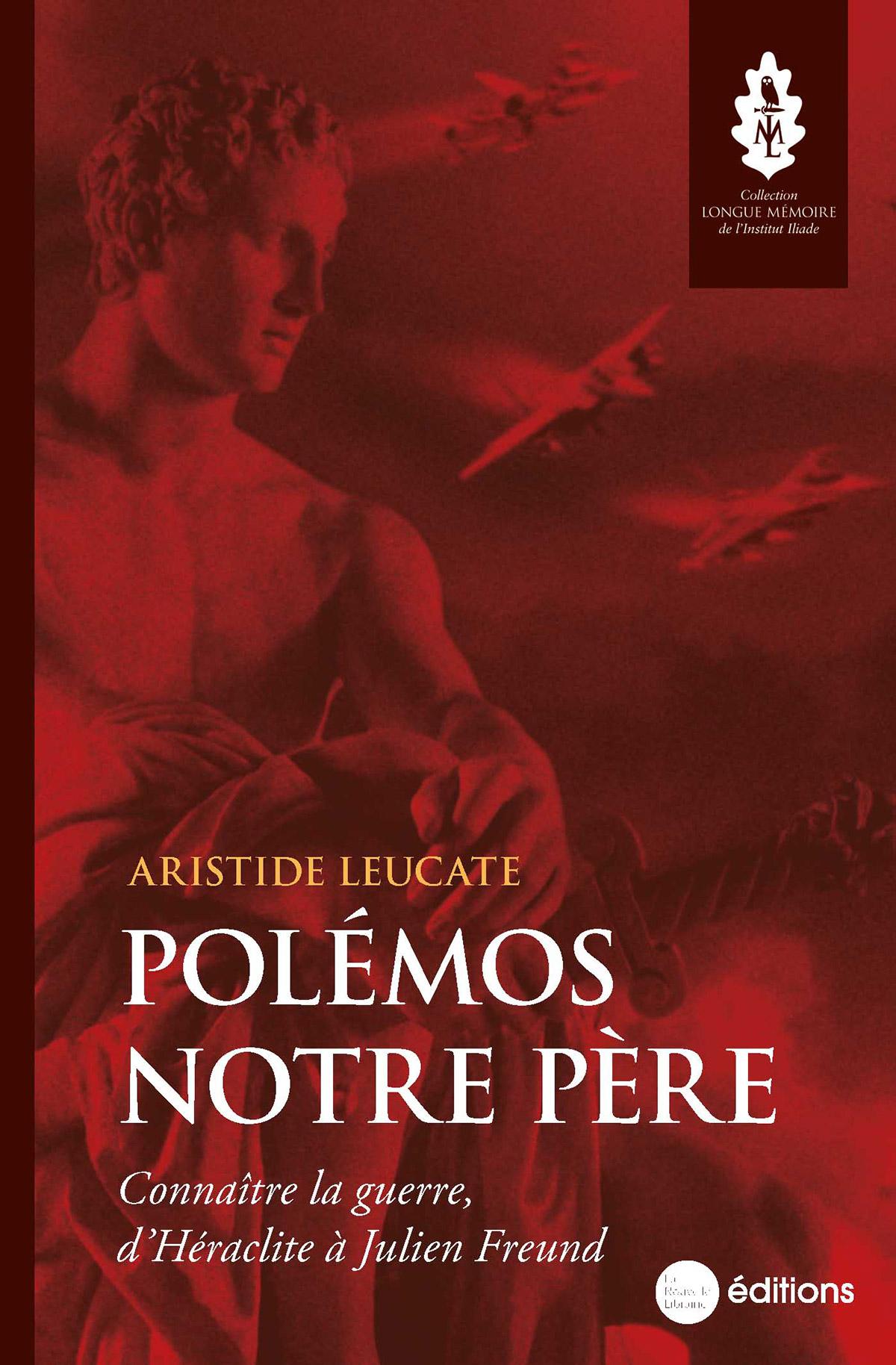
Breizh-info.com : Vous convoquez Héraclite et sa célèbre formule : « Le combat est père de toute chose ». Pourquoi cet aphorisme vous semble-t-il encore plus pertinent aujourd’hui qu’à l’époque présocratique ?
Aristide Leucate : Héraclite, l’ensemble des présocratiques, tout comme ceux qui sont venus à leur suite sont, pour reprendre une expression de l’helléniste Olivier Battistini, nos plus extrêmes contemporains dans la mesure où ils n’ont jamais cessé de se montrer toujours plus résolument actuels. Polémos est omniprésent, hier, aujourd’hui et demain est nul ne pourra extirper cette réalité enracinée, comme je l’ai déjà dit, au plus profond du cœur de l’homme.
Breizh-info.com : Loin de glorifier la guerre, vous semblez vouloir en rappeler la nécessité comme moteur de l’ordre et de la justice. Comment articulez-vous cette idée avec les notions de guerre juste ou de violence légitime ?
Aristide Leucate : Guerre juste, légitime défense, violence légitime sont autant de formes, parmi d’autres, que peut prendre la guerre, auxquelles l’on peut ajouter les guerres de partisans, les guerres irrégulières, la subversion, la propagande, etc. C’est dire encore que la guerre est un phénomène incoercible dont les manifestations sont multiples et variées.
Breizh-info.com : Vous faites un parallèle entre guerre et accouchement civilisationnel. L’Histoire — de Rome à l’Europe moderne — serait-elle impensable sans la guerre ?
Aristide Leucate : Absolument. Rome, sans la conquête du Latium, sans les Horaces les Curiaces, sans les guerres samnites, puniques, carthaginoises, etc. n’aurait pas été Rome. L’Histoire est indissociable de la guerre. D’ailleurs, lorsque l’on consulte des ouvrages d’histoire de la guerre il est frappant de constater qu’ils se présentent avant tout comme des ouvrages d’histoire tout court.
Breizh-info.com : Vous rappelez que toute société humaine s’est organisée autour de la distinction entre amis et ennemis. Est-ce une manière de réhabiliter Carl Schmitt dans le débat contemporain ?
La distinction de l’ami et de l’ennemi est, selon Carl Schmitt, le critère de reconnaissance du politique. Plus précisément, il symbolise le degré d’union ou de désunion d’une société politique. Carl Schmitt a énoncé une loi d’airain du politique que reprendra plus tard Julien Freund qui s’attachera, lui, à dégager son essence. En m’appuyant sur Schmitt, je m’emploie à citer un auteur incontournable en la matière. Ceux qui n’y font pas référence, par ignorance ou dénégation idéologique a priori, ne peuvent sérieusement parler du phénomène « guerre ».
Breizh-info.com : L’industrialisation de la guerre au XXe siècle a-t-elle fait perdre son sens héroïque à l’acte guerrier ? La guerre moderne est-elle devenue honteuse, désincarnée ?
Aristide Leucate : La lecture d’un auteur comme Ernst Jünger témoigne, au contraire, que la technicisation de l’art de la guerre, n’a pas définitivement enterré le héros guerrier. Si la guerre est devenue « honteuse » est-ce parce qu’elle fut criminalisée dès la fin du premier conflit mondial. Les Européens tournaient le dos à la grande tradition westphalienne qui structurait les relations diplomatiques depuis la fin de la Guerre de Trente ans et reprise, mutatis mutandis, au Congrès de Vienne de 1814-1815. Ce faisant, l’on a artificiellement dissocié la guerre de la politique, grande leçon clausewitzienne congédiée au bénéfice exclusif du Droit. Le désaveu de la guerre, s’il va de pair avec une certaine féminisation de la société occidentale, un amollissement des mœurs et une accoutumance au confort matériel, dénote, surtout, une méconnaissance profonde de l’histoire, savamment entretenue par notre système (dés)éducatif. La guerre est devenue monstrueuse parce qu’elle fait peur ; on la craint parce qu’on s’est déshabitué à vivre avec elle (tout comme d’avec la mort, d’ailleurs, reléguée aux portes des grandes villes, voire, effacée par crémation). Dans la Grèce antique, les cités se faisaient perpétuellement la guerre entre elles et l’on savait que toute paix serait rapidement emportée par la prochaine guerre qui ne tardait pas à arriver.
Breizh-info.com : Vous évoquez un monde où « toute guerre est potentiellement à la portée de n’importe quel groupe organisé ». Voyez-vous dans cette mutation une forme de retour archaïque ou une innovation radicale ?
Aristide Leucate : Il ne faut pas confondre la guerre avec les autres expressions de la violence que peuvent être, par exemple, le crime crapuleux, le meurtre de masse ou la fièvre révolutionnaire. Ce que je remarque, c’est un ensauvagement de la société où s’installe une violence omniprésente susceptible potentiellement, en effet, de faire basculer tout groupe un tant soit peu organisé dans une logique belliciste dirigée contre les institutions. La nébuleuse des Blacks Blocs que l’on retrouve souvent depuis quelques années en marge de manifestations syndicales ou autres doit nous mettre la puce à l’oreille. L’on pourrait très bien imaginer également l’hybridation de ces mouvements à d’autres groupes ou groupuscules – islamiques par exemple – dont la synergie pourrait déboucher sur une certaine déstabilisation sociale et politique. La porosité des frontières, l’Internet et sa kyrielle de réseaux sociaux, la cryptomonnaie, la capacité offerte au premier venu de fabriquer des engins explosifs, tout cela concourt à ne plus faire de la guerre l’apanage exclusif de l’Etat et des militaires. Si l’Etat détient toujours le monopole de la violence légitime – bien qu’utilisée parfois illégitimement, comme l’a montré l’épisode des Gilets jaunes –, force est d’admettre qu’il est concurrencé sur ses marges.
Breizh-info.com : Vous mobilisez les travaux de Jean Haudry sur les sociétés indo-européennes et la fonction guerrière. Quelle pertinence conservent ces structures tripartites aujourd’hui dans des sociétés désenchantées ?
Aristide Leucate : Les inestimables travaux de Jean Haudry s’inscrivent dans ceux, pionniers, de Georges Dumézil, lequel n’a jamais prétendu travailler sur autre chose que de la matière morte – un « cadavre », disait-il. Aussi, serait-il bien audacieux, sinon peut-être présomptueux – voire prétentieux – de s’acharner à chercher ce qui demeure de l’idéologie tripartie dans les sociétés actuelles. S’en tenant étroitement aux limites de son domaine de minutieuse et infatigable recherche, il s’est toujours refusé à énoncer la moindre extrapolation « paralinguistique » ou « para-mythologique » qui eût eu pour effet de fragiliser ses travaux. Sous cette expresse réserve émise par Dumézil lui-même, il n’est pas interdit, toutefois, de méditer sur ou à côté de l’œuvre, tant celle-ci semble ouvrir de fructueuses pistes de réflexions d’ordre anthropologique notamment. De la sorte, est-il permis d’explorer, tout au moins philosophiquement, les voies d’une intériorisation authentique de l’héritage indo-européen. En l’occurrence, pour ce qui concerne notre domaine, la guerre, l’idéologie tripartie offre une grille de lecture structurale des plus pertinentes pour interpréter nos temps actuels. Cette conception trifonctionnelle du monde que l’on croyait disparue depuis plus de deux cents ans, semble à nouveau émerger en tant que fait révélateur d’une nouvelle vision du monde symétriquement inverse à celle découverte par Georges Dumézil. C’est ainsi, alors, que l’on constate une capitis diminutio de la première fonction (politico-juridico-religieuse ou de souveraineté), une évaporation de la deuxième (fonction guerrière) et une hypertrophie singulière de la troisième (fonction de production et de reproduction). Ainsi, la violence, naguère monopole de l’autorité légitime encadrée par le droit, s’est éparpillée au point de s’insinuer dans toutes les strates de la société (violences intrafamiliales, dans la rue, à l’école, au bureau…), jusqu’à investir quantitativement la troisième fonction au point de la dénaturer qualitativement.
Breizh-info.com : Clausewitz disait : « La guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens ». Mais aujourd’hui, où la guerre devient souvent l’expression de l’absence de politique, ce lien est-il rompu ?
Aristide Leucate : Nos « élites » dirigeantes masquent leur impéritie derrière un jusqu’au-boutisme belliciste qu’on ne leur aurait pas soupçonné il y a encore quelques années. Précisément, la guerre russo-ukrainienne leur a été apportée comme sur un plateau et c’est fort opportunément qu’ils s’en sont saisis. Leur ardeur à vouloir en découdre dans les bureaux feutrés des palais républicains ou sur les plateaux de télévision fait tomber les masques ou, plutôt, les exhibe sous leur vrai visage de Polichinelle. C’est ainsi que nous avons affaire à de grands enfants totalement incultes, qui jouent à la guerre pour se faire peur et tenir les populations sous le joug continuel de la sidération et de la propagande. Les discours inconséquents de Macron, du chancelier allemand ou du Premier ministre britannique devraient soulever les peuples de leurs pays respectifs de colère et d’indignation. Clémenceau, à qui on attribue cette célèbre formule selon laquelle « la guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires », reverrait sans nul doute son jugement devant le pitoyable spectacle de nos apprentis politiciens.
Breizh-info.com : Peut-on encore espérer un monde sans guerre, ou faut-il simplement réapprendre à penser la guerre comme un outil structurant du politique et du réel ?
Aristide Leucate : Un monde sans guerre serait un monde sans vie. Supprimer la guerre reviendrait donc à supprimer la vie, projet totalitaire s’il en est. Affirmer cette évidence n’équivaut pas à une profession de foi en faveur de la guerre. L’instinct de conservation nous pousse irrésistiblement à préserver et à protéger notre existence et celle de nos proches. La guerre étant une ultima ratio politique, on ne peut l’aimer pour elle-même, seule la prudence politique devant nous la faire accepter en dernière instance. Ainsi, il ne sert strictement à rien de se dépenser en rhétoriques pacifistes creuses, dans la mesure où si une guerre doit survenir, après épuisement de toutes les voies diplomatiques imaginables, celle-ci devra s’accomplir et durer le moins de temps possible. Il ne faut jamais oublier la dimension proprement politique de la guerre. On ne saurait trop recommander à nos dirigeants de se plonger urgemment dans les réflexions de Machiavel et de Julien Freund.
Propos recueillis par YV
Crédit photos : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine





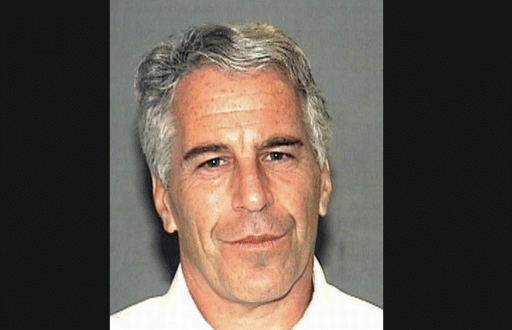


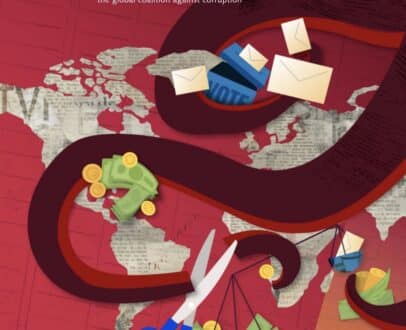





2 réponses à “Aristide Leucate (Polémos, notre père) : « La guerre est un phénomène aussi ancien que l’humanité » [Interview]”
Plutôt que de convoquer Jünger, Haudry ou même Dumézil et Héraclite,il vaut mieux lire ce que les ethnologues et anthropologues ayant vécu au sein de tribus dont les cultures étaient très archaïques en Nouvelle-Guinée, en Amazonie ou en Australie, ont écrit au sujet des moeurs de ces tribus. Tous ont constaté que la guerre y était omniprésente. De même, de nombreux archéologues ont trouvé des preuves de conflits très meurtriers ayant eu lieu au Paléolithique. La guerre n’est certainement pas « notre Père » mais c’est une réalité incontestable; nos cousins les chimpanzés font eux aussi très fréquemment la guerre et les fourmis qui portent leur drapeau sur elles sous forme d’une odeur, font la guerre aux étrangères qui s’égarent à proximité de leur colonie. Tous les animaux sociaux sont territoriaux et les chimpanzés veillent attentivement au respect des frontières. La quasi totalité des scientifiques concernés admettent que la guerre et la territorialité sont des faits humains depuis extrêmement longtemps, probablement de puis des millions d’années. Ceci dit, ce qui ni Jünger, ni Haudry, ni Dumézil, ni Héraclite ne nous ont appris, bien au contraire, c’est que l’espèce humaine n’est pas une espèce hiérarchique. La quasi totalité des travaux des anthropologues montrent que les sociétés pré-néolithiques n’étaient pas hiérarchisées, y compris celles qui ont été visitées au cours du siècle passé. Une minorité d’individus à l’esprit dominateur a toujours essayé d’imposer sa loi aux autres mais ils étaient éliminés comme a pu le constater l’anthropologue Christopher Boehm qui a vécu chez les Bochimans. Depuis le Néolithique,ces personnages dominateurs, égoïstes et manipulateurs que sont les psychopathes, ont réussi progressivement à s’imposer en utilisant divers moyens, dont les religions et la coercition, mais ils ont toujours été contesté; ainsi,l’empire chinois a connu 250 grandes rébellions en 2000 ans soit une tous les 8 ans en moyenne. Ce fut partout la même chose et ce n’est pas fini! Donc,oui,la guerre est une donnée anthropologique incontestable mais cela n’implique pas de la vouloir ou de la souhaiter. L’anthropologie confirme donc la nature guerrière et territoriale de l’humanité, par contre elle réduit à néant toutes les théories conservatrices ou réactionnaires qui font de la hiérarchie une donnée naturelle; ces théories sont totalement fausses.L’être humain est un être social et profondément coopératif; c’est une donnée essentielle de l’anthropologie, de l’éthologie, de la biologie évolutive….Le comportement guerrier et le comportement coopératif et partageur de la plupart des humains (ces anormaux que sont les psychopathes étant mis à part) sont les deux faces d’une même réalité humaine. C’est pour être forts envers les étrangers que les humains sont coopératifs et partageurs avec les membres de leurs groupes respectifs. Les « chefs », dans les sociétés pré-néolithiques n’avaient que très peu de pouvoir et ne bénéficiaient d’aucun avantage; ils avaient un certain prestige, parce que leurs compétences étaient mises à profit par le groupe, mais ils étaient ridiculisés dès qu’ils se comportaient de manière dominatrice. Le fait que les oligarques de nos sociétés modernes soient détestés par une très grande majorité de nos contemporains traduit le fait que les humains n’aiment pas les inégalités trop marquées. Nick Hanauer, un milliardaire californien, a prévenu ses collègues : »Profitez en bien car cela ne va pas durer ! ».
Synthèse du texte fournie par l’I.A : Le texte soutient que la guerre est une réalité anthropologique ancienne, observée chez les sociétés archaïques (Nouvelle-Guinée, Amazonie, Australie), au Paléolithique, et même chez des animaux sociaux comme les chimpanzés et les fourmis. Territorialité et conflits sont des traits humains remontant à des millions d’années. Cependant, contrairement aux idées conservatrices, l’humanité n’est pas naturellement hiérarchique. Les sociétés pré-néolithiques étaient égalitaires, rejetant les individus dominateurs, comme l’a montré Christopher Boehm chez les Bochimans. Depuis le Néolithique, des figures manipulatrices (« psychopathes ») ont imposé des hiérarchies via la religion et la coercition, mais ces structures ont toujours été contestées, comme en témoignent les rébellions historiques (par exemple, en Chine). L’humain est fondamentalement coopératif et social, sa propension à la guerre étant liée à la défense du groupe. Les inégalités modernes, détestées par la majorité, reflètent cette aversion pour les hiérarchies excessives, comme l’illustre l’avertissement du milliardaire Nick Hanauer. En somme, l’anthropologie confirme la nature guerrière et territoriale de l’humain, mais infirme l’idée d’une hiérarchie naturelle, mettant en avant sa tendance à la coopération.