Depuis qu’Internet a fait sauter les digues de l’ancien écosystème médiatique, le flux d’informations ne descend plus d’un sommet vers la base ; il se propage latéralement dans un brouhaha permanent où chaque smartphone devient tour à tour haut-parleur, caisse de résonance et arme de poing. Dans cette mêlée numérique, Martin Gurri, ancien analyste au service « Open Source » de la CIA, propose une boussole originale : le concept de post-journalisme. La vidéo que nous présentons aujourd’hui offre l’une de ses interventions les plus claires et, sans doute, les plus dérangeantes pour tous ceux qui tiennent encore au vieux mythe de l’objectivité.
Un ex-espion face au chaos médiatique
Pendant deux décennies, Gurri a passé les flux d’agences, de journaux et – déjà – de blogs au crible des renseignements américains. Il en a tiré une conviction : la crise de confiance qui frappe les médias ne s’explique pas seulement par des erreurs ou des “fake news”, mais par une transformation tectonique du marché de l’information. Là où, hier, quelques rédactions contrôlaient la conversation publique, surgissent aujourd’hui des milliards de producteurs d’opinions. Le résultat n’est pas plus de diversité, mais une tribalisation des esprits : chacun parle, nul n’écoute.
Pour illustrer ce basculement, Gurri dissèque la trajectoire du New York Times. Autrefois journal de référence courtisant un large spectre de lecteurs, la “vieille dame grise” s’est muée, selon lui, en pure start-up identitaire : elle ne vend plus de l’information, mais la confirmation d’une vision du monde partagée par un public cible. Le pari est commercialement gagnant : les abonnements explosent, la ligne éditoriale se radicalise, l’idéologie devient produit. Gurri y voit le modèle économique d’un âge post-journalistique, où l’algorithme remplace le rédacteur en chef : ce qui compte n’est plus la véracité d’un scoop, mais sa capacité à flatter l’ego d’une communauté.
Post-journalisme : quand la loyauté supplante l’objectivité
Le diagnostic est brutal : dans le nouvel ordre informationnel, le journaliste cesse d’être un médiateur pour devenir un héraut. Il ne cherche plus à convaincre l’adversaire, mais à galvaniser son camp ; il n’appelle plus à la raison, il excite l’identité. L’investigation cède le terrain au commentaire, l’éthique professionnelle à la loyauté idéologique. Gurri ne s’en lamente pas sur le mode nostalgique ; il constate, chiffres à l’appui, que l’économie numérique récompense le contenu polarisant bien plus sûrement qu’elle ne finance des enquêtes longues et coûteuses.
La question que pose l’ex-analyste est vertigineuse : que devient le débat public quand chacun s’enferme dans sa bulle cognitive ? Que reste-t-il d’une vérité commune quand la réalité se fragmente en récits concurrents, inconciliables ? Gurri n’offre pas de recette miracle ; il propose un regard lucide, sans fard, sur la fin d’un monde où l’argument factuel disposait encore d’un monopole moral. Son propos n’appelle pas à la censure ni au retour impossible à la grande messe télévisée. Il invite à comprendre le terrain avant d’y mener bataille : la guerre informationnelle du XXIᵉ siècle ne se joue plus autour de la possession du micro, mais de la maîtrise des tribus numériques.
Pourquoi regarder cette vidéo ?
Parce qu’elle démystifie les ressorts très matériels (publicité, abonnement, algorithme) qui façonnent nos fils d’actualité. Parce qu’elle permet de mesurer à quel point le fonctionnement des médias influence nos propres réflexes de consommateurs d’information. Parce qu’elle replace le scepticisme ambiant non dans une dégénérescence morale, mais dans une logique systémique qu’il est urgent de nommer si l’on veut, un jour, y répondre.
Regarder Martin Gurri, c’est accepter de quitter le confort des condamnations faciles pour explorer le paysage réel – tumultueux, décentré, parfois toxique – de la post-vérité. C’est prendre acte que le journalisme ancien s’est peut-être déjà éteint et que l’avenir de la discussion démocratique dépend de notre capacité à inventer de nouvelles règles, ou au moins de nouveaux antidotes, à l’ère de l’infobésité tribale.
Installez-vous ; laissez vos certitudes au vestiaire ; et entrez dans la salle d’opération où l’ancien espion dissèque, scalpel en main, le cadavre encore chaud de l’objectivité médiatique
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



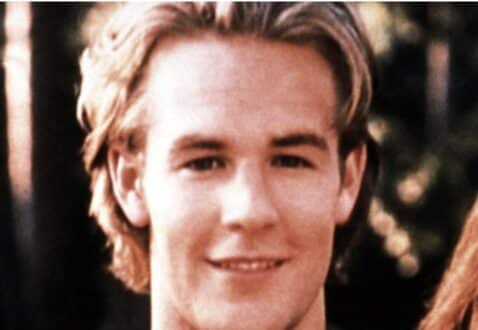


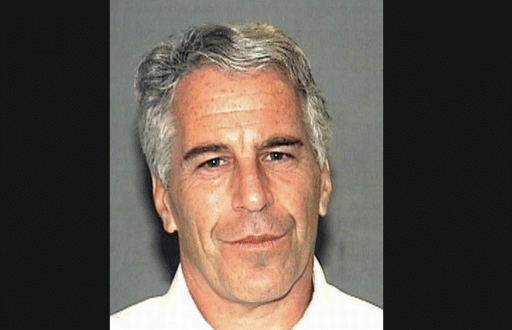


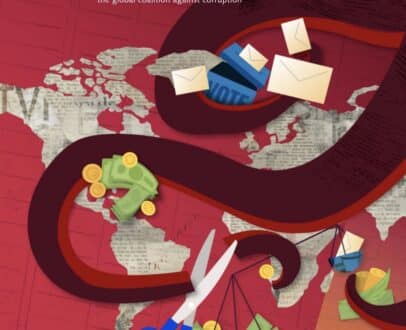




2 réponses à “Quel journalisme demain ? Martin Gurri décrypte la nouvelle guerre de l’information électronique”
Gurri a raison… mais le phénomène est beaucoup plus ancien qu’il ne le croit.
1 – le premier « journal » paru en France, La Gazette de Renaudot, a pu être imprimée et diffusée grâce à l’autorisation et à un financement par Richelieu, principal ministre (c’est comme cela qu’on désignait les premiers ministres sous l’Ancien Régime) de Louis XIII.
2 – on peut dire sans la moindre exagération que tout livre consacré à la religion (n’importe laquelle) ou à la politique, ou à l’histoire est de la Propagande… soit la présentation plus ou moins déformée des idées et des faits pour servir le puissant du jour ou ce que croit fermement le rédacteur… et ceci est vrai depuis Homère et son Iliade qui avait pour but d’exalter les exploits des blonds Achéens opposés aux bruns Troyens
3 – Donc, oui on sait que The New York Times présente la vision du monde des riches Juifs des USA, comme l’Humanité celle des Léninistes (authentiques cocus de l’histoire) ou comme La Vie catholique illustrée présente la vision pontificale, même quand cette vision du monde varie énormément d’un pape au suivant
C’est la règle du jeu médiatique… chacun cherche la soupe qui lui convient
Mais Gurri va plus loin dans l’analyse : si l’opinion publique est totalement déboussolée, c’est en raison de la multiplication exponentielle des sources d’informations par les « relais sociaux »… et au final, oui : « Tout le monde parle et personne n’écoute »… rien que pour avoir dit cela, Gurri est un vrai grand penseur de notre (triste) époque
Triste, parce qu’il n’y a plus de vrai Chef… sauf en Russie et peut-être aux USA !
Les questions de l’intervieweur, Jan Jekielek, me semblent globalement plus pertinentes que les réponses de Martin Gurri ! Celui-ci dit des tas de choses, y compris de très intéressantes, mais en vrac. Et il adopte parfois une attitude de gourou qui l’amène à affirmations contestables. En fait, il est plus convaincant dans les passages où il dit : « je ne sais pas » ! Foncièrement, il s’interroge sur les conséquences des médias, mais guère sur la nature humaine (sauf à propos de l’image, vers la 40e minute) — alors que les premières dépendent entièrement de la seconde. L’homme a besoin de pain, il n’a jamais eu besoin de vérité. Ce que nous appelons « vérité » est le plus souvent une consigne venue d’en haut (la « vérité divine » pousse le concept vers l’oxymore). L’objectivité, le souci de la vérité matérielle, est un concept spécifiquement européen, qui a conditionné la réussite historique de l’Europe depuis la Renaissance tout en restant très minoritaire même en Europe. La « post-vérité », le complotisme, le storytelling, la multiplication des « informations » non sourcées sont des témoins du déclin de l’Occident.
(Au passage : votre titre est à côté de la plaque, Martin Gurri ne parle pas de la « guerre de l’information » mais des conséquences des médias électroniques sur la société.)