Une étude publiée ce 8 juillet par l’Institut de la Protection Sociale (IPS) dévoile un chiffre glaçant : en France, plus de 30 % des cotisations sociales versées par les salariés ne leur ouvrent aucun droit en retour. Pour les cadres supérieurs, ce chiffre grimpe à plus de 50 %. Un système à bout de souffle, de plus en plus vécu comme une taxation déguisée, sans contrepartie réelle.
Une cotisation qui n’en est plus une
Dans l’imaginaire collectif français, les cotisations sociales ont longtemps incarné un pacte républicain : cotiser aujourd’hui pour se protéger demain. Or, cette logique contributive s’érode. L’IPS, premier think tank indépendant consacré à la protection sociale, révèle dans sa dernière étude que près d’un tiers des charges sociales ne donnent lieu à aucune prestation future pour le salarié qui les verse. Le taux grimpe à 53 % dès 54 000 € de salaire brut annuel, jusqu’à 100 % pour les plus hauts revenus. En d’autres termes, à partir de certaines dates dans l’année (dès le 23 juin pour un cadre dirigeant), les cotisations versées ne servent plus qu’à financer les droits des autres.
« On affaiblit le consentement à l’effort en brouillant la frontière entre assurance sociale et fiscalité », dénonce Bruno Chrétien, président de l’IPS.
Une défiance qui s’installe
Ce décalage croissant entre effort et prestation s’ajoute à une complexité administrative devenue kafkaïenne : pas moins de 14 leviers de calcul peuvent influencer une fiche de paie, sans parler des effets de seuils, des règles différentes selon la taille de l’entreprise ou du type de contrat.
Ce brouillard fiscal, combiné à une impression d’injustice contributive, fait émerger une défiance de plus en plus prononcée envers les prélèvements obligatoires. Le risque ? La révolte ou le contournement. Traduction : développement du travail au noir, délocalisations déguisées, ou fuite des talents vers des régimes plus lisibles et équitables.
Dans son analyse, l’IPS souligne que ce sont principalement les actifs du secteur privé qui supportent l’écrasante majorité du financement d’un système qui les oublie. Ils paient pour tous, sans retour équitable sur investissement. Un mécanisme que l’Institut n’hésite pas à qualifier de « taxe sociale déguisée », dénonçant une mutation silencieuse du système, jamais assumée politiquement.
Des pistes pour une réforme structurelle
Face à ce qu’elle considère comme une dérive systémique, l’IPS formule plusieurs propositions de bon sens, parmi lesquelles :
- La clarification de l’assiette des cotisations, en rétablissant un lien clair entre ce que l’on verse et ce à quoi on a droit.
- La fiscalisation des prestations universelles (comme la santé ou les allocations familiales), afin qu’elles ne reposent plus exclusivement sur le travail salarié.
- L’allègement du coût du travail, via :
- Une TVA sociale, en partie déjà mise en place, mais à étendre.
- La mobilisation des cotisations Unedic, sous conditions.
- Une nouvelle assiette de financement basée sur les flux économiques (paiements électroniques, échanges, etc.), à étudier pour diversifier les recettes.
Ce cri d’alarme, soutenu par une méthodologie rigoureuse, souligne la nécessité urgente de revoir les fondations du système social français. En l’état, il est non seulement injuste pour les contributeurs, mais il devient structurellement instable, incapable d’assurer durablement ses missions fondamentales.
Pour l’IPS, seule une réforme systémique et équitable, affranchie du bricolage technocratique, peut sauver la protection sociale française de l’asphyxie.
« Ce système, conçu au XXe siècle, est piloté aujourd’hui par l’absurde. Il faut en sortir pour ne pas briser définitivement le lien de confiance entre les Français et leur modèle social », conclut Bruno Chrétien.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












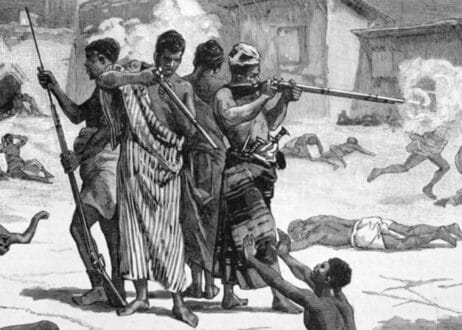

Une réponse à “Cotisations sociales : un tiers des prélèvements sans droits associés, l’alerte choc de l’Institut de la Protection Sociale”
un pognon de dingue qui serait mieux dans les poches es travailleurs