Le dernier rapport du Siadeco (en langue basque) concernant la projection démolinguistique Pays basque sud 2036 commandé par l’Association des municipalités bascophones de l’UEMA a été publié par nos confrères de Berria et, le moins qu’on puisse dire, est que les perspectives sont plutôt sombres.
En effet, selon ce rapport, dans dix ans, les bascophones seront plus âgés et la plupart évolueront dans un environnement plus hispanophone qu’aujourd’hui. Ils connaîtront généralement moins bien le basque, seront de moins en moins nombreux à l’utiliser principalement à la maison et plus de la moitié vivront dans des régions où l’espagnol prédomine. « En résumé » selon Berria, « de plus en plus de bascophones seront principalement entourés d’espagnol au quotidien. »
Cette projection illustre une réalité révélée par plusieurs études antérieures : les locuteurs n’étant pas issus d’une famille bascophone naturelle occuperont une place de plus en plus importante dans la société. « De plus en plus de personnes n’auront pas le basque comme seule langue maternelle, elles seront donc plus à l’aise en espagnol qu’en basque, et, cerise sur le gâteau basque, des bascophones ne maîtriseront pas vraiment le basque. » Et les rédacteurs du rapport de mettre en garde : « l’avenir tracé par ces tendances de fond montre que l’avenir du basque est loin d’être assuré. « Ces conditions ne semblent pas idéales si l’on souhaite une langue qui se transmette naturellement de génération en génération et dont l’usage soit dynamique. Et il ne semble pas que, sauf mesures supplémentaires, on puisse s’attendre à une inversion ou un fléchissement de ces tendances à court terme. »
La fin des « zones de respiration » pour le basque
L’étude met également en évidence un phénomène déjà mis en exergue par d’autres études : les zones bascophones, ces espaces comparables aux Gaeltachtai irlandaises où les citoyens mènent leurs activités quotidiennes en basque, s’affaiblissent et se réduisent. D’après les données relatives à l’utilisation du basque, les communes où la langue est parlée sont qualifiées de « zones de respiration ». Au sein de ces zones, les lieux où elle est parlée à plus de 80 % sont qualifiées de « zones de respiration complète ». Selon les travaux de Siadeco, il n’en sera plus ainsi en 2036. Et même les « zones de respiration » concernées, où l’utilisation est de 60 à 80 %, seront en voie de disparition avec un pourcentage infinitésimal de population de 0,2 % qui y vivra. En 1991, 7,2 % des locuteurs vivaient dans ces zones de respiration ; en 2021, ils étaient 2,9 %. En 2036, ils pourraient être 0,2 %. Ainsi, si la projection se réalise, pour la première fois dans l’histoire, le basque se retrouverait sans zone territoriale socialement dominante !
Quelques aspects encourageants
Outre ces signaux d’alarme, l’étude met tout de même en avant quelques aspects positifs observés dans l’évolution du basque. Ils sont nombreux et non négligeables. Le niveau de connaissance du basque est actuellement plus élevé parmi la population adulte, et le basque est accessible dans de nombreux foyers. Cependant, parallèlement à l’espagnol, l’évolution de la transmission et de l’usage est positive chez les personnes nées à l’étranger car le Pays Basque compte de plus en plus d’immigrés extra-européens. Des progrès notables ont été réalisés dans certains territoires et zones, et la « vitalité » de la langue s’est maintenue dans certaines régions. L’étude souligne qu’il sera primordial de les « approfondir ».
Le rapport a été présenté jeudi 10 juillet au Parc culturel Martín Ugalde à Andoain (Guipuzkoa). Le président de l’UEMA, Martin Aramendi, a déclaré qu’un diagnostic précis de la situation actuelle devait être établi en « observant et en analysant » les données, et que des politiques linguistiques de plus en plus « efficaces et précises » devaient être élaborées sur la base des résultats de ces études. La Communauté a déjà présenté les résultats de ce travail à diverses institutions et partis politiques. Les principaux points de l’étude ont également été présentés lors de son assemblée générale du 14 juin, et le 10 juillet, un séminaire d’une journée a été organisé par Euskaltzaindia (l’académie de langue basque) sur ce sujet. Le chercheur Iñaki Iurrebaso a pour l’occasion résumé les enjeux à venir tirés de cette étude : « Si le basque n’est pas prioritaire, si la question n’est pas véritablement abordée, la langue entrera dans une phase de déclin inéluctable. »
Le pourcentage de bascophones est en « croissance », sauf en Navarre
Le nombre de bascophones a considérablement augmenté ces dernières décennies grâce à l’éducation, et l’impact de cette croissance continuera de se faire sentir dans les années à venir. Les résultats sont clairs, mais géographiquement assez inégaux. Selon les dernières données, en 2021, la connaissance du basque dépassait 80 % parmi la population âgée de 15 à 24 ans en Álava, en Biscaye et au Gipuzkoa. En Navarre, ce pourcentage est bien inférieur avec 26 % de bascophones. Cependant, la croissance générale aura des conséquences positives dans les années à venir. Le taux de croissance de la proportion de bascophones « ralentit », mais en Álava, en Biscaye et au Gipuzkoa, la croissance se maintiendra dans la population générale : les bascophones représentaient 32,6 % de la population en 2001 ; 43,3 % en 2021 ; et, selon les projections, ils seront 48,3 % en 2036. En Navarre, cependant, le pourcentage de résidents bascophones commencera à « décliner » à l’horizon 2036 : ils étaient 12,1 % en 2001 ; 14,9 % en 2021 ; et, selon les projections, ils ne seront plus que 11,8 % en 2036.
Locuteurs plus âgés
Aujourd’hui, la connaissance du basque est particulièrement élevée chez les jeunes. Cependant, à mesure que ces jeunes vieillissent, la population bascophone du Pays basque sud va « vieillir » elle aussi. En réalité, le poids des 2-24 ans dans la population bascophone va diminuer. Cette baisse sera particulièrement marquée chez les 2-14 ans, dénatalité oblige. Car l’un des principaux facteurs à l’origine de ce phénomène est la baisse de la natalité. La société basque était souvent composée de familles nombreuses, comme dans l’ensemble du monde occidental, cette réalité a laissé la place à une société sans enfant. Le poids des tranches d’âge les plus jeunes dans la population totale passera donc de 12,2 % à 9,4 %. De même, le poids des bascophones dans ces tranches d’âge diminuera. En 2021, 69,8 % des enfants et des jeunes de 2 à 14 ans du Pays basque sud étaient bascophones ; selon les projections, ils ne seront plus que 62,3 % en 2036.
Le poids de l’immigration extra-européenne dans le déclin du basque
Autre problème majeur : l’immigration. Mais les nationalistes basques, idéologie tiers-mondiste oblige, ne veulent pas encore voir la réalité à ce sujet. La proportion de personnes nées à l’étranger augmentera significativement d’ici 2036 : 361 875 personnes sont nées à l’étranger en 2021 et 692 467 le seront en 2036, soit 23,2 % de la population », indique l’étude. Si l’on analyse la situation en Navarre en particulier, l’impact y sera plus important : 27,9 % seront nées à l’étranger. Nombre de ces nouveaux arrivants auront des enfants. Cela aura un impact sur la situation sociolinguistique, la rendant encore plus complexe. « Les langues autres que le basque et l’espagnol connaîtront la plus forte croissance », indique l’étude. En 2021, 1,8 % des citoyens âgés de 25 à 44 ans et 5,1 % des 45 à 64 ans avaient une langue maternelle autre que le basque ou l’espagnol ; En 2036, ils seront 17,7 % dans la tranche d’âge la plus jeune, et 11,1 % dans la tranche d’âge la plus âgée.
Les migrants dont la langue maternelle est l’espagnol continueront également d’affluer au Pays basque. En 2021, ils étaient 210 026 ; l’étude indique qu’ils seront 386 083 en 2036. « Comme de nombreux autres nouveaux arrivants, ils transmettent l’espagnol à leurs enfants et le parlent à la maison en espagnol. » Tout cela aura des conséquences : « La transmission du basque au sein des familles diminuera, même dans les familles dont les parents sont nés au Pays basque. » Les prévisions sont les suivantes : parmi les enfants de 2 à 14 ans, le nombre de ceux qui n’auront que le basque comme langue maternelle diminuera : en 2021, ils étaient 17,3 % et en 2036, ils seront 13,6 %. Le pourcentage de ceux qui auront les deux langues simultanément diminuera également, passant de 15 % à 10,6 %. Par conséquent, en général, les enfants et les jeunes auront un niveau de basque inférieur.
Pour mettre un frein à cette tendance, le mouvement abertzale devra faire sa révolution idéologique car beaucoup de migrants sont aidés et appuyés par ces mêmes abertzale. Comme en Bretagne, le mouvement nationaliste contribue à l’affaiblissement de sa propre langue !
Le basque sera de moins en moins parlé à la maison
La proportion de personnes parlant principalement le basque à la maison diminuera de deux points de pourcentage entre 2011 et 2036, passant de 11,6 % à 9,7 %. La tendance à utiliser les deux langues, basque et espagnol, dans des proportions similaires, a augmenté ces dernières années et continuera de croître : en 2011, elles étaient 6,8 % ; en 2021, elles atteindront 10 % ; et en 2036, elles atteindront 12,2 %.
L’usage du basque à la maison diminuera principalement en Navarre. Les personnes qui parlaient principalement le basque à la maison représentaient 5,6 % de la population en 2001 ; 4,2 % en 2021 ; selon les prévisions, elles seront 3,1 % en 2036 (22 667 locuteurs).
Les régions où l’on parle le basque disparaissent
En 2021, 47,2 % des bascophones vivaient dans des communes où le taux d’utilisation du basque dans les ménages était inférieur à 20 %. En 2036, 50,5 % des bascophones vivront dans des zones où l’espagnol est fortement prédominant. Huit sur dix vivront même dans des zones où le taux d’utilisation du basque dans les ménages est inférieur à 40 %.
Si la projection se réalise, le basque se retrouvera également sans territoire à dominante sociale pour la première fois de son histoire ; les « espaces de respiration » disparaîtront également : 7 267 personnes vivront dans ces zones en 2036, réparties dans 21 communes : douze en Guipúzcoa et le reste en Navarre. La perte est considérable : en 2021, 82 791 habitants vivaient dans ces zones, contre 113 734 en 1991. Cette perte est constante au fil des ans. Selon les territoires, dans dix ans, aucune ville de Biscaye ne possédera de zone à dominante basque.
Une grosse baisse en Biscaye et en Navarre
En termes de maîtrise relative, il existe des différences significatives selon les pays. En Álava, la proportion de bilingues basques, c’est-à-dire ceux qui parlent le basque plus facilement, est inférieure à celle des trois autres pays, mais c’est seulement dans cette région qu’elle a augmenté entre 1991 et 2021 : de 5,9 % à 8,5 %. En Guipúzcoa, les bascophones ont réussi à maintenir leur proportion : de 39,4 % à 38,7 %. En revanche, en Biscaye et surtout en Navarre, ces locuteurs ont diminué, passant de 32,3 % à 19,8 %, et en Navarre de 40,6 % à 20 %. Cela signifie que dans ces pays, on observe une augmentation du nombre de personnes parlant le basque, mais qui, en réalité, maîtrisent mieux l’espagnol que le basque et donc utilisent en priorité l’espagnol.
L’analyse de la langue parlée à la maison par les bilingues équilibrés révèle une baisse générale entre 1991 et 2021, particulièrement marquée en Navarre et en Biscaye : en Navarre, le pourcentage est passé de 49,7 % à 24,4 % ; en Biscaye, de 47 % à 31 %. Chez les bilingues basques, une baisse a également été observée : en Navarre, de 86,9 % à 74,5 % et en Biscaye, de 83,9 % à 72,9 %.
Les chiffres du rapport Siadeco sont donc clairs : en plus de connaître une dynamique interne négative avec une lente hispanisation des Basques de souche, le Pays Basque est touché par une forte immigration extra-européenne, en plus d’une traditionnelle immigration hispanophone, qui obère son avenir en tant que langue quotidienne et sociale.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine










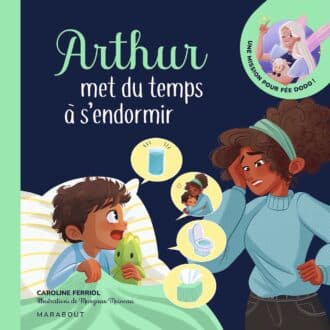



2 réponses à “Immigration extra-européenne et hispanisation : une étude trace de sombres perspectives pour la langue basque au Sud”
Partout l’immigration extra-européenne change nos façons de vivre. Partout une seule et même question : « Quel sera le sort des autochtones de souche chrétienne quand ils deviendront minoritaires sur les terres de leurs ancêtres ? récit romantique et troublant « les corps indécents » (Amazon). Partout les mêmes causes produisent les memes effets .
stopper l’immigration qui ne sert qu’à une minorité de patrons sans scrupules