À l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le think tank croate COK, en partenariat avec l’institut New Direction basé à Bruxelles, a organisé à Zagreb une conférence internationale sur un thème volontairement provocateur : « Liberation or Enslavement ? » (Libération ou asservissement ?). L’objectif : interroger une vision trop longtemps admise – celle d’une Europe entièrement libérée en 1945 – en mettant en lumière la réalité vécue dans les pays de l’Est, passés de la botte nazie à la poigne communiste.
Pendant deux jours, les 8 et 9 juillet, une centaine de participants ont assisté à onze interventions et quatre tables rondes consacrées à l’expérience historique de la Yougoslavie, de la Pologne, de la Lituanie et d’autres pays de l’ancien bloc soviétique. Une documentation précieuse, également disponible sur YouTube, selon les organisateurs.
De Tito à l’URSS : les lendemains qui déchantent
Robin Harris, président du COK et ancien conseiller politique de Margaret Thatcher, a ouvert les travaux en rappelant que derrière le mot « antifascisme », souvent utilisé comme paravent, s’est installée une dictature communiste systémique. En Yougoslavie, malgré une rhétorique de libération, le pouvoir mis en place par les partisans de Tito s’est rapidement mué en régime répressif : confiscations, emprisonnements, tortures, exécutions sommaires – le tout au nom d’une « justice révolutionnaire ». Le culte de la personnalité autour de Tito, calqué sur celui de Staline, s’est imposé sans nuance.
La répression : un modèle commun à l’Est
Les chercheurs Mario Jareb, Jure Krišto et Igor Omerza ont illustré les mécanismes de la terreur d’État : culte du chef, épuration des élites, persécutions religieuses, notamment contre l’Église catholique, assassinats de prêtres, destruction des institutions religieuses et création d’églises de substitution contrôlées par le Parti. La répression n’a épargné ni les dissidents communistes ni les immigrés croates traqués à l’étranger par les services de renseignement yougoslaves (UDBA), responsables de dizaines d’assassinats de militants de la diaspora entre 1946 et 1990.
Pologne et Lituanie : la double trahison
Grzegorz Wołk (Institut polonais de la mémoire nationale) et Arūnas Bubnys (Centre de recherche sur le génocide en Lituanie) ont rappelé que pour ces pays, la victoire alliée de 1945 n’a pas été synonyme de liberté. En Pologne, ce fut le début d’un nouveau cauchemar : déportations massives, liquidation des résistants, emprisonnement des opposants. En Lituanie, près d’un adulte sur trois a été victime directe du régime soviétique entre 1944 et 1953, à travers déportations, travaux forcés et persécutions visant à russifier la population.
La conférence a également mis en lumière le sort tragique des minorités ethniques : les Allemands (Volksdeutsche), les Italiens d’Istrie et de Fiume, mais aussi les musulmans, comme à Zagreb où le mufti Ismet Muftić a été exécuté et la mosquée rasée en 1948. Les conférenciers ont rappelé que nombre de ces actions s’apparentent à des crimes contre l’humanité.
Bleiburg, Daksa, Macelj : les fosses communes du silence
Les dernières sessions ont porté sur les massacres de masse perpétrés dans l’immédiat après-guerre : à Bleiburg, sur l’île de Daksa, ou encore à Macelj et Sveta Nedelja. Les historiens Mitja Ferenc (Slovénie) et Amir Obhođaš (Croatie) ont présenté les recherches archéologiques en cours sur ces charniers cachés, longtemps ignorés ou niés par les autorités. Dans de nombreux cas, les victimes furent exécutées sans procès, parfois dans une mise en scène judiciaire posthume.
En conclusion, Robin Harris a souligné que si la conférence avait respecté une rigueur académique, elle n’en appelait pas moins à une position claire : « On ne peut pas rester neutre face à ce que fut le communisme. » Pour lui, la réponse à la question posée par le titre – libération ou asservissement ? – ne fait aucun doute : pour une large partie de l’Europe, 1945 a marqué le début d’une longue nuit rouge.









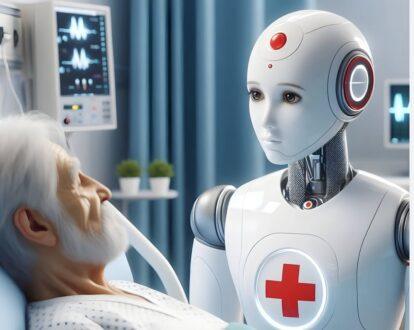


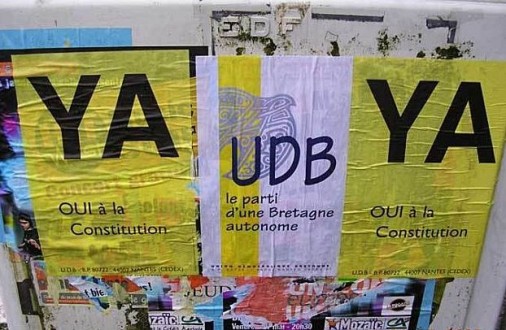

3 réponses à “Conférence à Zagreb : 1945, libération ou asservissement ? Un regard lucide sur l’Europe de l’Est après la guerre et sur les conséquences du communisme”
Et avec ça, le parti communiste n ‘ est pas interdit en France ! Et continue de participer à la politique !!
Aujourd’hui le Parti Communiste Français c’est Cochonou par ci Cochonou par là…
toujours pas de nuremberg du communisme avec ses millions de morts