Pendant des années, les observateurs occidentaux ont prédit que la Pologne suivrait le chemin de Paris, Berlin ou Madrid. Qu’elle légaliserait l’avortement à la demande, les unions homosexuelles, et qu’elle adopterait, bon gré mal gré, les dogmes du gauchisme mondialisé. Cette prophétie ne s’est pas réalisée. Pire pour ses auteurs : elle semble aujourd’hui frappée de caducité.
Car en 2025, la guerre culturelle en Pologne semble s’achever. Et ce ne sont pas les progressistes qui remportent la partie, mais bien les conservateurs.
Une offensive progressiste stoppée net
Ces derniers mois ont été marqués par une échéance cruciale : l’élection présidentielle. Le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, incarnation médiatique de la gauche pro-européenne, y voyait une opportunité historique : faire basculer enfin la Pologne dans le camp progressiste. Mariage pour tous, élargissement de l’avortement, lois sur les discours de haine : tout un arsenal législatif était prêt à être dégainé.
Mais la victoire est revenue à Karol Nawrocki, conservateur assumé, désormais investi président ce 6 août 2025. Pour les partisans d’une Pologne ancrée dans ses traditions, il ne s’agit pas d’une simple alternance politique : c’est un point final au cycle révolutionnaire entamé par la gauche culturelle.
Même dans un Parlement fragmenté, les projets progressistes échouent. L’année passée, une tentative de libéraliser l’avortement a été rejetée d’une courte majorité, grâce à l’alliance tactique entre les conservateurs et certains députés centristes. Les textes visant à renforcer juridiquement les « minorités sexuelles » ont été bloqués. Et les propositions visant à punir davantage les discours dits « haineux » (c’est-à-dire dissidents) n’ont pas passé le filtre du Tribunal constitutionnel ni celui de la présidence.
Une Pologne qui résiste au moule occidental
Comment expliquer cette exception polonaise ? Certes, l’ancrage religieux et la cohésion sociale post-communistejouent un rôle. Mais il y a plus fondamental : le progressisme, né dans l’opulence et la paix relative des décennies passées, semble hors-sol dans une époque de guerre, de crise démographique et de tensions migratoires.
Quand la survie de la nation est en jeu, les débats sur le « genre ressenti » ou l’autonomie corporelle illimitée paraissent grotesques. Même les jeunes, pourtant moins religieux que leurs aînés, ne se tournent pas automatiquement vers la gauche. Beaucoup rejoignent des partis conservateurs ou nationalistes, attirés par un discours de sécurité, d’enracinement et de continuité.
La gauche culturelle polonaise, après cette défaite électorale majeure, semble déboussolée. Certains, comme le parti socialiste Razem, revoient leurs slogans à la baisse, misant à nouveau sur les thématiques sociales classiques (salaires, logement) plutôt que sur les combats sociétaux. D’autres entament une mue vers une forme d’« alter-gauche », recentrée sur la lutte des classes plutôt que sur les batailles culturelles woke.
C’est peut-être le grand paradoxe de notre époque : ce n’est pas l’Église, ni une censure venue d’en haut, qui aura freiné la révolution culturelle. C’est la réalité elle-même, brutale, complexe, exigeante, qui pousse les peuples à revenir à des repères stables : la famille, la nation, l’ordre, la transmission.
Un espoir européen ?
Alors que l’Occident multiplie les lois sociétales, la Pologne a tenu bon. Le droit à la vie n’a pas été bradé. Le mariage traditionnel reste la norme. La liberté d’expression, même critique, subsiste. Et la religion n’est pas reléguée dans les marges du privé, mais conserve une place dans l’espace public.
Bien sûr, la société polonaise n’est pas épargnée : divorces en hausse, sécularisation lente, valeurs molles chez certains jeunes. Mais le cadre légal, lui, tient bon. Et cela suffit peut-être à éviter le naufrage.
Comme l’écrivait Czesław Miłosz, l’âme polonaise reste orientée vers la droite, comme guidée par une boussole invisible. Il aura suffi de résister, de ne pas céder, pour voir l’idéologie de 1968 perdre son souffle, ses slogans, son pouvoir de fascination.
La guerre culturelle ne se gagne pas seulement par des élections. Elle se gagne quand une vision du monde devient dominante, jusqu’à rendre son adversaire obsolète. En ce sens, la Pologne a peut-être remporté une victoire décisive. Et c’est une leçon pour tous les peuples d’Europe : il n’est jamais trop tard pour résister.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine










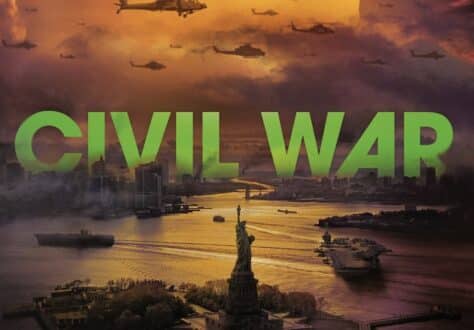



5 réponses à “Pologne : et si les conservateurs avaient remporté la guerre culturelle ?”
sous estimer l’esprit de résistance des polonais , c’est très mal les connaitre….Par sa volonté , ce peuple de la plaine , dans un pays sans frontières naturelles , a conservé , au fil des siècles, et contre de puissants voisins , sa langue…la foi catholique ….etson amour pour la patrie !
Oui, en Pologne et en Hongrie, l’hégémonie culturelle est de droite. Il suffit de se promener à Varsovie ou à Budapest pour le constater.
Droite contre gauche ? Est-ce bien la bonne façon de comprendre la Pologne… Le syndicalisme, d’essence autogestionnaire la plus radicale, y abattit le communisme… Le capitalisme revenu se cassa les dents sur la préservation des secteurs stratégiques, même le charbon national sut résister au mieux à la religion climatique… étrange pays en vérité qui devrait nous inspirer… en sortant de l’axe droite-gauche.
chaque peuple doit être maitre de son destin, respectueux de ses us et coutumes, les zeuropéistes doivent le comprendre
La « chance » des Polonais, c’est de ne pas avoir envie de ressembler à leurs voisins chloroformés du Belarus, et encore moins à la dictature poutinienne qui les menace sans les menacer tout en les menaçant… cela (r)affermit le patriotisme !