L’histoire médiévale de la Bretagne est souvent enveloppée de légendes et de récits héroïques. Mais derrière les mythes, la réalité politique du haut Moyen Âge apparaît beaucoup plus nuancée. Un article académique publié en 2010 dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère par Bertrand Yeurc’h, André-Yves Bourgès et Patrick Kernévez apporte un éclairage neuf sur l’organisation des pouvoirs entre comtes, vicomtes et châtelains.
Aux origines : rois ou comtes sous influence franque ?
Dès le VIᵉ siècle, la Bretagne armoricaine émerge comme une entité distincte dans les chroniques, notamment chez Grégoire de Tours. Les sources évoquent la Cornouaille et la Domnonée comme des royaumes, mais les rois francs les considèrent comme des comtés, titres hérités de l’Empire romain.
Les comtes bretons exerçaient leur autorité sur des territoires et des populations précises, notamment les migrants venus de l’île de Bretagne, tandis que les populations gallo-romaines restaient souvent sous forte influence épiscopale.
Les auteurs critiquent la vision figée héritée des travaux du XIXᵉ siècle, privilégiant une approche dynamique tenant compte des alliances, des extinctions de lignées et des remaniements territoriaux.
Les invasions normandes du IXᵉ siècle bouleversent l’équilibre. Seules les maisons comtales de Nantes et Rennes survivent, avant qu’une nouvelle dynastie ne s’impose en Cornouaille vers l’an mil, réunissant les trois comtés et préparant l’avènement du duché de Bretagne au XIᵉ siècle.
À l’est, ces lignages viennent souvent de l’aristocratie franque, tandis qu’à l’ouest, ils sont d’origine bretonne. Des comtés apparaissent aussi en Porhoët et à Ploërmel avant d’être absorbés.
L’essor des vicomtes : lieutenants et seigneurs de guerre
À partir du XIᵉ siècle, les vicomtes – lieutenants des comtes – deviennent des acteurs clés. Ce sont des seigneurs guerriers installés dans des forteresses éloignées, chargés d’administrer, de juger et de défendre leurs territoires.
Parmi les plus connus :
- Vicomtes de Donges (Nantes), attestés au Xe siècle
- Vicomtes de Hennebont (Vannes), vers 1080-1105
- Vicomtes de Rohan, dont le château de Pontivy est mentionné au XIIᵉ siècle
Certains donnent naissance à de puissantes lignées, d’autres disparaissent rapidement ou se replient à un rang inférieur.
Les châtelains : piliers de la féodalité locale
Du milieu du XIᵉ au XIIᵉ siècle, la multiplication des châteaux – phénomène d’« enchâtellement » – entraîne l’émergence de lignages châtelains, souvent issus de branches cadettes ou apparentées aux vicomtes. Le château de Dinan (vers 1070-1138) ou celui de Dol (fin Xe siècle) illustrent cette implantation. Ces seigneurs adoptent le nom de leur forteresse et deviennent des figures centrales de la féodalité bretonne.
Cette étude montre que la Bretagne médiévale n’était pas un bloc homogène, mais un tissu complexe de pouvoirs en recomposition permanente, entre influences franques, normandes et identités locales fortes. Les châteaux qui jalonnent encore notre paysage – de Josselin à Hennebont – sont les témoins de ces siècles où l’autorité se disputait autant sur les champs de bataille qu’autour des alliances matrimoniales.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












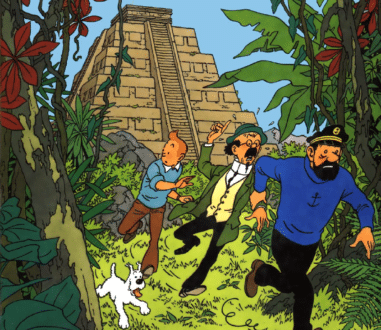

3 réponses à “Comtes, vicomtes et châtelains : la Bretagne médiévale, entre pouvoir et lignages”
Le baron du Pont participa à la croisade mais un siècle plus tard c’est une héritière alors les requins de la Tradition franque et leurs alliés sataniques de l’Eglise qui espionnent tout le monde oui celle du bébé éprouvette et de la mère porteuse imposent un Franc et cette baronnie bretonne disparaît dans le néant des Ordures de France!
Mais qui a jamais cru que la Bretagne médiévale formait un « bloc homogène » ? Cet article est dans la droite ligne des travaux des H. Guillotel, M. Jones, J. Quaghebeur, J.P. Brunterch, F. Morvan, M. Nassiet…
Si certains croient que je vais me taire…je disais donc qu’une clique de vieux faussaires gâteux concoctèrent une fausse religion à usage de racaille, elle ne regroupait que la pire lie de la populace à Rome! Devenue religion d’Etat elle mit en coupe réglée tous les princes et les peuples et par ici la sainte oseille! Vatican 2 ne fut que son acte de décès! Elle était à bout de souffle! Elle repose sur des mensonges. Que des élucubrations!