Il est des moments où, au détour d’une lecture, l’esprit bascule et l’on comprend, comme frappé d’une illumination, l’ampleur d’un problème et la manière dont d’autres, plus habiles ou plus informés que nous, s’emploient déjà à le résoudre. Ce sont de petits Copernic qui déplacent notre univers mental.
L’autre matin, attablé au comptoir du bar de l’Océan au Guilvinec, un verre de muscadet devant moi, je faisais défiler d’un doigt distrait mon fil X. L’œil accrocha le texte d’un ingénieur en robotique que je ne connaissais pas. Dix lignes plus tard, je savais que mon regard sur l’avenir des machines venait de changer.
J’avais toujours été fasciné par les progrès de la robotique, non seulement par les machines à roues et les bras articulés, mais aussi par l’idée qu’un jour, peut-être, ces objets deviendraient nos assistants quotidiens. Et pourtant, je ne comprenais pas pourquoi l’évolution, parfois fulgurante, se traînait par moments comme un vieux chalutier fatigué, peinant à rejoindre le port. Les freins restaient pour moi mystérieux. L’explication que je découvris était d’une simplicité désarmante.
Chaque robot, qu’il soit voiture autonome ou machine d’entrepôt, crache des torrents de données, des téraoctets d’informations brutes, comme une drague qui remonte du fond un mélange de sable, de galets et de bois flottés. Un seul véhicule autonome peut produire deux téraoctets de données en une heure, plus que ce que je consommerais sur YouTube en un mois entier. Le matériel, nous le voyons, solide comme la coque d’un bateau. Ce que nous ne voyons pas, c’est la marée de données qui submerge les ingénieurs, les condamnant à écoper sans fin au lieu d’avancer.
Et là, le tableau se précise. Imaginez un océan où chaque bateau noterait ses cartes et ses journaux de bord dans une langue inconnue, avec son propre alphabet, sur un support illisible par les autres. Impossible de comparer les routes, de partager les relevés météo, de tirer parti de l’expérience d’autrui. Jusqu’à récemment, c’était exactement le monde des robots : chaque « navire » de cette flotte électronique consignait ses observations dans un format qui n’appartenait qu’à lui, avec des dizaines de systèmes de mesure différents, des scripts ésotériques qu’un seul marin-programmeur savait lire, des disques durs externes passés de main en main comme des messages en bouteille, et des tableurs à rallonge où l’on notait patiemment où se cachait le « bug » qui paralysait le robot en plein effort.
Résultat, des millions dépensés pour qu’un robot, tel un cargo échoué sur un banc de sable, reste immobile, la cause de l’avarie étant enfouie dans un fichier de cinq cents gigaoctets que personne ne pouvait aisément ouvrir ou interpréter. Les ingénieurs passaient 80 % de leur temps à sonder cette mer de données, et à peine 20 % à réparer la machine.
Depuis trois ans pourtant, la navigation a changé. Une poignée de sociétés a mis en place une nouvelle « cartographie » numérique, le robotics data stack, qui a ouvert trois voies maritimes majeures.
La première, c’est la visualisation. Des outils comme Foxglove ou Rerun jouent le rôle d’un journal de bord universel : ils permettent de revoir, seconde par seconde, ce que le robot a vu, cru comprendre et tenté de faire, comme si l’on pouvait rejouer toute la traversée depuis le port jusqu’au large. Finie l’époque où l’on disait « ça marche sur ma machine » comme un marin qui jurerait que son navire est sûr alors qu’il n’a jamais quitté les eaux calmes du port.
La seconde, c’est la recherche. Autrefois, retrouver un événement précis dans les archives d’un robot revenait à scruter des années de registres de navigation sans index ni phare pour vous guider. Désormais, des plateformes comme Roboto AI servent de sémaphores et de cartes interactives, permettant de demander : « Montre-moi toutes les fois, ces trois derniers mois, où le robot a manqué sa prise. » Ce qui prenait des heures se règle en quelques battements d’horloge.
La troisième, c’est la standardisation. L’industrie adopte enfin des cartes et des codes de signaux communs : MCAP, qui est au robot ce que la carte marine universelle est au marin, remplace la mosaïque de formats illisibles ; OpenLABEL, traducteur universel, garantit que la mention « piéton » signifie la même chose sur tous les pavillons.
Et voici l’étape décisive : l’unification entre simulation et réalité. Les ingénieurs peuvent désormais entraîner leurs modèles sur des millions de milles simulés, les tester sur des milliers d’heures de navigation réelle, repérer les défaillances, générer de nouvelles simulations pour corriger la route, et repartir. Ce va-et-vient constant, de la haute mer à la carte et de la carte à la haute mer, forge des robots plus intelligents, plus vite.
C’est là le cœur de l’instant copernicien. Les équipes qui sauront lire et dompter ce nouvel océan de données pourront corriger leur cap et repartir dans la journée. Les autres, engluées dans leurs archives illisibles, resteront à l’ancre, occupées à démêler des cordages qu’elles ne comprennent pas.
Et si l’on veut mesurer la portée de ce changement, il faut quitter un instant le vocabulaire de l’ingénierie pour celui de l’histoire. Spengler nous a appris que chaque civilisation forge ses outils à son image, et que la forme de ces outils dit tout de son destin. Les sociétés qui maîtrisent la circulation de l’information sont comme les thalassocraties d’hier : elles règnent non parce qu’elles possèdent les navires les plus solides, mais parce qu’elles savent coordonner leur flotte, relier leurs ports et imposer leur propre cartographie au monde. Dans ce sens, la bataille pour la maîtrise des données robotiques n’est pas un détail technique : c’est la préfiguration d’un nouvel ordre maritime, mais numérique, où les routes sont invisibles et les ports sans rivages. Ceux qui domineront cet océan invisible en seront les maîtres, pour longtemps.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées







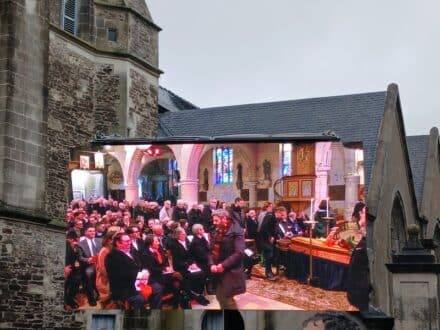






Une réponse à “L’instant copernicien de la robotique”
Gros problème de cette standardisation : n’importe qui pourra prendre la main et diriger n’importe quel robot …