On l’appelait le bouledogue flamand. Pas pour l’effet de manche, mais pour cette façon de mordre la course et de ne plus lâcher, mâchoires serrées, regard d’un bleu qui fendait les bruines de Flandre. Walter Godefroot s’est éteint le 1er septembre 2025, à 82 ans. Dans le vacarme de nos souvenirs (enfin surtout de ceux des plus anciens, faut pas déconner quand même !) il laisse un bruit sourd : celui des pavés qui résonnent encore sous ses roues.
Le pays des pierres et des hommes têtus
La carte d’identité disait Gand ; sa carte du Tendre s’écrivait Ronde. Le Tour des Flandres fut sa maison à corniches, victoire en 1968, puis dix ans plus tard en 1978 — deux coups de tampon sur le passeport de l’éternité. Entre-temps, il avait salué Liège-Bastogne-Liège (1967) d’un clin d’œil d’orfèvre, et terrassé Paris-Roubaix (1969) à coups de reins sur la mauvaise route, celle qu’il aimait parce qu’elle juge les hommes plus que les curriculums.
Les historiens écriront qu’il cumule dix victoires d’étape sur le Tour, un maillot vert (1970) et une date pour les buvards : 1975, premier vainqueur d’une étape du Tour sur les Champs-Élysées. L’essentiel est ailleurs : Godefroot avait l’art discret de convertir un couloir de vent en ligne d’arrivée, de faire tenir une carrière entre un trottoir mouillé et une trajectoire sèche.
Rival de l’ombre, lumières franches
On ne prospère pas à l’ombre du Cannibale sans savoir fabriquer sa propre lumière. Face à Eddy Merckx, Walter ne posait pas au frondeur ; il comptait ses coups. Champion de Belgique, général des classiques, il choisissait le terrain et les armes : le sprint court, l’accélération sans gesticules, la patience d’un paysan qui sait qu’un champ se gagne à la saison. Dans les années 60–70, au milieu de De Vlaeminck, Leman, Dierickx, il fut cette ligne de force qui tord la course sans jamais la théâtraliser.
Il avait le goût des routes qui résistent. On raconte qu’il aida à dénicher des pentes et des passages oubliés, et que son fantôme sourit encore quand les coureurs basculent sur ces dalles où le vélo devient un instrument à percussion. Le Koppenberg ne lui appartenait pas, mais il lui ressemble : court, méchant, impossible à négocier sans respect.
Quand le cuissard s’est rangé, l’homme n’a pas quitté la géométrie des trajectoires. Directeur sportif — de l’école belge à Telekom/T-Mobile, puis un crochet par Astana — il guida d’autres tempéraments, Ullrich, Riis, Zabel, avec ce mélange de rigueur et d’intuition qui tient lieu de boussole dans les voitures suiveuses. L’époque avait ses ombres ; il garda le sens du retrait et de la pudeur, qualités d’anciens qui savent que les explications vieillissent plus vite que les paysages.
On se souviendra d’un sprinteur compact, épaules basses, vélo court, qui ne levait pas toujours les bras mais savait exactement où finissait la ligne. D’un champion qui a gagné contre le temps — dix ans entre ses deux Rondes — et parfois contre les évidences. D’un Flandrien qui parlait peu et laissait les pavés faire sa rhétorique.
Dans les classiques, il y a des saints, des martyrs et des artisans. Godefroot fut des troisièmes : ceux qui fabriquent la course, l’ajustent, l’emmènent à la bonne vitesse, sans demander de miracle. Il n’a pas changé le cyclisme ; il l’a tenu. Et tenir, dans ce métier, c’est déjà beaucoup.
Deux Ronde au fond des poches, Liège comme une médaille froide, Roubaix en poussière d’or, dix bouquets du Tourà sécher dans la remise, et ce premier salut sur les Champs, 1975, qui crépitera longtemps dans les archives.
Les Flandres ont leurs cathédrales : elles s’appellent secteurs pavés, monts, vent de côté. Walter Godefroot y a servi en sacristain opiniâtre, un trousseau de clés à la main : celle du tempo, du placement, du dernier virage. Les cloches sonnent ; l’homme s’en est allé. Les pierres, elles, n’oublient pas.
YV
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine









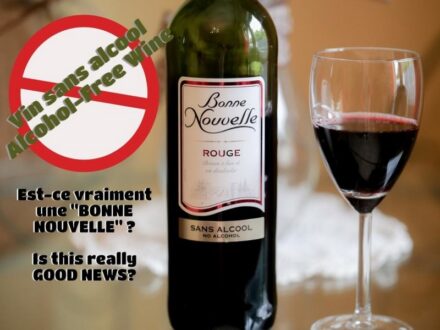




2 réponses à “Walter Godefroot, pavés en héritage”
merci de ce bel hommage très bien écrit , beau style flamand , n’oublions pas aussi bordeaux paris 1969 et 1976, 2 ieme en 1977, le bouledogue avait de la forme mais aussi du fond .
Godefroot, Merckx,De Vlaminck, Leman et bien d’autres… toute une époque, aux antipodes des robots commandés par oreillettes et capteurs de puissance.