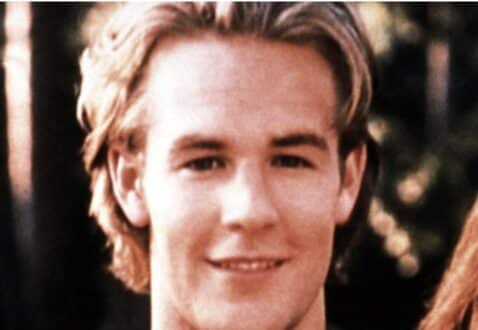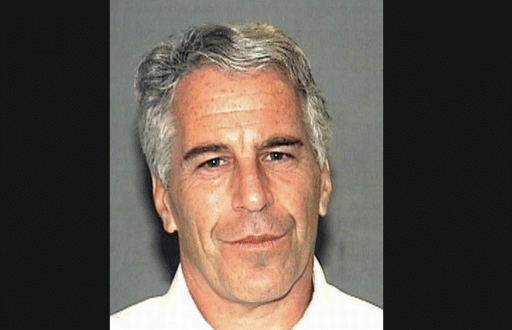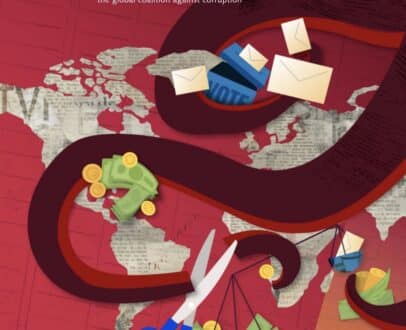Dans un entretien accordé en 1997 au Recours aux forêts (n°7, hiver 1997-1998), Jean-François Gautier (1950-2020) distingue radicalement l’écologie scientifique — étude des milieux et de leurs équilibres dynamiques — de l’« écologie politique », qu’il juge traversée par un mythe de la nature et par des réflexes utopiques. À ses yeux, les enjeux écologiques relèvent d’abord de solutions techniques et, une fois l’opinion saisie, de décisions politiques(droit, police, diplomatie, armée) ; mais l’idéologie d’une « Nature » univoque ouvre la porte à des dérives totalisantes. Synthèse.
La nature n’est pas un objet de science
Pour Gautier, « la nature » comme totalité abstraite n’entre dans aucune méthode scientifique : une science met en relation des objets d’expérience, elle ne traite pas un « singulier universel ». En revanche, l’écologie scientifique a bien un objet : des milieux concrets (grands fonds, montagne, rivière…), leurs paramètres (pression, température, lumière, qualité de l’eau/air), et les relations entre espèces et ressources. Retirer le grand mot de « nature » ne change rien aux enquêtes sérieuses ; cela les débarrasse d’une métaphysique encombrante. Gautier insiste : parlons écosystèmes et mesures, pas « licorne » conceptuelle.
L’écologie est technique, le politique décide
Exemple tranchant : une rivière jadis potable devient imbuvable (nitrites). L’écologie identifie causes et remèdes ; le politique impose les solutions (coûts, contraintes, sanctions). Trois ressorts apparaissent : opinion, autorité, hiérarchie des valeurs (préférer l’eau saine à l’eau polluée). L’« écologie » ne devient « politique » que par l’opinionet parce que ses effets sont publics. D’où la thèse centrale : faire de la politique au nom de l’écologie est un contresens ; la politique a ses fins propres (ordre interne, sécurité externe — Freund, Schmitt). La dépollution n’est qu’un moyen du politique, parfois vital (catastrophes de type Tchernobyl), jamais sa fin.
Le mythe d’une nature une et bonne : un risque totalisant
Le défaut majeur de l’écologie politique, selon Gautier, tient à la mythologie d’une nature initiale, une et bienfaisante, qui convoque des universaux (bien, beau, vrai) et ravive la tentation du total. Remplacer le vieux sequere historiam(suivre la supposée loi de l’Histoire) par un sequere naturam revient à changer de décor sans changer de logique : même promesse d’un grand tout à accomplir, mêmes penchants autoritaristes.
Dans le même mouvement, il étrille les spectacles militants à la Debord/Gilson : communication de masse qui aplatit le contenu au profit de la forme, urgences performatives, rétractations invisibles. Résultat : un humanitaro-naturalisme qui mobilise les foules sans élever l’intelligence des situations — « on veut votre soutien, pas votre action ».
Gautier refuse la juridification de « la nature » (à la façon de certaines thèses de Michel Serres) : faire de la nature un sujet de droit n’a pas de sens — et substitue des signes à l’expérience. Ce que l’homme éprouve dans les milieux peu finalisés (mer, montagne, forêt), c’est la liberté d’une existence sans fin prédéterminée. La mise en musée intégrale du « naturel » appauvrit cette expérience et asservit le sens au système des signes de substitution (spectacle, rentabilité, dispositifs techniques).
Agir : du cas par cas, et des moyens proportionnés
Il n’existe ni « naturel à sauvegarder » valable en général, ni « antinaturel à rectifier » en théorie. Il faut traiter au cas par cas : eau imbuvable, pollution de l’air, risques industriels, etc. — par mesures techniques et décisions politiquesgraduées. À l’intérieur : droit, police, investissements ; à l’extérieur : diplomatie et, si nécessaire, moyens coercitifs. Les conséquences inattendues (Weber) valent aussi pour les techniques « écologiques » : humilité et réversibilitédoivent guider l’action.
Gautier n’appelle pas à un « millénarisme vert » mais à une ascèse de liberté : réduire l’emprise des dispositifs médiatiques qui fournissent du sens avant l’effort de penser/agir ; cultiver une politique écologique efficace (au service de la cité), non une écologie politique totalisante ; accepter que la vérité du politique se révèle surtout dans les circonstances exceptionnelles — où l’on répond concrètement à la question : que faire ?
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine