À seulement 25 ans, Louise Morice incarne une nouvelle génération de femmes journalistes issues d’une droite culturelle assumée. Présente chaque matin à la matinale de Frontières, elle s’affirme aussi comme une voix singulière sur les réseaux sociaux, où elle aborde sans détour des sujets tels que la féminité, la maternité, l’identité et la famille.
Avec son premier documentaire, Adieu les bébés (à visionner ici), elle plonge au cœur d’un thème rarement traité avec autant de franchise : la chute de la natalité en France. Un film d’enquête et de témoignages qui, loin de la froideur des statistiques, donne la parole à des femmes, des mères, mais aussi à des experts, pour comprendre pourquoi tant de jeunes Françaises ne veulent plus d’enfants.
Dans l’interview qu’elle nous a accordé sur le sujet (ci-dessous), Louise Morice dévoile un regard à la fois lucide, incarné et profondément enraciné.
Elle y décrit une société occidentale minée par la peur, la culpabilité écologique et le néo-féminisme, où la maternité est trop souvent présentée comme une aliénation.
Elle y voit les symptômes d’une crise de la transmission, d’une rupture civilisationnelle : un pays qui ne fait plus d’enfants est, selon elle, un pays qui cesse de croire en lui-même.
Le documentaire, explique-t-elle, n’est pas un manifeste, mais un cri d’alerte, un appel à « remettre l’amour à la mode » et à réconcilier liberté et maternité, choix individuel et destin collectif.
Loin des dogmes, elle plaide pour un véritable “plan Marshall de la natalité”, mais aussi pour une bataille culturelle : redonner sens au foyer, à la continuité, à la figure du père et de la mère, contre un monde qui tend à les effacer.
Avec franchise, Louise Morice revient aussi sur son propre parcours : elle qui n’était « pas de droite », dit avoir été rattrapée par le réel — un basculement provoqué autant par l’insécurité vécue que par le sentiment d’un monde en perte de repères. Adieu les bébés se veut donc autant un film sur la démographie qu’un document sur la fragilité spirituelle et identitaire de l’Occident contemporain. A visionner de toute urgence, ici
Breizh-info.com : Pouvez vous vous présenter à nos lecteurs ? Quel a été le moment décisif où vous avez su que vous vouliez être journaliste ?
Louise Morice : J’ai 25 ans. Depuis juin 2023, je suis journaliste chez Frontières (anciennement Livre Noir), où j’anime la matinale tout en contribuant à la communication et au graphisme. Mais mon engagement ne s’arrête pas au journalisme. Depuis plusieurs mois, je partage sur Instagram des réflexions personnelles sur des sujets qui me touchent profondément : la féminité, la maternité, la famille, l’identité.
Ce cheminement m’a menée à réaliser mon premier documentaire : Adieu les bébés. Un projet né d’un besoin simple, mais pressant: parler de ce qu’on évite, de ce qui dérange, de ce qui manque cruellement dans le débat public. À force de creuser ces questions, de voir à quel point elles étaient peu abordées ou mal comprises, ça m’a semblé évident. Il fallait que ce soit dit, montré, transmis. Pour « le moment décisif », j’ai décidé de me lancer le jour où j’ai compris que l’indignation ne suffisait plus. À l’époque, j’étais alternante dans une entreprise sans lien avec la politique, et le meurtre de Lola Daviet m’a bouleversée de manière irréversible.
Ce drame a brisé quelque chose en moi. Je savais que je ne pouvais plus rester spectatrice. Je voulais agir, mais j’ignorais encore comment. Je connaissais déjà David Alaime, aujourd’hui directeur d’Occidentis et directeur éditorial de Frontières. Il m’a parlé du renouveau de Livre Noir, de leur ambition, de leur besoin de sang neuf. Je lui ai demandé de transmettre mon nom à Erik Tegnér.
Je n’avais pas de plan de carrière, seulement une volonté : être utile. Quelques jours plus tard, il me proposait de rejoindre l’équipe.
Breizh-info.com : D’où vous vient ce goût pour les sujets de fond, à contre-courant des tendances médiatiques ? Y a-t-il des modèles — journalistes, écrivains, penseurs — qui vous ont inspirée ?
Louise Morice : Je ne veux pas faire de redites, mais il faut que je le dise : avant, je n’étais pas de droite. Je détestais même la droite. Je la voyais comme rance, fermée, patriarcale. J’étais persuadée qu’elle rabaissait les femmes. Et puis, le réel m’a rattrapée, au sens propre. Un soir, alors que je me rendais à un baby-sitting, en plein couvre-feu, un homme d’origine nordafricaine m’a frappée contre un mur. Gratuitement. J’étais seule, vulnérable. C’était après le Covid. Quand j’ai osé décrire mon agresseur à mes amies, leur seule réponse a été : « Ce n’est pas une question d’origine, le problème, c’est les hommes. Tous les hommes. »
Je n’ai pas pu accepter ça.
Oui, il existe des violences commises par des français « de souche ». Mais j’ai compris, à ce moment-là, que l’immigration incontrôlée faisait venir en France des hommes qui ne voyaient pas les femmes comme des égales, mais comme des proies. Comme de la chair fraîche. Moi, j’ai grandi dans une famille où on respecte les femmes. Deux grands frères protecteurs, un père droit et aimant, des hommes qui aiment et honorent leur femme.
Alors non, je ne peux pas entendre que « tous les hommes sont des prédateurs ». C’est faux. C’est injuste. Et c’est dangereux. Nous n’avons pas à accepter que les femmes occidentales soient traitées comme du butin. Nous n’avons pas à baisser les yeux devant des violences qu’on n’ose plus nommer. Notre civilisation a porté la femme haut. Déesse, mère, guerrière, sainte. Là où d’autres en ont fait une cible, nous en avons fait une source. Là où d’autres l’ont réduite à un trophée, nous en avons fait une mémoire vivante. Les femmes et les enfants ont toujours été les premières victimes, objets de vengeance, cibles de la barbarie.
C’est fini. Protéger la femme, c’est protéger la lignée. C’est défendre la civilisation.
En ce qui concerne mes « modèles » que je préfère appeler inspirations, je pioche un peu partout. Elles sont nombreuses : Charlotte d’Ornellas, Appoline de Malherbe, Sonia Mabrouk, Eugénie Bastié, Gabrielle Cluzel, Christine Kelly, Aziliz Le Corre, Faustine Bollaert, Marie-Estelle Dupont… Je ne pourrais pas toutes les citer. Chacune m’inspire à sa façon, par leur engagement, leur douceur, leur force tranquille. Et comment ne pas finir avec les plus essentielles : ma mère, mes grand-mères… et Sainte Marie, Mère de Dieu. Pardon messieurs, de rester dans mes « carcans » d’ancienne féministe, mais ce sont d’abord les femmes qui m’inspirent. Cela dit, je n’oublie pas les hommes, mon père le premier, qui m’a tout donné (même le pire défaut : être de droite… je plaisante). Mes frères, pour leur amour et leur courage. Et plus largement, les hommes de ma vie, qui me soutiennent chaque jour.
Breizh-info.com : Vous êtes une femme, journaliste, et vous abordez des sujets que d’autres femmes évitent. Ressentez-vous une double pression — celle d’un milieu hostile et celle d’une idéologie dominante ?
Louise Morice : Oui, je ressens une double pression. D’abord, celle du milieu : le journalisme est un environnement où il faut constamment justifier sa légitimité, encore plus quand on est jeune, femme, et qu’on ne pense pas comme la majorité. Il y a une forme de conformisme intellectuel qui s’exerce en douceur, mais qui pèse. Ne pas dire ce qu’on attend de vous, ne pas reprendre les éléments de langage dominants, c’est déjà être soupçonnée.
Ensuite, il y a la pression idéologique. Aujourd’hui, certaines idées sont devenues intouchables, certaines vérités indicibles. Oser parler d’insécurité, de violences sexuelles, d’immigration ou encore de l’effacement progressif des repères familiaux et culturels, c’est s’exposer à des accusations, à des caricatures, à des attaques souvent très violentes. Et ce sont parfois d’autres femmes qui les portent. Mais je n’ai pas choisi de parler pour plaire. Je parle parce que je vois, parce que je vis, parce que je refuse le silence. Ce que j’aborde, ce sont des réalités. Ce n’est ni une provocation ni une posture. C’est une responsabilité.

Breizh-info.com : Pourquoi avoir choisi ce thème — la chute de la natalité — à un moment où peu de médias osent en parler franchement ?
Louise Morice : Parce que c’est une question vitale, et qu’on ne peut plus se permettre de la contourner. La chute de la natalité, ce n’est pas une tendance sociologique parmi d’autres. C’est un signal d’alarme. Quand un pays ne fait plus d’enfants, c’est qu’il doute de lui-même, qu’il ne se projette plus, qu’il n’a plus confiance dans l’avenir, qu’il ne s’aime plus. C’est une crise existentielle. Peu de médias en parlent franchement, parce que ça oblige à poser des questions dérangeantes : pourquoi les femmes n’ont-elles plus envie d’avoir d’enfants ? Pourquoi tant de jeunes disent ne plus vouloir de famille ? Qu’est-ce que notre société a fait de la maternité, de la transmission, du foyer ? On préfère accuser le patriarcat, l’écologie ou le capitalisme, plutôt que de regarder en face un modèle de société qui a peu à peu vidé la maternité de son sens, et qui traite la famille comme une option parmi d’autres. Moi, j’ai voulu en parler parce que je suis une femme, parce que je suis concernée, et parce que je ne veux pas vivre dans un monde sans enfants. Je me souviens, petite, des publicités qu’on voyait : des enfants étrangers, dénutris, sous les bombes, les yeux pleins de détresse. C’était toujours à l’autre bout du monde. Quelque part, l’homme occidental était coupable de tout. Cette culpabilisation constante, cet ethno-masochisme, a été parfaitement intégré : à force de vouloir sauver l’autre, on a fini par oublier les nôtres. L’État, les associations, les médias, le service public : tous ont peu à peu détourné les yeux des souffrances locales. On a préféré parler des enfants d’ailleurs plutôt que de regarder ceux qui dorment à la rue ici, ceux qui grandissent dans la violence, sans repères, sans avenir. Et aujourd’hui, la France, à son tour, se tiers-mondise. Lentement, mais sûrement. Tout cela ne vient pas d’un manque de moyens, mais d’un manque de volonté, et d’un immense aveuglement.
Breizh-info.com : Ce documentaire ne se contente pas de chiffres : il donne la parole à des femmes, des mères, des experts. Comment avez-vous articulé cette approche à la fois intime et sociétale ?
Louise Morice : En faisant la chose la plus simple, donner la parole, j’ai lancé un appel à témoins. Et j’ai été submergée par les réponses. Chaque témoignage était bouleversant. Les choisir a été l’étape la plus difficile, car chacun méritait d’être entendu. À travers eux, j’ai compris des choses que je n’avais pas anticipées. Mon documentaire s’est peu à peu construit non pas autour de moi, mais grâce à eux. Certes, tout est parti d’une question personnelle. Mais je ne voulais surtout pas que ce film soit auto-centré. Car il n’y a pas une seule cause à la chute de la natalité, mais une mosaïque de vécus, de peurs, de blessures, de désillusions. La première version du documentaire durait 2h15. J’aurais pu en faire un film fleuve… Mais je me suis résolue à le ramener à 1h15. En revanche, tous les entretiens sortiront en version longue sur Frontières +, parce que chaque voix mérite d’être écoutée. Pour les experts, j’ai simplement contacté ceux que j’avais déjà reçus dans ma matinale, et qui me semblaient les plus pertinents. Je suis profondément reconnaissante de la confiance qu’ils m’ont accordée, et de l’intérêt sincère qu’ils ont porté à ce sujet.
Breizh-info.com : Vous parlez d’une “crise silencieuse qui menace l’avenir de la France”. À quel point, selon vous, cette crise démographique est-elle un enjeu civilisationnel ?
Louise Morice : Une société peut survivre à des crises économiques, à des tensions politiques, même à des conflits internes. Mais elle ne survit pas à sa propre disparition. La démographie, ce n’est pas qu’un chiffre ou une courbe : c’est la projection que fait un peuple dans l’avenir. C’est un indicateur de confiance, de vitalité, d’amour, de désir de transmettre. Quand un pays ne fait plus d’enfants, il faut s’interroger : que s’est-il passé pour que le lien entre les générations se rompe ? Cette crise est silencieuse parce qu’elle est lente, presque imperceptible au quotidien. Mais ses conséquences sont profondes : vieillissement accéléré, isolement, déclin économique, et surtout effacement progressif de ce qui nous relie les uns aux autres. La natalité, c’est la racine d’un peuple. Si elle meurt, le reste finit par suivre.
Breizh-info.com : Vous donnez la parole à des femmes qui ne veulent plus d’enfants, parfois “par peur du monde”. Est-ce un symptôme d’une société qui a perdu confiance en elle-même..ou bien les conséquences de la propagande médiatique ambiante ?
Louise Morice : Je pense que c’est les deux à la fois, et que l’un alimente l’autre. D’un côté, il y a une perte de confiance collective : dans l’avenir, dans les institutions, dans le couple, dans la stabilité économique et affective. Toutes les femmes n’ont pas renoncé à la maternité par égoïsme, certaines l’ont fait par peur. Peur de tout devoir porter seules. Peur d’imposer à un enfant un monde qu’elles perçoivent comme instable, violent ou vide de sens. Mais cette peur n’est pas née de nulle part. Elle a été renforcée, parfois construite, par un discours ambiant très négatif : une forme de propagande médiatique et culturelle qui associe la maternité à une aliénation, la famille à une prison, et l’homme à un danger. On a glorifié la déconstruction, la rupture, l’indépendance totale… mais à quel prix ? Quand une société ne valorise plus la transmission, le foyer, la continuité, il ne faut pas s’étonner que de plus en plus de femmes y renoncent. Ce n’est pas une libération : c’est souvent un renoncement douloureux, mais présenté comme un progrès.
Breizh-info.com : Plusieurs intervenantes évoquent le poids du néo-féminisme, qui associe maternité à aliénation. Pensez-vous que ce discours a durablement fracturé la relation des femmes à la maternité ?
Louise Morice : Le néo-féminisme dominant a imposé l’idée que devenir mère, c’était forcément se sacrifier, se soumettre, s’oublier. Que porter la vie, c’était trahir une forme d’émancipation. Résultat : on a séparé, presque artificiellement, la liberté et la maternité, comme si les deux étaient incompatibles. Mais ce discours est dangereux. Il promet l’indépendance, mais il laisse beaucoup de femmes dans un grand vide. Car le désir d’enfant ne disparaît pas sous la pression idéologique : il se refoule, il culpabilise, il s’étouffe parfois… et il ressurgit plus tard, avec douleur. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes doivent devenir mères pour être accomplies. Je dis que le choix réel n’existe que si les deux voies sont respectées. Or aujourd’hui, dans certains milieux, vouloir être mère jeune, ou consacrer du temps à sa famille, c’est souvent mal vu. Ce discours a abîmé le lien entre les femmes et la maternité. Mais je crois qu’une réconciliation est possible et qu’elle commence par redonner à la maternité sa vraie place : ni injonction, ni renoncement. Juste une puissance, un pouvoir. En échangeant avec des femmes engagées dans un parcours de PMA, j’ai compris qu’on faisait croire aux femmes qu’elles pouvaient se poser la question plus tard… mais parfois, plus tard, c’est trop tard.
Breizh-info.com : Vous interrogez aussi des femmes issues de milieux populaires, de zones rurales ou urbaines. Avez-vous observé des différences marquantes dans le rapport à la maternité selon les milieux sociaux ?
Louise Morice : Oui, il y a des différences, bien sûr, mais ce qui m’a frappée, c’est ce qui relie, au-delà des milieux. Dans les milieux populaires, qu’ils soient ruraux ou urbains, la maternité reste souvent une évidence, un repère, parfois une fierté. Le rapport au corps, à la transmission, à la famille est plus direct, plus concret. On ne théorise pas, on vit. Et beaucoup de femmes que j’ai rencontrées ont une forme de lucidité crue mais courageuse : elles savent que ce ne sera pas facile, mais elles veulent des enfants, et elles en assument le désir. Dans les milieux plus favorisés ou diplômés, le discours est différent : on « intellectualise » davantage. On repousse, on doute, on remet en question. Par égoïsme parfois, mais souvent par peur : peur de l’échec, de ne pas être à la hauteur, de perdre sa liberté, ou tout simplement de ne pas « cocher toutes les cases » avant. Ce que j’ai ressenti partout, quels que soient les milieux, c’est une grande solitude autour de la question de la maternité. Que l’on veuille devenir mère ou que l’on hésite, cette décision, immense, est souvent portée seule. Il y a peu d’écoute, peu de soutien réel. Et puis, très vite, surgit une autre question : celle de la garde. C’est un point central, mais trop souvent ignoré dans le débat public. Aujourd’hui, choisir d’avoir un enfant ne devrait pas être synonyme de renoncement, ni à son travail, ni à ses ambitions, ni à sa liberté. Or la réalité, c’est que faire garder son enfant est un parcours du combattant : il faut accepter de s’en séparer très tôt, trouver une personne ou structure de confiance, gérer des listes d’attente interminables ou payer des sommes énormes. C’est un poids logistique, affectif, et financier. Tant qu’on ne prendra pas ça au sérieux, beaucoup de femmes continueront à retarder ou à renoncer à la maternité. Pas par manque de désir, mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour concilier pleinement vie de femme, vie de mère, et vie professionnelle
Breizh-info.com : Certains évoquent une peur écologique — “ne pas faire d’enfants pour sauver la planète”. Est-ce une peur sincère, ou un prétexte à un renoncement plus profond ?
Louise Morice : Je pense que, pour certaines, cette peur écologique est sincère. Beaucoup de femmes ont grandi avec des images de catastrophes climatiques, des rapports alarmistes, et l’idée qu’un enfant serait une « empreinte carbone » de trop. On leur a dit que faire un enfant, c’était aggraver le problème. Mais bien souvent, cette peur en cache d’autres : peur de l’avenir en général, peur d’un monde instable, d’un modèle de société qui ne protège plus, qui ne rassure plus, où la transmission semble incertaine. Il y a aussi le poids d’un discours ambiant très culpabilisant, qui a peu à peu associé la maternité à un choix égoïste, voire irresponsable. Ce climat d’accusation permanente ne construit rien. Il isole, il paralyse, il fait douter les femmes au lieu de les accompagner. Et puis, il faut le dire : ce discours est très autocentré, très occidental. Comme si l’Homme occidental devait porter seul la culpabilité du monde, et comme si sa disparition, démographique ou culturelle, était la solution à tous les problèmes. Mais allez en Afrique par exemple : demandez-leur s’ils pensent à ne plus avoir d’enfants pour sauver la planète. La réponse risque de surprendre. Là-bas, l’enfant est encore perçu comme un prolongement, une bénédiction, un héritage, pas comme un danger.
Comme l’écrit Hervé Carrier dans Lexique de la culture pour l’analyse culturelle et l’inculturation (1992) : « La culture, c’est la mentalité typique qu’acquiert tout individu s’identifiant à une collectivité ; c’est le patrimoine humain transmis de génération en génération. » Évidemment, il ne s’agit pas de généraliser ni de tomber dans des stéréotypes culturels. Chaque individu est unique, chaque culture est traversée de contradictions. Mais ce qu’on observe, de manière assez constante, c’est que dans de nombreuses sociétés non occidentales, le lien au collectif, aux ancêtres, aux aînés reste profondément ancré. La transmission, la solidarité et l’altruisme intergénérationnel y occupent encore une place centrale. Cela ne veut pas dire qu’elles sont à l’abri : la modernisation les touche aussi de plein fouet. Mais ces sociétés semblent avoir conservé, au moins en partie, une vision plus organique de la famille et de la continuité humaine, là où l’Occident tend à fragmenter, à isoler, à douter. Ce n’est donc pas uniquement une question d’écologie. C’est une crise de la transmission.
Breizh-info.com : Le titre du documentaire, “Adieu les bébés”, sonne comme une alerte. Pensez-vous qu’il est encore possible d’inverser la tendance ? Et comment ?
Louise Morice : Le titre Adieu les bébés sonne effectivement comme une alerte, un cri d’alarme face à une réalité inquiétante. Mais ce n’est pas un constat de fatalité. Oui, il est encore possible d’inverser la tendance. Pour cela, il faut d’abord briser le silence et oser parler franchement de cette crise démographique, sans tabou ni culpabilisation. Ensuite, il faut repenser nos politiques familiales : améliorer l’accès à la garde d’enfants, soutenir financièrement les familles, faciliter la conciliation entre travail et vie de famille, redonner du sens et de la valeur à la parentalité dans notre société. Enfin, il faut réconcilier les femmes (et les hommes) avec leur désir d’enfant, en écartant les discours culpabilisants, en leur offrant un vrai soutien, des choix réels, et en valorisant la maternité comme une force, une richesse, et non une contrainte. Et puis avant tout, remettons l’amour à la mode !
Breizh-info.com : Faut-il, selon vous, un véritable “plan Marshall de la natalité”, ou est-ce avant tout une bataille culturelle à mener ?
Louise Morice : Vous montrez que la France se dépeuple tandis que d’autres populations continuent de croître. Faut-il y voir un risque identitaire autant qu’un défi social ? Je pense que la question de la natalité en France est à la fois un enjeu social, culturel et identitaire. Un vrai « plan Marshall de la natalité » est nécessaire : cela passe par des mesures concrètes, ambitieuses et durables, mieux accompagner les familles, faciliter la garde d’enfants, soutenir les mères et les pères, réduire les inégalités territoriales, etc. C’est indispensable pour créer un environnement où avoir des enfants redevient un choix possible, serein et encouragé. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi mener une bataille culturelle, pour redonner du sens à la famille et à la transmission, pour valoriser la maternité et la paternité, et pour reconstruire une confiance dans l’avenir. Sans ce travail en profondeur sur les mentalités, les politiques risquent de ne pas suffire.
Breizh-info.com : Ce documentaire aborde des thèmes qui dérangent la gauche culturelle. Avez-vous subi des pressions ou des menaces depuis sa sortie ?
Louise Morice : Je n’ai pas spécialement ressenti de menace ou de rejet. Peut-être aussi parce que j’espère sincèrement que mon documentaire ne soit pas perçu comme un jugement, notamment envers les femmes qui ne veulent pas avoir d’enfants. Ce n’est pas le propos. En revanche, je vois passer certains messages, que j’avais anticipés : « Toi, tu n’as pas d’enfants. » Justement. C’est précisément pour cette raison que j’ai voulu donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés. Parce que je ne voulais pas parler à leur place. J’ai 25 ans. Et il y a encore quelques années, je ne voulais pas d’enfants non plus. Aujourd’hui, je sens quelque chose changer : le désir grandit, l’horloge tourne, les questions se posent autrement. Et j’ai voulu comprendre pourquoi tant de femmes ressentent la même chose que moi, tout en faisant de moins en moins d’enfants. C’est de là qu’est née la question centrale du documentaire : ADIEU LES BÉBÉS : Pourquoi les femmes françaises ne font-elles plus d’enfants ? C’est une réflexion que j’aurais pu avoir même en étant mère, sans doute avec un regard différent, plus incarné, plus intime. Mais n’en étant pas encore là, j’ai choisi d’écouter. Écouter une quinzaine de femmes et aussi quelques hommes qui ont accepté de se livrer, de confier ce qu’il y a de plus intime : leur rapport au désir, à la famille, à la peur, à cette époque qui bouleverse tout.
Breizh-info.com : Si vous deviez adresser un message à une jeune femme hésitant à devenir mère, que lui diriez vous ?
Louise Morice : Je lui dirais d’abord : Tu as le droit d’hésiter. Ce n’est pas un cap anodin, ni une évidence pour toutes. Devenir mère (j’imagine, j’ai vu et entendu) c’est se donner, mais c’est aussi se découvrir. Je lui dirais de ne pas laisser la peur décider à sa place. On nous a souvent présenté la maternité comme un frein à notre liberté. Mais pour beaucoup de femmes, elle devient au contraire une force, un ancrage, une clarté nouvelle. Je lui dirais aussi qu’aucune société ne devrait l’obliger à choisir entre sa liberté et sa fécondité, entre sa carrière et son désir d’enfant. Si ce choix devient un dilemme insurmontable, alors ce n’est pas à elle de se remettre en cause. C’est la société qui doit changer. Je lui conseillerais de s’entourer, de parler, de poser des questions aux mères autour d’elle, d’écouter des récits positifs, pas seulement des témoignages alarmants. Avoir un enfant est un défi, oui, mais c’est un défi que l’on peut porter en communauté. Alors, rapproche-toi de femmes qui brillent dans leur maternité, qui t’inspirent. Prends le temps. Mais ne fais pas de choix que tu pourrais regretter. Prends le temps, mais ne rate pas la dernière heure. Parce que, quand elle passe, elle ne revient pas, et ça aussi, je l’ai vu, je l’ai entendu, dans tant de récits de femmes. Le temps passe plus vite qu’on ne vous le fait croire. Ne vous laissez pas rattraper. Et surtout : aime-toi. Sache que si le désir de devenir mère naît en toi, il n’a pas à être caché ni justifié. Il est noble. Il est légitime. Il est vivant. Il est beau.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







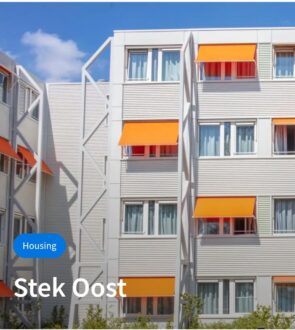

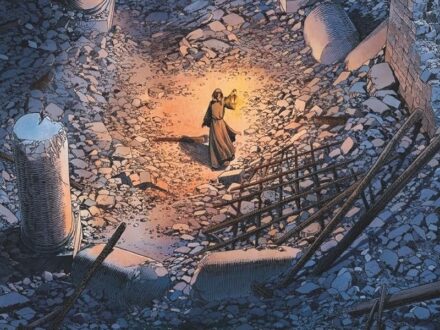




6 réponses à “Adieu les bébés : le cri d’alerte de la journaliste Louise Morice sur la disparition des enfants de France [Interview]”
un couple décide d’avoir un enfant si il a confiance en l’avenir. C’était le cas dans les années 70.
Ou est l’ascenseur social aujourd’hui ?
Aujourd’hui, chômage de masse, invasion migratoire, islamisation du pays, effondrement de l’école, explosion de la criminalité, et matraquage fiscale ne donnent pas envie de faire un enfant.
Et tout ça dans un contexte de propagande et de terrorisme intellectuel
Tout est dit dans cette interview ô combien intéressante ; cela met les pendules à l’heure et maintenant nous savons pourquoi la courbe des naissances a rejoint celle des décès ; dans les années 80 aussi la vie était belle pas comme maintenant mais gardons espoir grâce à Louise ; alors, pour conclure et pour terminer en chanson (bien que je ne sache pas si c’est autorisé de chanter comme cela aujourd’hui), je propose « la P’tite Lady » de Vivien Savage ; elle est sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=40uiliWusyI&list=RD40uiliWusyI&start_radio=1
à Petitjean oui tout ce que vous dites est vrai mais vous oubliez que très souvent les jeunes couples n’ont pas de parent proche qui peut aider à garder les enfants, même de temps en temps, les problèmes avec les crèches, et en cas de divorce (50 p cent) les divorces qui tournent mal, le cauchemar de la garde et les pensions non payées, j’ai tellement de cas autour de moi. De plus, et là les féministes vont me haîr : quand une femme a un bébé elle n’est plus motivée pour aller travailler, trop peu osent l’avouer . Et le top : ma meilleure amie, divorçée deux fois avec 3 enfants, un poste à haute responsabilité , très appréciée : un jour je lui demande comment elle a fait pour concilier travail et famille : là elle me regarde bien dans les yeux et avec force : » et bien, on fait tout, mal » –
Au début du 20ème siècle, il y avait des crèches pour les employés à l’intérieur des usines , si ça peut donner des idées à suivre ….
Pourquoi refusez-vous de parler de la Naprotechnologie ? C’est efficace à 90 % .
L’article n’évoque pas le différentiel entre la natalités dans les familles de souche européennes et celle des familles venue des pays du sud. Cette différence entraine mathématiquement la disparition des ethnies de souche. Faut-il comme les Chinois, définir par ethnies des droits à procréer pour conserver les équilibres démographiques? Ou comme certains pays de l’Est ou la Russie, privilégier la reproduction « nationale » plutôt que l’importation de populations étrangères?