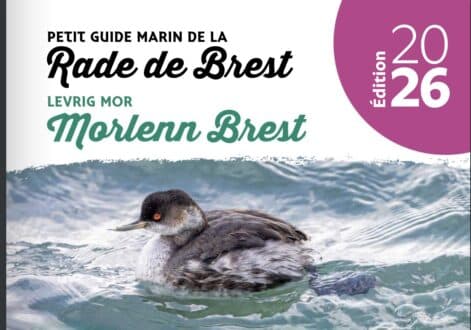L’économiste américain développe sa théorie de la “transplantation culturelle”, selon laquelle les peuples migrants importent durablement les valeurs économiques et institutionnelles de leurs pays d’origine dans les sociétés d’accueil.
Et si l’immigration n’était pas seulement une question de démographie ou de marché du travail, mais aussi — et surtout — de culture économique ?
C’est le cœur de la thèse défendue par Garett Jones, économiste à la George Mason University (Virginie), auteur de The Culture Transplant (Stanford Business Books, 2023). Selon lui, les sociétés qui accueillent massivement des migrants venus de pays aux institutions fragiles ou à la faible confiance sociale finissent, à terme, par leur ressembler.
La culture, moteur invisible de la richesse des nations
Dans la lignée de ses précédents ouvrages (Hive Mind et 10 % Less Democracy), Jones part d’une idée simple : la prospérité économique ne se limite pas au capital ou à la technologie. Elle repose d’abord sur des habitudes collectives : l’épargne, la confiance, la discipline institutionnelle, la probité.
Or ces habitudes sont le fruit d’une longue histoire culturelle.
En étudiant les diasporas installées aux États-Unis, Jones a constaté que les enfants et petits-enfants d’immigrés conservent les mêmes réflexes économiques que leurs ancêtres : les Italo-Américains ressemblent aux Italiens d’Italie, les Mexicano-Américains aux Mexicains du Mexique, etc.
« Les migrants, explique-t-il, n’adoptent pas les normes économiques du pays d’accueil ; ils y apportent les leurs. »
Cette observation s’étend à toutes les civilisations : la culture économique est tenace, parfois sur plusieurs siècles, et finit par influer sur les comportements politiques et la gouvernance du pays d’accueil.
La « théorie du spaghetti » : l’assimilation est un mythe
Pour rendre ce phénomène plus concret, Jones parle de « spaghetti theory » : si les restaurants italiens pullulent en Amérique bien au-delà du nombre d’Italiens, c’est que la culture s’implante durablement.
Mais cette image gastronomique en cache une autre, plus lourde de conséquences : les valeurs politiques et économiques des peuples migrants s’enracinent, elles aussi, et modifient peu à peu la société d’accueil.
Ainsi, l’économiste observe qu’aux États-Unis, certains groupes issus de l’immigration continuent d’entretenir une méfiance plus grande envers l’État ou les institutions, et une propension moindre à l’épargne. À l’inverse, d’autres diasporas — notamment la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est — ont importé des valeurs favorables à la frugalité, au travail et à la stabilité institutionnelle, contribuant à la prospérité de pays comme Singapour ou la Malaisie.
Jones va plus loin : les grands foyers d’innovation de la planète — États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Royaume-Uni, France — constituent un capital civilisationnel fragile.
Leur avance technologique et scientifique repose sur des institutions solides et sur une culture du mérite et de la confiance.
Or, prévient-il, une immigration de masse venue de sociétés où ces valeurs sont plus faibles risque d’éroder les fondements mêmes de cette innovation.
Ce n’est donc pas seulement une question d’équilibre budgétaire ou de chômage, mais un enjeu de survie pour la civilisation technologique : « Si les nations innovantes se laissent transformer de l’intérieur, c’est l’ensemble de l’économie mondiale qui s’en trouvera affaibli. »
Pour l’économiste, le drame de l’Europe est d’avoir importé des comportements collectifs issus de cultures où la corruption, la dépendance à l’État et la faible confiance sociale sont la norme, sans jamais en mesurer les conséquences à long terme.
La sélection des migrants : un impératif de civilisation
L’un des points centraux de la pensée de Jones est qu’il faut évaluer non seulement les individus, mais aussi les cultures dont ils proviennent.
Les pays riches devraient, selon lui, sélectionner leurs migrants en fonction non seulement de leurs compétences personnelles, mais aussi de la solidité institutionnelle et de la productivité historique de leurs nations d’origine.
Cette idée s’appuie sur le concept de « SAT » — trois indicateurs mesurant le passé d’un peuple :
- S pour State history (l’ancienneté de l’organisation étatique),
- A pour Agriculture (sédentarisation et développement économique ancien),
- T pour Technology (niveau technique atteint dans l’histoire).
Plus un peuple a vécu longtemps sous des institutions stables et productives, plus il est susceptible d’apporter une contribution positive aux sociétés d’accueil.
Immigration, institutions et identité
Le propos de Jones, loin des slogans politiques, pose une question anthropologique majeure : une société peut-elle rester la même si elle change de peuple ?
Les États-Unis d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux du début du XXᵉ siècle, et l’Europe occidentale découvre à son tour les effets d’une mutation culturelle lente mais profonde.
L’assimilation totale, conclut-il, est un mythe.
Les cultures ne disparaissent pas ; elles se superposent, se concurrencent, et finissent par redéfinir la société entière.
C’est une vérité que les économistes commencent seulement à mesurer — mais que l’histoire, elle, illustre depuis des millénaires.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine