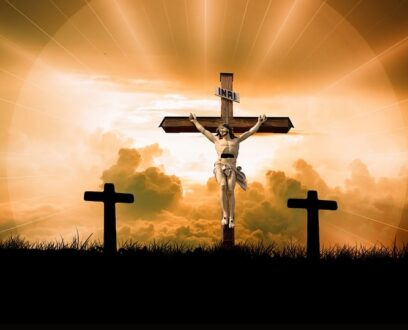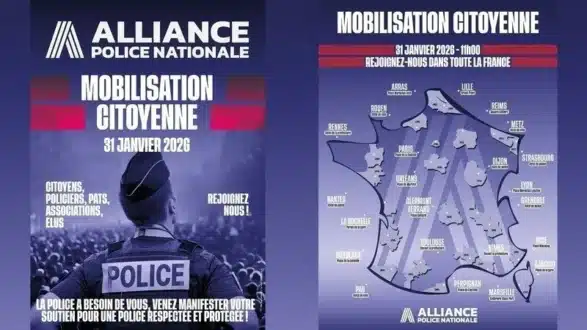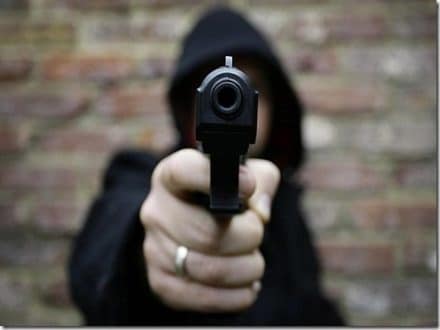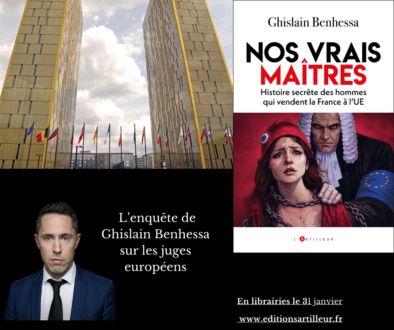Une étude de l’historien Tadhg Ó hAnnracháin (University College Dublin) revient sur un épisode souvent méconnu, mais décisif, de l’histoire irlandaise : la manière dont l’Église d’Irlande, censée unifier la population d’Ulster sous le signe du protestantisme, est devenue au contraire l’un des moteurs de la division entre colons britanniques et autochtones gaéliques.
Entre évangélisation manquée, anglicisation forcée et effacement des clercs irlandais, cette politique religieuse allait durablement marquer la géographie spirituelle et politique de l’île.
Une Église d’État née pour convertir, mais vite devenue étrangère à son peuple
Au début du XVIIᵉ siècle, la couronne anglaise voyait dans la Plantation d’Ulster — vaste colonisation de la province par des Anglais et des Écossais — une occasion d’imposer la Réforme protestante à un territoire encore largement catholique.
Le projet était clair : fonder une Église établie, bien dotée en terres et en revenus, capable d’attirer ou de rallier le clergé local gaélique.
Dans un premier temps, des figures comme le bishop Andrew Knox, ancien évêque des îles Hébrides, prônèrent une stratégie mêlant coercition et persuasion, avec des prêtres bilingues chargés de prêcher en irlandais. Certains ecclésiastiques autochtones acceptèrent de se rallier à la nouvelle Église : on les autorisait à dire la liturgie en langue gaélique, à se marier, et à conserver leurs bénéfices.
Mais cette ouverture ne dura pas. En vingt-cinq ans, tous ces prêtres d’origine irlandaise avaient disparu de l’encadrement religieux : l’Église d’Irlande se transforma en institution anglo-saxonne, étrangère à la population qu’elle devait convertir.
De l’intégration à l’exclusion : la disparition des prêtres gaéliques
L’étude d’Ó hAnnracháin montre qu’au départ, les autorités protestantes croyaient encore possible d’“irlandiser” leur message : la Bible et le Book of Common Prayer furent traduits en irlandais dès 1608, et plusieurs étudiants gaéliques furent formés à Trinity College.
Mais la politique coloniale modifia rapidement les priorités.
L’arrivée massive de colons anglais et écossais incita les évêques à réserver les meilleures paroisses aux pasteurs britanniques, plus éduqués et plus sûrs politiquement. Les clercs natifs furent relégués dans des postes subalternes, souvent dans des zones pauvres et isolées, où ils ne pouvaient guère exercer d’influence.
Peu à peu, la génération suivante ne trouva plus aucun débouché : l’Église officielle ne formait plus de prêtres irlandais.
Dans le même temps, le prélèvement des dîmes sur les terres catholiques — souvent confié à des fermiers britanniques — créa un ressentiment durable. Aux yeux des paysans gaéliques, le clergé protestant devint synonyme d’oppression économique et d’arrogance étrangère, tandis que les prêtres catholiques, revenus de l’exil continental, retrouvaient leur influence dans les campagnes.
Un échec missionnaire total et un terrain miné pour les siècles à venir
Dans les années 1630, l’évêque William Bedell fut l’un des rares à tenter de corriger le tir, encourageant l’usage de la langue irlandaise dans le culte et l’ordination de prêtres autochtones.
Mais ses initiatives suscitèrent la colère des colons anglais, hostiles à toute “gaélisation” de l’Église. Bedell fut marginalisé, et son approche abandonnée.
Résultat : lorsque la grande rébellion irlandaise de 1641 éclata, les prêtres protestants d’Ulster furent parmi les premières cibles de la colère populaire. La fracture religieuse s’était muée en fracture ethnique : le protestantisme était devenu la religion des conquérants, le catholicisme celle des natifs.
Pour l’auteur, cet épisode révèle combien la Plantation d’Ulster, loin d’être une simple colonisation agraire, fut une opération culturelle et spirituelle visant à remodeler l’Irlande selon les normes anglaises. Mais en excluant les Gaéliques du clergé et en négligeant leur langue, l’État a perdu toute légitimité religieuse auprès du peuple.
Le catholicisme, loin de disparaître, s’est alors enraciné plus profondément encore, devenant le ciment de l’identité irlandaise. L’échec de cette évangélisation explique en partie pourquoi, trois siècles plus tard, les divisions confessionnelles et identitaires entre communautés d’Ulster restent si fortes.
Le cas de l’Église d’Irlande dans l’Ulster du XVIIᵉ siècle illustre une constante de l’histoire européenne : lorsque la foi devient un instrument de domination culturelle, elle cesse d’unir et nourrit la résistance. Dans la province la plus disputée d’Irlande, la religion aurait pu être un pont entre colons et natifs ; elle devint au contraire le symbole même de la séparation.
Crédit photo : wikipedia (cc)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine