Je lisais, ce matin, sur l’écran de mon téléphone, la tribune publiée dans Libération par un jeune sociologue, Paul-Max Morin : «Mais qu’est-ce qu’ils vous ont fait les Algériens pour que vous les détestiez autant ? ». Je marchais sur la dune de Léchiagat, ce mince cordon de sable battu par le vent d’ouest, entre la lagune où trône un imposant menhir et l’océan. Le ciel était clair, la mer montait. Il y a quelque ironie à découvrir, dans un journal français, ce texte où l’auteur reproche à la France d’avoir « nié sa part algérienne ». Cette formule, à elle seule, mérite qu’on s’y arrête. Elle concentre tout le malentendu d’une génération élevée dans la repentance et coupée du sens des civilisations.
La France n’a pas de part algérienne ; elle a une histoire avec l’Algérie. C’est bien différent. L’histoire, c’est ce que l’on regarde, que l’on juge, que l’on clôt ; la «part», c’est ce qu’on prétend porter en soi, comme une greffe morale. En érigeant la colonisation en matrice identitaire, Paul-Max Morin ne parle plus d’histoire, il parle de filiation. Il fait de l’Algérie un organe constitutif de la France, comme si notre pays devait désormais se penser à moitié africain. C’est la même opération mentale que celle qui transforme la faute en dette et la dette en identité.
Ce discours n’est pas neuf ; il reprend la vieille antienne de la gauche post-coloniale : substituer à la nation un empire de la culpabilité. L’auteur voit dans le vote parlementaire, la dénonciation des accords de 1968 sur la circulation et le séjour des Algériens, un «retour de la haine». En réalité, c’est l’inverse : mettre fin à un régime d’exception, c’est restaurer l’égalité. Ces accords furent signés dans le déséquilibre d’une décolonisation à vif ; ils ont permis, des décennies durant, un flux migratoire unilatéral, sans réciprocité ni maîtrise. Les dénoncer n’est pas humilier l’Algérie, c’est sortir du tête-à-tête colonial.
Ce qui trouble surtout Morin, c’est que la France ose redevenir sujet de son propre droit. Il lui reproche de rompre avec «la part algérienne de son histoire». Il oublie que l’Algérie, depuis soixante-trois ans, est un État indépendant, et qu’il n’existe pas de mariage indissoluble entre nations. Les civilisations ne fusionnent pas ; elles se côtoient, parfois se combattent, parfois s’ignorent. Spengler l’avait vu mieux que personne : quand deux cultures se mêlent, la plus jeune ne prolonge pas la plus ancienne, elle la remplace.
Ce qui me frappe, c’est cette idée qu’une «part algérienne» habiterait la conscience française comme un héritage biologique. On invoque les harkis, les pieds-noirs, les métissages, les chansons, les films : tout ce que la mémoire émotionnelle peut fournir à la confusion politique. Mais l’histoire ne se résume pas à des images. Elle se construit sur des séparations. L’Empire romain avait fait de la Méditerranée un lac intérieur ; l’Islam, en conquérant le rivage sud, en fit une frontière. Depuis treize siècles, cette mer n’est plus un trait d’union, mais une limite entre deux ordres du monde : au nord, la civilisation européenne ; au sud, la civilisation arabo-musulmane.
Cette césure n’est pas un drame, elle est une donnée. Vouloir l’abolir par la morale, c’est refuser la géographie et l’histoire. La France, fille de l’Europe et du christianisme, ne s’agrandira pas en se dissolvant dans la nostalgie algérienne ; elle se fortifiera en redevenant fidèle à son propre génie. En réclamant qu’on reconnaisse «la part algérienne de la France», Morin inverse les rôles : c’est la France qu’il veut rendre dépendante, l’Algérie qu’il veut transformer en mère morale. Et ce faisant, il perpétue la logique coloniale qu’il prétend condamner : l’impossibilité de vivre séparés.
Je ne connais pas de «part algérienne de la France» ; je connais, en revanche, la part française de l’Algérie. Ce sont les routes, les ports, les lycées, les hôpitaux, les morts de 14-18 venus d’Oran ou de Constantine défendre une patrie lointaine. Cette part-là appartient à l’histoire commune, non à la culpabilité éternelle. Elle n’appelle ni excuses ni fusion, seulement la reconnaissance lucide de ce qui fut fait et défait.
Sur la dune, le vent m’apporte le grondement de l’Atlantique. Je songe que la mer, partout, est frontière avant d’être lien. Elle sépare des peuples qui ne s’ignorent pas, mais qui ne se confondent pas. Ce que Libération nomme «obsession raciste» n’est, en vérité, que la réapparition du sens des limites, sans lequel il n’y a ni nation ni liberté. La France n’a pas besoin de se redécouvrir «algérienne» ; elle a besoin de se rappeler qu’elle est encore France.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine





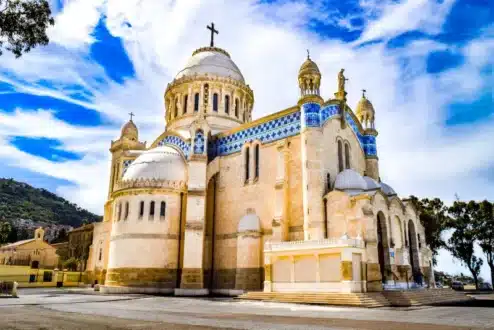







8 réponses à “Non, la France n’a pas de «part algérienne»”
Bonjour, oui ok ; il va falloir s’informer encore et encore sur ce sujet : sur TVL et lors de l’émission « Vers la fin de la terreur idéologique ? – Les Conversations de PM Coûteaux – Jean Sévillia (part 2) », ils ont parlé de l’Algérie ; j’ai découvert des non-dits et notamment sur les vérités cachées de cette sale guerre ; pour écouter toute l’émission et notamment sur ce sujet à partir de 3’24 à 11’42 (après coup, ce qui est dit sur le Général DE GAULLE à partir des années 40 est très intéressant) : https://www.youtube.com/watch?v=bBszQ3va8TA. Kenavo
il y a forcément une part Algérienne : les rapatriés et leurs descendants puis toute l’immigration algérienne en France depuis le début du 20eme siecle . comment l’ignorer ?
En 2024:on comptait 649.991 Algériens en France et ils étaient 33.754 personnes interpellées en situation irrégulière, ils sont la première nationalité interpellée, en France, en situation irrégulière! Quand l’Algérie était française: la France donnait 9 milliards par an pour développer l’Algérie, aujourd’hui, encore, nous donnons 800 millions d’euros!.. Ce sont les Européens qui ont délivré les pays arabes du joug ottoman: en effet, en 1827,l’Algérie était une possession turque, les Turcs y étaient depuis 312 ans…En 1830,quand le gouvernement français décide d’envahir l’Algérie, il y avait 30.000 esclaves chrétiens!…Lors de la »colonisation arabe », au Maghreb, au 7ième siècle, les Arabes ont tué et repoussé les autochtones dans les montagnes et ils les ont »obligés » à se convertir à l’islam!.. Moi, j’en ai marre d’entendre les Algériens et le F.L.N. reprochaient à la France sa »colonisation »!.. Puisqu’ils ont voulu »être indépendants »: qu’ILS RESTENT dans »leur » beau pays indépendant et ceux qui sont en France: qu’ils y RETOURNENT!…signé une Pieds-Noirs née à Alger en 1934 et qui a ses parents enterrés à Alger!..
Pourquoi s’étonner des analyses que font ces jeunes journalistes et sociologues à propos de tout et ici du problème algérien, alors qu’ils ont été biberonnés dans les facultés et écoles de journalisme par des professeurs « vérolés » par l’idéologie ultra gauchiste. Donnons la parole à des spécialistes au faîte de ces questions comme Bernard Lugan. Pour terminer:
« Les islamistes haïssent par dessus tout les faibles, les efféminés et les hypocrites qui viennent les comprendre , les défendre, leur porter le sac « Boualem Sansal
la France existait bien avant les rapatriés et l’immigration. Il n’y a pas de part algérienne.
C’est plutôt l’Algérie qui a une part française, la trace laissée par 132 ans de présence française, cette trace que le pouvoir algérien essaye à tout prix d’effacer.
@Hervé Brétuny Mais de quelle « part algérienne » parlez vous donc ? Les rapatriés étaient – comme leur nom l’indique – français et leurs enfants et petits enfants se sont fondus dans la masse. Les algériens ont désormais un pays depuis plus de 60 ans maintenant et jusqu’au années 50 leur immigration était résiduelle. Il est grand temps de tourner la page du soi disant lien (personnellement bretonne du centre Bretagne de toujours ni moi ni ma famille n’ont jamais eu le moindre rapport ni de près ni de loin avec l’Algérie). Les seules erreurs sont d’avoir accepté leur immigration massive et de leur avoir accordé la nationalité française (les « papiers ») avec légèreté créant des déracinés perpétuels ni d’ici ni de là bas
Le problème étant que les Accords de 1968 ne constituent pas un régime d’exception pour les Algériens.