Ils représentent l’un des casse-têtes les plus redoutés en oncologie : des métastases bien visibles, mais aucune trace de la tumeur d’origine. Ces « cancers de primitif inconnu » (CUP) touchent environ 7 000 personnes chaque année en France, généralement à un stade tardif, lorsque les chances de survie sont déjà très limitées.
Une étude publiée dans The Lancet Regional Health – Europe confirme pourtant qu’une organisation nationale dédiée, associant cliniciens, anatomopathologistes et spécialistes du génome, peut profondément changer le pronostic.
Une pathologie rare… et longtemps sans solution
Dans la très grande majorité des CUP, les traitements reposent encore sur des chimiothérapies dites « empiriques », choisies faute de mieux. Leur efficacité est faible : la survie dépasse rarement un an.
La difficulté est simple : on soigne d’autant mieux un cancer qu’on connaît son point de départ. Or ici, malgré imagerie, examens cliniques et analyses classiques, rien n’apparaît.
Ces dix dernières années, l’explosion des outils moléculaires (séquençage ADN, étude de l’expression des gènes, détection de mutations et de signatures cancéreuses) a ouvert une voie nouvelle : retrouver l’origine cachée de la maladie ou identifier une anomalie moléculaire permettant de proposer un traitement ciblé. Mais ces technologies restent inégalement accessibles selon les hôpitaux.
Une réponse nationale coordonnée depuis 2020
Pour combler cette inégalité, l’Institut Curie a mis en place en 2020 une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) dédiée aux cancers de primitif inconnu, réunissant experts de toute la France.
Objectif : analyser chaque dossier, organiser les examens nécessaires et proposer un traitement sur mesure en s’appuyant sur toutes les données disponibles.
Entre 2020 et 2023, 246 patients ont été évalués dans ce cadre national. Cette étude porte sur l’ensemble d’entre eux, sans sélection, ce qui permet une vision fidèle de la « vraie vie » hospitalière.
Identifier l’origine probable dans 70 % des cas
Le premier résultat marquant est la faisabilité : malgré la fragilité de nombreux malades, les analyses anatomopathologiques et moléculaires ont pu être réalisées chez 76 % des patients, un taux élevé pour une population aussi complexe.
Dans ces cas, l’origine probable du cancer a été identifiée dans 70 % des dossiers. Les sites les plus fréquents sont :
- l’appareil digestif,
- les poumons,
- les reins,
- le sein.
Pour une maladie caractérisée justement par l’absence de tumeur identifiée, ce taux est considéré comme une avancée majeure.
Une survie quasiment doublée
L’étude compare deux groupes :
- les patients recevant une chimiothérapie standard, faute d’indications précises ;
- ceux recevant un traitement orienté par la RCP (soit selon l’origine probable, soit selon une mutation cible).
Les résultats sont sans appel :
- Survie médiane sous traitement “classique” : 11 mois
- Survie médiane sous traitement personnalisé : 18,6 mois
Autrement dit, près de 40 % de réduction du risque de décès, un chiffre significatif dans une pathologie où chaque mois gagné compte.
Pour les malades ayant reçu un traitement orienté vers la tumeur d’origine supposée, la survie grimpe même à près de 20 mois. Ceux bénéficiant de traitements ciblés sur des mutations spécifiques montrent également un bénéfice, même si l’accès à ces thérapies reste encore limité en France.
Un changement de paradigme en oncologie
L’étude montre qu’une prise en charge intégrée – combinant clinique, biologie, pathologie et génomique – est non seulement possible, mais efficace.
Elle démontre aussi :
- qu’un diagnostic collaboratif évite les erreurs initiales : dans 64 % des cas, l’origine retenue après expertise nationale n’était pas celle suspectée par les équipes locales ;
- que les nouveaux outils moléculaires permettent d’orienter des traitements réellement personnalisés ;
- que la France peut offrir ce type d’expertise à tous les patients, mais seulement si l’organisation est maintenue et élargie.
Le Dr Sarah Watson, oncologue à l’Institut Curie et coordinatrice du programme, résume l’enjeu : identifier une cible, même fragile, permet de sortir de l’impasse thérapeutique.
Vers un maillage territorial de centres experts
Si la coordination nationale existe, elle ne couvre encore qu’une partie des malades potentiels. L’équipe souhaite désormais décliner le dispositif à l’échelle régionale, afin de réduire les délais, améliorer la logistique des prélèvements et garantir un accès égal sur tout le territoire.
L’ambition est claire : créer un réseau national de centres référents, capables de proposer à chaque patient – quel que soit son hôpital d’origine – une analyse complète et une stratégie thérapeutique cohérente.
Longtemps considérés comme des cancers sans solution, les CUP entrent dans une nouvelle ère : celle où l’analyse fine de la tumeur, au-delà du simple microscope, offre de véritables chances supplémentaires.
Pour les milliers de patients concernés chaque année, cette étude marque un tournant : elle montre qu’une organisation nationale, associée aux outils moléculaires modernes, peut réellement prolonger la vie et améliorer la compréhension de cancers encore très mal connus.




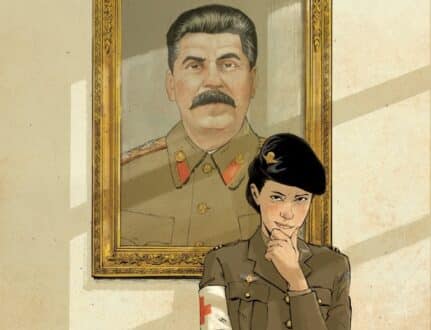




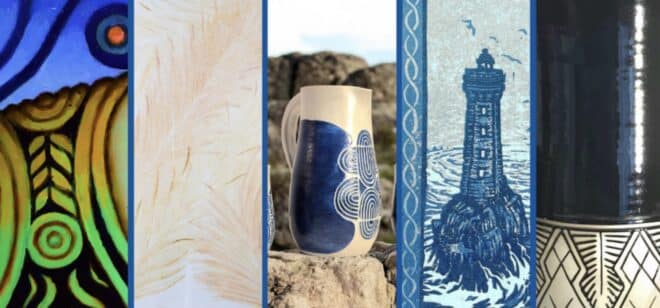
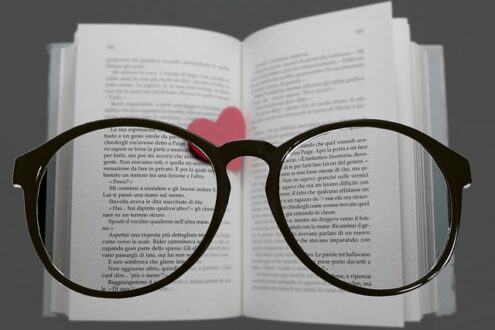



2 réponses à “Cancers de primitif inconnu : une coordination nationale améliore nettement la survie des patients”
Avoir 5 ans de survie quand on a pas encore quarante années, ce doit être le pied ! La compréhension des cancers sera connue quand on voudra s’attaquer aux causes, et même aux causes des causes, comme aurait dit Socrate. Mais on cherche là où il n’y a rien à trouver et on oublie de chercher là où se trouve la solution, à savoir les lois de la nature genèse des lois génétiques de l’espèce humaine. Mais la maladie reste un très bon filon à exploiter par toute l’intelligentia médicale !
Et que dire des » turbo cancers » suite aux vaccinations ? Les lobbys à Bruxelles font la loi de notre alimentation et permettent un lent empoisonnement alimentaire et l’apparition de cancers digestifs…les plus jeunes gavés de sale bouffe rapide qui ne marchent plus et se déplacent en trottinette sont les futurs clients des labos….l’ Alsaco a raison, revenons à une vie plus simple et naturelle et tout ira mieux.