Alors que l’UE est censée être une communauté de valeurs communes que ses institutions prétendent représenter, des tensions sont de plus en plus visibles entre la vision gauchiste impulsée par Bruxelles et les racines chrétiennes qui ont historiquement façonné l’Europe. Les politiques de financement et les cadres législatifs reflètent une tendance à exclure systématiquement les organisations religieuses, en particulier chrétiennes, des processus décisionnels et de la répartition des ressources. Les grandes ONG gauchistes et les lobbies alignés sur l’idéologie du genre, l’écologisme extrême ou le fédéralisme européen occupent désormais l’espace qui appartenait autrefois aux communautés religieuses et aux organisations locales enracinées dans les valeurs traditionnelles.
Face à ce scénario, une résistance s’organise au sein même du Parlement européen. Des groupes conservateurs et patriotiques tentent de donner une voix aux Églises et de défendre leur rôle fondamental dans la vie sociale et communautaire, a déclaré Bernadett Petri, commissaire ministérielle et experte de l’UE, à Javier Villamor pour europeanconservative.com.
Quelle est la principale difficulté dans les relations entre l’UE et les Églises traditionnelles ?
La principale difficulté réside dans le fait que, bien que l’UE soit formellement tenue de dialoguer avec les Églises en vertu de l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’UE, dans la pratique, ce dialogue a été vidé de sa substance. Des réunions périodiques sont organisées, mais elles n’ont aucune influence réelle sur l’élaboration des politiques ou la répartition des fonds. Les décisions importantes sont prises sans tenir compte de l’expérience et des connaissances approfondies des Églises en matière de besoins des communautés locales, de défis sociaux, de cohésion et de paix.
De plus, nous avons détecté de graves irrégularités dans les programmes européens : une préférence systématique est accordée aux ONG progressistes, tandis que les organisations religieuses sont exclues au motif qu’elles ne respecteraient pas les valeurs de l’article 2, qui sont de plus en plus interprétées de manière idéologique et restrictive.
Pensez-vous que l’UE ne considère plus le christianisme comme une partie essentielle de l’Europe ?
C’est une question très intéressante et préoccupante. Il semble que la dimension humanitaire et morale du christianisme ne soit reconnue que dans les relations extérieures, lorsque l’UE parle d’aide humanitaire sur d’autres continents. Mais en Europe, ces dimensions ne semblent avoir aucune importance.
Même lorsque les Églises offrent des services sociaux, prennent soin des personnes dans le besoin, contribuent à l’intégration des marginalisés ou à la défense des droits de l’homme, l’UE préfère canaliser les ressources vers des ONG laïques qui agissent comme des « Églises parallèles », mais sans le bagage de valeurs et sans la légitimité historique. Il ne s’agit pas seulement d’une question administrative, mais d’un déni culturel et spirituel des racines de l’Europe.
Pourquoi pensez-vous que les institutions européennes agissent ainsi ? N’ont-elles pas besoin des Églises ?
C’est un mélange de sécularisation agressive et de calcul politique. La sécularisation a vidé les Églises de leur rôle public, les réduisant à des acteurs privés sans voix institutionnelle. Sur le plan politique, l’UE a choisi de renforcer les réseaux progressistes, plus faciles à aligner sur les objectifs centralisés de Bruxelles.
Les Églises, en revanche, représentent les communautés locales, les traditions nationales et des modes de pensée qui entrent souvent en conflit avec les agendas idéologiques actuels. Cela met mal à l’aise les bureaucrates progressistes de Bruxelles. Même des structures formelles comme la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, ont perdu de leur pertinence. Bien qu’il y ait eu une certaine activité sous le pape François, la participation réelle aux décisions a été minime. Et avec un nouveau pape qui n’a pas encore été élu, l’incertitude ne fait que croître.
Y a-t-il des alliés au Parlement européen pour inverser cette situation ?
Oui, les principaux alliés se trouvent parmi les députés conservateurs, en particulier dans des groupes comme les Patriotes ou le groupe ECR (Conservateurs et Réformistes européens). Étonnamment, même beaucoup de ceux qui se disent démocrates-chrétiens ne donnent pas la priorité à cette question. Mais le contexte peut changer.
Les négociations pour le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) approchent, et elles seront déterminantes. Dans ce cadre, nous pouvons proposer des changements afin de mettre en évidence les inégalités actuelles et de permettre aux Églises de participer sur un pied d’égalité. Avec une stratégie bien conçue et le soutien de nos alliés parlementaires, il est possible d’introduire des réformes.
Êtes-vous optimiste pour l’avenir ? Le christianisme peut-il survivre dans le projet européen ?
Il y a des raisons d’espérer, mais pas d’être naïf. Des pays comme la Hongrie montrent qu’une collaboration étroite entre le gouvernement et les Églises peut renforcer les politiques publiques et l’identité nationale.
La Pologne avait un modèle qui fonctionnait bien sous le gouvernement Droit et Justice (PiS), mais aujourd’hui, avec le changement politique, les Églises sont marginalisées, même au niveau local, sous la pression de Bruxelles. Les institutions européennes utilisent leur pouvoir financier comme un outil politique : si vous collaborez avec les Églises, vous n’obtenez pas de fonds. C’est une menace sérieuse.
Par conséquent, pour gagner, nous devons changer les règles de l’intérieur, en particulier dans le domaine législatif.
Les gouvernements nationaux ont-ils les moyens de se protéger contre ces impositions ?
Ils devraient les avoir, mais cela devient de plus en plus difficile. Bruxelles impose désormais ce qu’elle appelle la « conditionnalité intelligente », qui signifie que les fonds européens ne seront pas versés aux gouvernements s’ils ne remplissent pas certains critères, dont beaucoup sont définis politiquement et idéologiquement sous le couvert de « l’État de droit ».
Cela permet de contourner les gouvernements nationaux et de financer directement des ONG alignées sur des valeurs progressistes, renforçant ainsi leur pouvoir. Si ces tendances ne sont pas stoppées, non seulement les Églises, mais aussi les États membres eux-mêmes perdront leur souveraineté réelle.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine




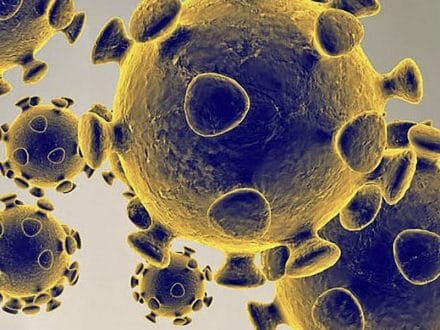
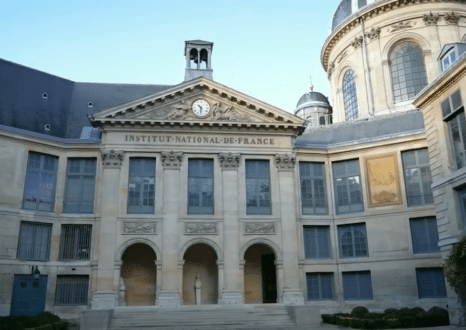


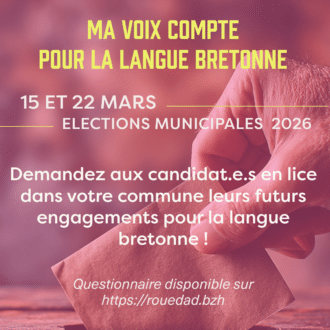





3 réponses à “Bernadett Petri : « Bruxelles finance les ONG gauchistes mais ferme la porte aux Églises »”
Les catholiques pensent que les personnes de couleur ont une âme et peuvent aller au paradis.
l’ue anti blancs et pour la migration à grande échelle
Les activistes de gôche sont partout, ils ne dorment jamais.