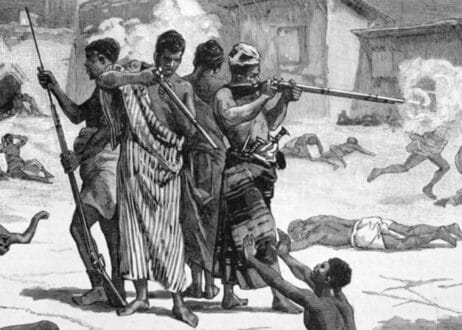La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) poursuit son panorama annuel des établissements de santé avec une fiche dédiée à l’évolution des médicaments et dispositifs médicaux onéreux (MMO et DMO) pris en charge par les hôpitaux. Le constat est sans appel : les dépenses liées à ces produits continuent de croître à un rythme soutenu, atteignant 11,2 milliards d’euros en 2023, soit 9 % de plus qu’en 2022.
Une dépense colossale de 10,4 milliards d’euros en 2023
Les médicaments et dispositifs médicaux dits «onéreux» – c’est-à-dire financés hors des forfaits hospitaliers classiques, sur la fameuse «liste en sus» ou dans le cadre d’autorisations d’accès précoce (AAP) ou compassionnel (AAC) – ont représenté une dépense de 10,4 milliards d’euros en 2023, en hausse de 15,8 % sur un an. C’est presque quatre fois plus rapide que l’augmentation des dépenses hospitalières dans leur ensemble depuis 2018.
Les médicaments à eux seuls pèsent 8 milliards d’euros, soit 77 % de l’ensemble. Et cette dynamique n’est pas nouvelle: entre 2018 et 2023, la dépense a bondi de 80,7 %, alors que la consommation hospitalière globale n’a crû que de 27,7 % sur la même période.
Un financement dérogatoire massif
Ces traitements sont remboursés directement par l’Assurance maladie obligatoire, en dehors du forfait habituel des groupes homogènes de séjour (GHS). Ce système permet de garantir un accès aux innovations médicales coûteuses, mais implique une prise en charge intégrale sans forcément de contrôle sur les prix, qui sont souvent fixés par les laboratoires pharmaceutiques dans les phases pré-commerciales.
En 2023, la liste «en sus» comptait 114 substances actives. Parmi elles, deux classes thérapeutiques accaparent à elles seules 85 % des remboursements: les anticancéreux (71 %) et les traitements des maladies auto-immunes (14 %).
Trois médicaments monopolisent près de la moitié des dépenses
La dépense est extrêmement concentrée: trois molécules seulement – le pembrolizumab (Keytruda®), le daratumumab, et le nivolumab – représentent à elles seules presque la moitié de la dépense de la liste en sus. À elles seules, les dix premières substances absorbent 69 % des remboursements, et les 30 premières, 92 %.
Le pembrolizumab, utilisé contre de nombreux cancers, reste de loin le médicament le plus coûteux, avec 1,67 milliard d’euros (+14,4 % sur un an). Il est suivi par le daratumumab (918 M€, +21 %) et le nivolumab (dépense et volume en hausse). Des progressions rendues d’autant plus préoccupantes que les volumes diminuent parfois, signe que les prix unitaires explosent.
Les médicaments sous accès précoce : une hausse vertigineuse
Les traitements délivrés avant leur autorisation officielle via les régimes d’AAP ou d’AAC voient leur coût s’envoler: +72,5 % en 2023, après +80,5 % en 2022. Ces dépenses ont atteint 1,48 milliard d’euros, concentrées sur quelques traitements très ciblés, notamment contre le cancer du sein, des bronches ou du système lymphatique.
Par exemple, Enhertu®, destiné au cancer du sein, a vu sa dépense tripler en un an (183 M€), tandis que le Yescarta®, pour les lymphomes, a été multiplié par dix.
Les dispositifs médicaux (prothèses, implants, etc.), remboursés eux aussi hors forfait classique, ont coûté 2,3 milliards d’euros en 2023, en hausse de 5,7 %. Là encore, la dépense est très concentrée : les dix produits les plus remboursés représentent 15 % du total, majoritairement pour des pathologies cardiaques.
Le secteur privé à but lucratif affiche une croissance légèrement supérieure (+6,4 %) à celle du secteur public (+5,2 %), mais la majorité des dépenses reste assumée par les hôpitaux publics et privés à but non lucratif.
Une dérive structurelle du financement hospitalier?
Alors que l’État affiche sa volonté de rationaliser les dépenses de santé, les traitements onéreux financés en dehors des forfaits classiques échappent encore largement au contrôle budgétaire, et leur explosion pose une question de soutenabilité. Leur concentration sur quelques pathologies, souvent traitées par des médicaments à prix très élevé, interroge aussi sur l’équité d’accès et la politique de fixation des prix.
La fiche complète à découvrir ici
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine