Dans le labyrinthe de la corruption kirchnériste, l’affaire YPF est un borgésien : ce point minuscule où convergent tous les signes d’un régime où l’État sert de tremplin à des fortunes privées, maquillées sous les traits de la souveraineté populaire. L’expropriation de YPF en 2012, qui valut récemment à l’Argentine une condamnation de seize milliards de dollars à New York, n’est pas une erreur économique. C’est un montage. Un artifice. Une opération de captation légalisée par l’État lui-même au bénéfice d’un clan.
L’origine du mal remonte au rêve humide de Néstor Kirchner : posséder une compagnie pétrolière nationale, à l’instar de ses amis du « socialisme bolivarien », Chávez ou Morales. Ne pouvant exproprier du jour au lendemain Repsol, propriétaire de la compagnie nationale YPF, il tenta de créer ENARSA, l’entreprise nationale de l’énergie. Née d’un décret de 2004, ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) devait incarner le bras énergétique de l’État. Mais l’instrument fut inefficace, symbolique, peu opérationnel. La véritable conquête était ailleurs.
Il se rabattit donc sur l’idée d’« argentiniser » YPF. Non pas pour la nation, mais pour ses affidés. Et qui mieux que la famille Eskenazi, banquiers de leur fief de la province de Santa Cruz, pour incarner cette nouvelle bourgeoisie d’État ? Propriétaires du Banco de Santa Cruz, où les Kirchner avaient déposé leurs avoirs personnels, les Eskenazi étaient les gardiens discrets de la trésorerie familiale. Une alliance scellée dans la province, étendue ensuite au sommet.
Ces derniers acquirent 25 % d’YPF… sans débourser un centime, grâce à un arrangement bancaire sur mesure, adoubé par Madrid et par la Casa Rosada. Lorsque Repsol accepte de céder progressivement une part du capital, ce sont les Eskenazi qui deviennent actionnaires, par le truchement de prêts accordés par des banques amies, remboursables uniquement via les dividendes de l’entreprise. Un miracle comptable, salué d’un euphémisme par le président de Repsol de l’époque, Antoni Brufau : « un expert des marchés régulés », disait-il de Sebastián Eskenazi. Tout est dit.
En vérité, les Eskenazi étaient les hommes de paille du pouvoir. Leur entrée permit à la famille Kirchner de faire main basse, sans apparaître, sur un fleuron énergétique national. Que leur créance supposée ait été ensuite vendue au fonds vautour Burford Capital, via une société-écran espagnole, sans jamais être offerte à l’État argentin, comme l’exige pourtant le droit européen, révèle le cynisme total du montage. Le tribunal de New York n’a vu là qu’un contrat, là où il y eut avant tout une trahison d’intérêt national.
Pis encore : le projet de loi d’expropriation préparé par le secrétaire juridique Carlos Zannini et défendu au Sénat par Axel Kicillof passe sous silence les statuts de la société. Kicillof le dit lui-même à la tribune : « Nous n’allons pas être assez stupides pour respecter ces procédures. » Une bravade devenue facture. La justice américaine, moins sensible à l’arrogance tribunitienne qu’aux règles du droit des sociétés, juge aujourd’hui l’État responsable du mépris de ces formalités.
Que Burford Capital réalise aujourd’hui une plus-value gigantesque, et que les Eskenazi puissent réclamer 30 % de cette somme, malgré leur mise initiale nulle, résume parfaitement l’essence de cette opération : une privatisation des profits doublée d’une socialisation des pertes. L’Aleph, encore.
Il faudrait une enquête d’État pour savoir quel rôle jouèrent réellement certains hauts fonctionnaires, juges et banquiers dans cette affaire. Pourquoi la justice argentine n’a-t-elle jamais poursuivi les Eskenazi, malgré les accusations précises de Victor Manzanares, l’ex-comptable des Kirchner, sur leur rôle de collecteurs d’argent noir ? Pourquoi les juges Bonadío ou Lijo n’ont-ils jamais agi ? Pourquoi l’actuel gouvernement a-t-il nommé pour défendre l’Argentine un avocat, Andrés de la Cruz, ancien conseil des Eskenazi lors de l’opération d’achat, dont l’indépendance dans cette affaire est pour le moins sujette à caution ?
L’expropriation de YPF n’a pas été une erreur. Ce fut une prédation en règle, perpétrée dans un halo de patriotisme, justifiée par une fiction de souveraineté énergétique, dont même les initiateurs ne croyaient pas un mot. Graciela Camaño, alors députée, le dénonçait en 2012 comme une farce. Douze ans plus tard, la facture tombe. Et ce sont les Argentins qui paient.
— Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












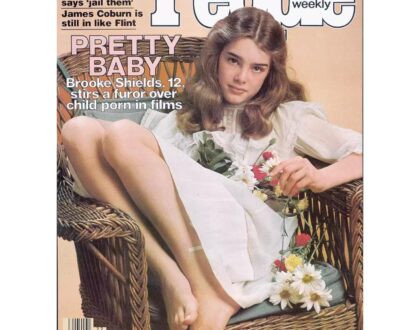

Une réponse à “L’ALEPH argentin : chronique d’une expropriation méritée”
Les israélites sont restés les meilleurs banquiers du monde !