Le 6 et le 9 août 1945, les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki étaient anéanties par deux bombes atomiques américaines, causant la mort instantanée de centaines de milliers de civils et marquant l’histoire au fer rouge. Officiellement, Washington justifiait ces frappes par la nécessité de forcer la reddition du Japon, évitant ainsi de lourdes pertes parmi ses propres soldats. Mais, selon de nombreux historiens, l’Empire nippon était déjà au bord de la capitulation. L’objectif réel aurait été de démontrer la toute-puissance américaine au moment où les États-Unis étaient les seuls à posséder l’arme nucléaire.
Le président Truman, dans sa déclaration du 6 août 1945, qualifiait l’arme atomique de « plus grande conquête de la science organisée » et affirmait qu’elle pouvait jouer un rôle pour « le maintien de la paix mondiale ». En réalité, cet acte inaugura une ère nouvelle : la Guerre froide. Moins d’un an plus tard, Winston Churchill prononçait son célèbre discours sur la « Cortina di ferro » (rideau de fer), annonçant la confrontation ouverte entre puissances occidentales et Union soviétique.
De Hiroshima à la course aux armements
Dès septembre 1945, le Pentagone estimait qu’une attaque contre l’URSS nécessiterait environ 200 bombes nucléaires. Mais le monopole américain prit fin en 1949 lorsque l’Union soviétique fit exploser sa première bombe au plutonium. S’ouvrit alors une course effrénée à l’armement nucléaire : entre 1945 et 1991, États-Unis, URSS et sept autres pays produisirent des arsenaux représentant l’équivalent de plus d’un million de bombes d’Hiroshima.
En 1987, le traité INF (Intermediate-Range Nuclear Forces), signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, mit fin au déploiement de missiles nucléaires terrestres à portée intermédiaire (500 à 5.500 km), tels que les missiles de croisière installés à Comiso, en Sicile. Mais en 2019, sous l’administration Trump, les États-Unis se retirèrent de ce traité. La Russie avait promis de maintenir la moratoire tant que Washington ne déploierait pas de nouveaux missiles. Une promesse rompue : face au déploiement américain, Moscou a annoncé en 2025 qu’elle ne se considérait plus liée par cet engagement.
L’Italie et la violation du Traité de non-prolifération
Officiellement, Rome continue de proclamer son attachement au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), entré en vigueur en 1970 et ratifié par l’Italie en 1975. Le gouvernement affirme que ce traité demeure « le seul instrument à portée globale en matière de désarmement nucléaire » et « le pilier du régime mondial de non-prolifération ».
Pourtant, la réalité est toute autre : la présence sur le sol italien d’armes nucléaires américaines, stationnées sur des bases de l’OTAN, et la préparation de pilotes italiens à leur usage sous commandement américain, constituent une violation manifeste de l’article 2 du TNP. Celui-ci stipule qu’un État non doté d’armes nucléaires s’engage à « ne recevoir de qui que ce soit des armes nucléaires ou d’autres engins explosifs nucléaires, ni le contrôle de telles armes ou engins explosifs, directement ou indirectement ».
Huit décennies après Hiroshima, l’arsenal nucléaire mondial reste capable d’anéantir plusieurs fois l’humanité. En Italie, comme ailleurs en Europe, la proximité de sites de stockage et de bases aériennes intégrées au dispositif nucléaire de l’OTAN pose une question lourde : celle de la souveraineté nationale face aux choix stratégiques américains, et du risque permanent que représente la présence de telles armes sur notre sol.
Le souvenir d’Hiroshima devrait être un avertissement. Pourtant, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de reprise de la course aux armements, la leçon semble oubliée.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







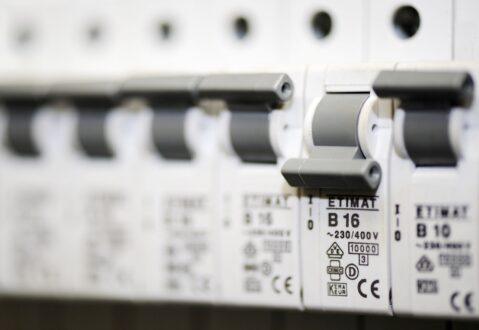


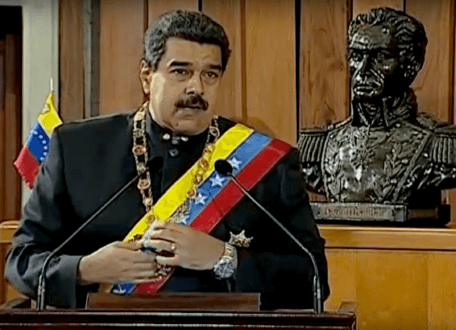
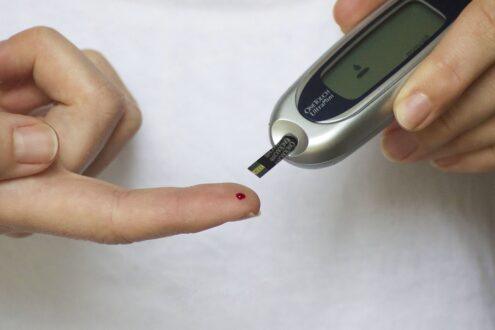


8 réponses à “Hiroshima : 80 ans après, l’ombre de la bombe plane encore… sur l’Italie”
Pourquoi ne citer que l’Italie, l’Allemagne est dotée des mêmes armements américains mais les pilotes des F35 sont allemands. D’autre part si les deux bombardements sur le Japon ne sont peut être pas justifiés, personne ne parle, ou ne veut parler, des exactions des japonais depuis les années 30, Nankin par exemple (Environ 300 000 civils chinois ainsi que des soldats désarmés y trouveront la mort.) (https://doi.org/10.4000/13rii) Bien sur cela s’est fait sur quelques semaines.
Alors, comme le Hamas à Gaza, ils ont trop tiré sur l’élastique et ont fini par le reprendre dans la figure. Il ne faut pas inverser les preuves, c’est trop facile !
Hiroshima, Nagasaki, étaient-ce véritablement des bombes atomiques ?
Certains pensent qu’il s’agissait de bombes très puissantes au phosphore accompagnées de produits sales radioactifs…
l’arme nucléaire a perdu beaucoup de son importance avec la mise au point des armes hypersoniques….que seuls possèdent les russes !
d’accord avec vous ; et l’utilisation de cette arme a permis d’entrer dans la guerre froide ; sinon, l’URSS aurait pu avancer beaucoup plus que Berlin. Pour l’Europe ces armes ont « contenu » la paix.
Les USA si prompte a donner des leçons au monde ont été , sont , les pire massacreurs de l histoire , partout ou ils ont sévi , ils n ont laissé que ruines et cadavres derrière eux !
Mais nous trouvons toujours des thuriféraires tel JCML , pour justifier l injustifiable !
« 9 mars 1945 : Tokyo bombardée – lhistoire.fr
Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, alors que les Japonais désarment les forces françaises en Indochine, la foudre s’abat sur la capitale japonaise. 334 bombardiers B-29 larguent en plusieurs vagues près de 2 000 tonnes de … »….Causant 83 000 morts et 30 000 blessés.
Ce bombardement « conventionnel » comme en a connu l’Allemagne avec les Alliés (Dresde, Hambourg…) fût aussi destructeur que la bombe atomique d’Hiroshima et de Nagasaki.
Le Japon était sur le point de capituler…mais il fallait tester ces nouvelles armes ! et affirmer la puissance des USA.
L’arme nucleaire necessite un vecteur pour l’envoyer – bombardier – missile.
Le record de victimes reste le bombardement de Tokyo en Mars 1945. Dresde egalement. Les USA dominaient sans rival.
Von Braun numero 1 sur la liste Paper Clip a ete confine quelques annees pour mettre au point les missiles.
Les missiles hypersoniques sont un nouveau vecteur qui peuvent envoyer des charges nucleaires.
La Chine monte pour ses capacites militaires nucleaires.
Dresden était une idée folle de vengeance de Churchill qui se morfondait d’avoir été nullissime face au jeune, talentueux, roublard Staline…