Au XVIᵉ siècle, les guerres de Religion ensanglantent la France, opposant catholiques et protestants. La Bretagne, relativement à l’écart au départ, ne bascule qu’à la fin du cycle, lors de la huitième et ultime guerre dite de la Ligue (1588-1598). Mais son engagement tardif n’en fut pas moins décisif : pendant dix ans, notre terre devint un champ de bataille où se mêlèrent ferveur religieuse, rivalités nobiliaires, intérêts économiques et ingérences étrangères.
Le rôle central du duc de Mercœur
C’est la figure de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur et gouverneur de Bretagne, qui cristallise l’entrée de la province dans la révolte. Parent des Guise et marié à une descendante des ducs bretons, il se posa en chef de file du camp catholique ligueur. Appuyé par un réseau de nobles, de villes et de prédicateurs, il tenta de faire de la Bretagne un bastion de la Ligue, organisant des institutions parallèles (parlement, chambre des comptes, monnaie) et contrôlant des citadelles comme Nantes.
Face à lui, de grandes familles comme les Rohan ou les Rieux, mais aussi plusieurs évêques et magistrats, demeurèrent fidèles au roi. Cette fracture entraîna une véritable guerre civile, chaque camp trouvant des appuis locaux : paysans soulevés, milices urbaines, ou garnisons enrôlées dans un camp ou l’autre.
La carte du conflit révèle une province coupée en deux : Nantes, Vannes et Quimper s’érigèrent en forteresses de la Ligue, tandis que Brest ou certaines villes du Léon restèrent aux mains des royalistes. Saint-Malo joua sa propre partition, négociant directement ses privilèges avec Henri IV.
Les cités bretonnes ne furent pas de simples spectatrices. Elles financèrent les armées, levèrent des gardes, et défendirent leurs franchises, souvent davantage pour des raisons fiscales ou commerciales que par pure ferveur religieuse.
Quand l’Europe s’invite en Bretagne
À cette division interne s’ajouta une dimension internationale. L’Espagne de Philippe II soutint activement la Ligue, occupant le port de Blavet et renforçant Mercœur. L’Angleterre, au contraire, apporta son aide aux royalistes dès 1591. Ces interventions croisées transformèrent la Bretagne en enjeu stratégique, exposée aux rivalités entre puissances européennes.
Malgré une victoire éclatante à Craon en 1592, Mercœur ne parvint pas à capitaliser sur ses succès, miné par les dissensions avec ses alliés espagnols et l’épuisement de ses ressources. La reconquête progressive d’Henri IV, converti au catholicisme en 1593, accentua son isolement.
En mars 1598, après dix années de luttes, la guerre se conclut par le traité d’Angers. Mercœur obtint des compensations et maria sa fille à César, fils naturel du roi, mais il dut renoncer à toute prétention sur la Bretagne. Le royaume reprit en main une terre exsangue, marquée par les pillages, la famine et les épidémies.
Si certains se plaisent à voir dans ce conflit une ultime tentative d’indépendance bretonne, la réalité fut autre : il s’agissait avant tout d’une guerre de religion et d’alliances politiques. Les Bretons se battaient plus pour un roi catholique que contre la monarchie française.
La guerre de la Ligue en Bretagne rappelle combien cette terre, tout en ayant rejoint tardivement la tourmente hexagonale, en a subi durement les conséquences. Elle y laissa des cicatrices visibles : châteaux ruinés, villages désertés, et récits populaires marqués par la violence de chefs de guerre tels que Guy Éder de La Fontenelle.
Elle marque aussi la fin des ambitions ducales et l’intégration définitive de la Bretagne au royaume de France. Mais elle témoigne surtout d’une identité bretonne prise dans la tension entre fidélité monarchique, attachement religieux et défense mordicus des libertés locales.
Pour aller plus loin, voir ici, ou lire le livre ci-dessous
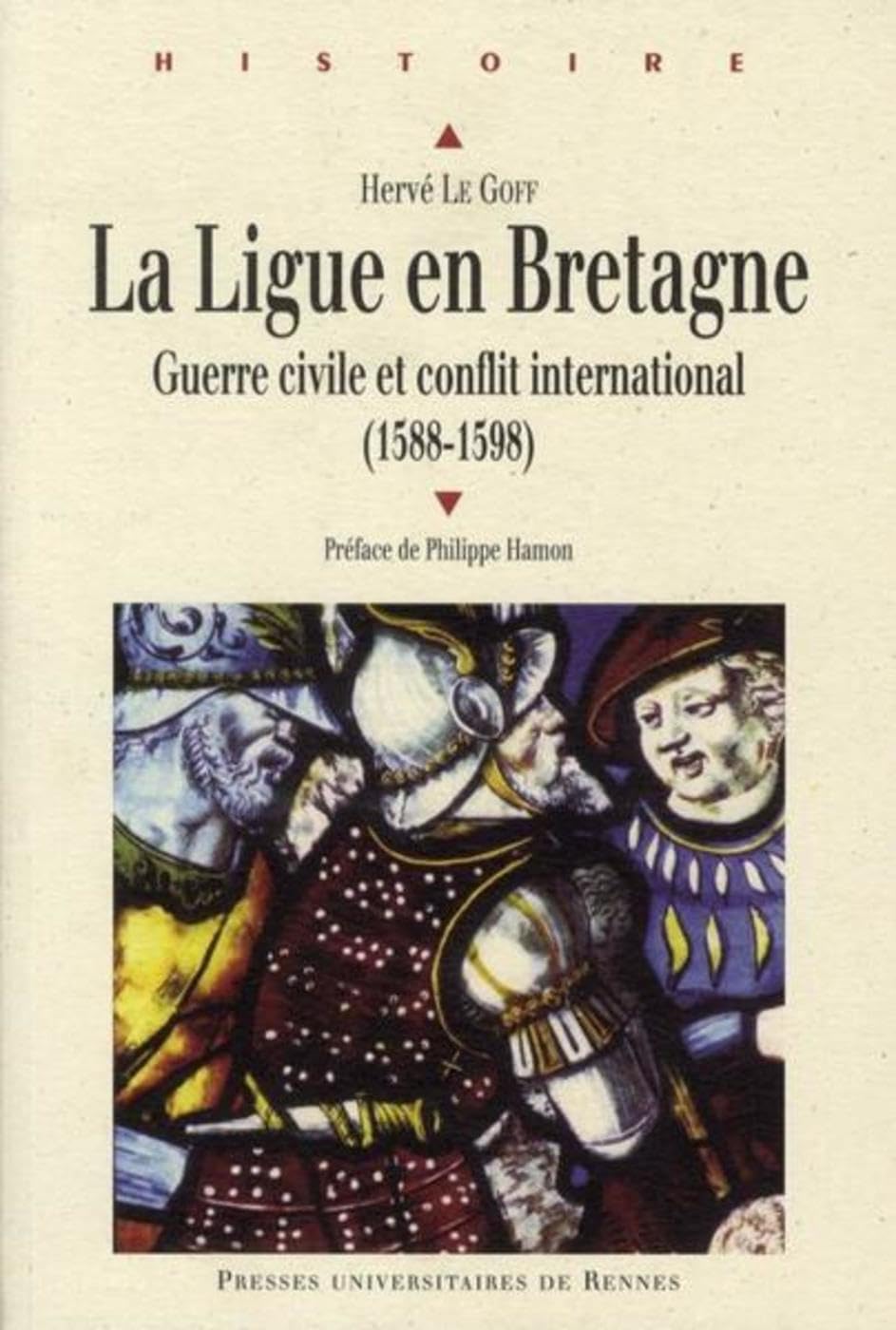
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine






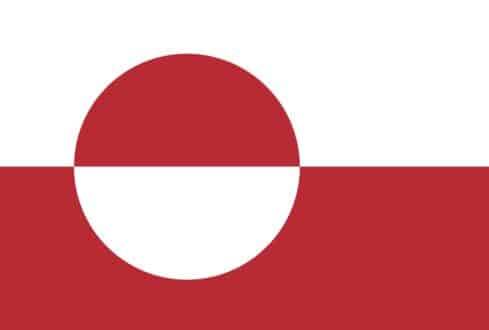







4 réponses à “La guerre de la Ligue en Bretagne : dix années de déchirements entre foi, politique et ambitions étrangères”
Encore une querelle de nantis sur le dos du peuple, qu’avaient-ils de breton les Rohan et autre Rieux? Une vulgaire opposition au roi! Et qui paie? Le hardi port de Penmarc’h à jamais ruiné!
Mais les braves gens quel est leur intérêt dans ces querelles??? Rohan et Rieux sont des vendus aux rois de France mais là ils flairent la bonne occase pour devenir des petits chefs qui allaient tenir tête au roi. Ces gens n’avaient plus le sens du devoir et du service pour leurs vassaux, noblesse dégénérée! N’oublions pas Penmarc’h puissante cité commerciale et maritime ruinée par La Fontenelle qui ne s’en remis jamais! Population brûlée dan l’église comme à Oradour le reste étripée par la soldatesque, que voilà une sainte religion!!!
Il y a une vingtaine d’années, le journal Marianne titrait: « Les De Rohan ont toujours trahi la Bretagne. »
Fureur de Josselin qui menace d’intenter un procès à la dite Marianne qui renouvelle ses « accusations », effectivement justifiées à la lecture de l’Histoire des Rohan qui pris toujours (mais pas tous) le « Parti des Français ».
Fin de l’esclandre.
J’ose croire que Marianne avait titré : « Les Rohan ont toujours trahi la Bretagne ». Cela dit, Catherine de Parthenay (« la mère des Rohan »), Henri II de Rohan et François de La Noue sont de purs héros huguenots, quiconque s’est intéressé à la Ligue en convient. Mais à notre époque on cause d’abord, on réfléchit si l’on a le temps…