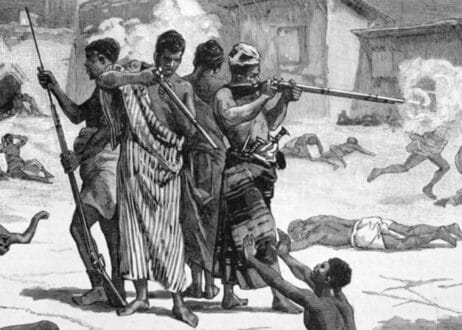Bruges, aujourd’hui perçue comme une carte postale figée dans le temps, doit sa naissance à la mer. Située à la frontière entre la plaine côtière et les terres sablonneuses plus élevées, la ville s’est formée autour de la rivière Reie, qui s’écoulait vers la mer du Nord par un enchevêtrement de chenaux. Cet accès naturel fit de Bruges un lieu de mouillage idéal, au point que son nom dériverait du vieux norrois Bryggja — « embarcadère ».
Dès l’époque romaine, la région abritait un petit port modeste, vivant de pêche, de sel et d’élevage. Mais c’est au IXᵉ siècle, face aux raids normands, qu’une forteresse est construite sur le site du Burg, jetant les bases de la future cité.
Le comté de Flandre et l’essor médiéval
En 863, Baudouin Ier, gendre du roi Charles le Chauve, reçoit la Flandre en dot. À Bruges, il établit son siège, faisant de la ville la capitale du jeune comté. La forteresse du Burg devient le cœur administratif et symbolique de ce territoire, bientôt renforcé par des remparts et des canaux.
Grâce à sa position stratégique et à son ouverture sur la mer, Bruges se transforme en un port marchand incontournable. Dès le XIᵉ siècle, le commerce des draps flamands attire les marchands anglais, hanséatiques, italiens ou espagnols. L’inondation de 1134, qui ouvre le chenal du Zwin, offre un accès direct à la mer et propulse la cité dans la cour des grands ports européens.
Au XIIIᵉ siècle, Bruges invente un outil financier qui fera date : la première bourse au monde. Devant la maison des Van der Buerse, marchands et banquiers négocient devises, contrats et prix à terme, faisant de la ville le centre financier de l’Europe du Nord.
Âge d’or bourguignon
Au XIVᵉ siècle, Bruges entre dans l’orbite des ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi, par son mariage avec l’héritière de Flandre, rattache la ville à son domaine. La cour bourguignonne s’installe à Bruges, donnant au XVᵉ siècle une période de faste exceptionnelle.
C’est l’époque des primitifs flamands, tels Jan van Eyck, qui font rayonner l’art brugeois dans toute l’Europe. Les nobles et riches marchands bâtissent palais et hôtels particuliers. Avec ses soixante mille habitants, Bruges devient alors une véritable métropole, comparable aux grandes cités italiennes.
Mais la prospérité est fragile. En 1482, la mort de Marie de Bourgogne entraîne des tensions politiques et la fuite de la cour. Dans le même temps, le chenal du Zwin s’ensable peu à peu, coupant la ville de son accès à la mer. Le commerce décline, au profit d’Anvers qui devient la nouvelle place forte des Pays-Bas.
Aux siècles suivants, Bruges passe tour à tour sous domination espagnole, autrichienne, française et néerlandaise. Appauvrie, elle survit grâce à l’artisanat, notamment la dentelle, sans connaître la révolution industrielle.
Renaissance romantique et ouverture sur la mer
Le XIXᵉ siècle marque un renouveau inattendu. Tandis que des Britanniques, séduits par son charme médiéval, s’y installent et relancent l’architecture néogothique, Bruges s’ouvre timidement au tourisme. Le roman Bruges-la-Mortede Georges Rodenbach, publié en 1892, achève d’ancrer son image de « ville endormie », mystérieuse et mélancolique.
Désireuse de retrouver la mer, la ville lance en 1895 le projet du port de Zeebruges, inauguré en 1907. Malgré un développement lent, ce port deviendra au XXᵉ siècle l’un des principaux hubs maritimes européens.
Préservée des destructions majeures des guerres mondiales, Bruges conserve l’essentiel de son tissu médiéval. À partir des années 1970, une politique de rénovation ambitieuse redonne vie aux canaux, aux façades gothiques et au centre historique, tout en bannissant la voiture.
Cette stratégie porte ses fruits : Bruges est classée Ville du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000, puis Capitale européenne de la culture en 2002. Elle devient un haut lieu touristique, accueillant tournages de films et expositions internationales, tout en continuant de vivre au rythme de son port de Zeebruges.
Forte de son héritage, la « Venise du Nord » attire chaque année des millions de visiteurs. Mais elle n’est pas figée dans son passé. Entre la modernité du port, la vitalité culturelle et la vigilance face aux excès du tourisme de masse, Bruges reste une ville vivante, où patrimoine et avenir se côtoient en permanence.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine