SZabolcs Janik est chercheur à la Faculté des sciences sociales et d’histoire du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest et ancien directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les migrations (MRI). Bien que dix ans se soient écoulés depuis le début de la crise migratoire, M. Janik estime que l’Europe reste vulnérable, que le risque de nouvelles vagues migratoires reste élevé et que les problèmes fondamentaux identifiés en 2015 n’ont pas été résolus.
Notre confr!re Zoltán Kottász l’a interviewé pour The European Conservative (traduction par nos soins) dans la ville hongroise de Szeged, en marge d’une conférence sur le 10e anniversaire de la crise migratoire européenne organisée par le MCC et le MRI.
Dix ans se sont écoulés depuis le début de la crise migratoire européenne. Selon vous, quelles sont les principales leçons à tirer de cette décennie ?
Szabolcs Janik : Je pense que dix ans suffisent pour faire le point et porter des jugements raisonnablement solides. Les conséquences ont été nombreuses et variées. En 2015, un débat majeur a éclaté à l’échelle européenne sur la manière de gérer la crise. La Hongrie, qui s’est soudainement retrouvée en première ligne, a adopté une approche très différente de celle du courant dominant européen.
Dès le début, le gouvernement hongrois a décidé qu’il ne s’agissait pas simplement d’une question humanitaire, mais d’une question de sécurité et de souveraineté. Il a introduit des mesures strictes visant à freiner la migration. Ces mesures ont été vivement critiquées par les institutions européennes et les gouvernements occidentaux, qui ont insisté sur le fait que la situation était purement une crise humanitaire.
Dix ans plus tard, même si certains progrès ont été réalisés, les points de vue opposés persistent largement. Je suis plus optimiste que certains de mes collègues, car l’importance de la protection des frontières extérieures de l’UE fait désormais l’objet d’un débat plus ouvert, même parmi des acteurs qui, en 2015, auraient rejeté cette idée sans hésiter. Je considère cela comme une véritable réussite, qui n’aurait pas été possible sans la position du gouvernement Orbán.
Bien sûr, cela a eu de nombreuses conséquences tangibles pour la Hongrie : procédures d’infraction, amendes et batailles politiques. Plus récemment, la Cour de justice européenne a condamné la Hongrie à payer un million d’euros par jour pour ne pas s’être conformée à un arrêt de la Cour de 2020 (qui dénonçait, entre autres, la restriction de l’accès à la procédure de protection internationale). Le conflit n’a pas disparu, il s’est simplement atténué, éclipsé par la pandémie puis par la guerre en Ukraine.
Les problèmes fondamentaux identifiés en 2015 n’ont pas été résolus. Les sociétés d’Europe occidentale sont de plus en plus mécontentes des conséquences de l’immigration à grande échelle : tensions sociales, charges sociales, problèmes d’intégration et de sécurité publique. Ces préoccupations refont régulièrement surface dans la politique intérieure, même si les partis de droite qui font campagne sur ces thèmes parviennent rarement à former des gouvernements stables en raison des systèmes électoraux et des contraintes de coalition qui en découlent.
Par ailleurs, les pressions démographiques et géopolitiques n’ont pas disparu non plus. L’Afrique et l’Asie du Sud connaissent une croissance démographique explosive. Ajoutez à cela les migrations induites par le climat – le Bangladesh en est un excellent exemple – et l’Europe reste vulnérable.
Le fait que moins de personnes soient arrivées ces dernières années, par rapport à 2015-2017, est principalement dû à des facteurs extérieurs à l’Europe. Il n’y a pas eu d’autre catastrophe comme la guerre en Syrie et la migration massive qui en a résulté depuis la Turquie. L’Europe n’aurait tout simplement pas pu faire face à une nouvelle situation de ce type. Notre continent reste vulnérable. Compte tenu des tensions et des conflits qui persistent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, le risque de nouvelles vagues migratoires reste élevé. En bref, le problème est loin d’être résolu.
Construire des murs n’est pas une solution en soi, mais il est essentiel de défendre les frontières extérieures si l’on veut que Schengen et la souveraineté aient un sens.
Comme vous l’avez mentionné, la Cour de justice européenne a infligé à la Hongrie une amende d’un million d’euros par jour pour avoir maintenu son système d’asile actuel et protégé ses frontières. Comment est-ce possible alors que l’approche européenne en matière de migration a elle-même changé ces dernières années ?
Szabolcs Janik : Oui, c’est une question juste et pertinente. L’UE dispose de sa propre cour, qui applique le droit européen. Dans ce cas, la Cour a jugé que la Hongrie avait violé les règlements de l’UE en matière d’asile, qui sont basés sur la Convention de Genève de 1951.
Du point de vue de Budapest, la logique était claire : il n’y avait pas de conflit armé actif dans les pays voisins – jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, une évolution à laquelle le gouvernement a immédiatement réagi par une législation – et donc aucun véritable réfugié n’arrivait de la région immédiate à l’époque. La Hongrie a donc limité la procédure d’asile à deux zones de transit jusqu’en 2020, puis à ses ambassades à l’étranger. Mais la Cour a considéré cette mesure, ainsi que d’autres, comme une restriction disproportionnée, ce qui a finalement abouti à l’amende quotidienne d’un million d’euros mentionnée ci-dessus.
C’est ridicule, car cette approche juridique ignore les dimensions sécuritaires. Les institutions européennes ont tendance à traiter cette question comme une question purement technique de droit, alors qu’en réalité, elle concerne également la souveraineté et la sécurité. Et le double standard est frappant. Tout récemment, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie avec le Premier ministre Donald Tusk et a fait l’éloge de la clôture qui y a été érigée, alors que la Hongrie a été condamnée pour avoir fait de même.

Szabolcs Janik
En fait, la Pologne fait-elle aujourd’hui ce que la Hongrie a fait en 2015 ?
Szabolcs Janik : À bien des égards, oui. Le gouvernement polonais a érigé une clôture et suspendu le droit de déposer une demande d’asile à certains points frontaliers ; les forces frontalières appréhendent tous les migrants, comme l’a fait la Hongrie. Pourtant, au lieu d’être critiqué, il est applaudi. Cela montre à quel point les réactions de l’UE peuvent être motivées par des considérations politiques. La politique migratoire n’est pas traitée de manière cohérente : ce qui est puni dans un cas est toléré, voire loué, dans un autre.
Pour en revenir au cas de la Hongrie, on peut débattre de ce à quoi devrait ressembler un système d’asile équitable ou de sa conformité avec la Convention de Genève, mais la réalité est que les personnes qui traversent la frontière depuis la Serbie ne fuient pas pour sauver leur vie. Continuer à attendre de la Hongrie qu’elle traite cette situation comme une crise purement humanitaire va à l’encontre d’une décennie d’expérience et de preuves, ce dont le gouvernement polonais a également pris conscience à sa propre frontière.
Sur le papier, les politiques et les déclarations de l’UE semblent admirables, mais dans la pratique, elles sont souvent déconnectées de la réalité, et la migration en est un exemple flagrant.
La Hongrie est également l’un des rares pays de l’UE à s’opposer au nouveau pacte sur les migrations. Pourquoi le gouvernement le critique-t-il autant ?
Szabolcs Janik : L’essence du nouveau pacte sur les migrations est de réformer les règles d’asile dans toute l’UE. Certaines parties sont plus réalistes que les propositions précédentes de la Commission, mais le cœur du problème reste le même : la solidarité obligatoire. Les États membres devront choisir entre trois options en cas d’urgence : accueillir les demandeurs d’asile relocalisés, verser des contributions financières à la place ou fournir une aide à la gestion des frontières.
L’idée d’aider par le biais de financements ou de main-d’œuvre est raisonnable, mais l’inclusion de la relocalisation obligatoire maintient la même logique problématique. Elle risque d’agir comme un aimant, encourageant les gens à tenter le voyage vers l’Europe, car ils savent qu’ils finiront par être admis et répartis entre les États membres de l’UE.
Le gouvernement hongrois estime que l’accent devrait être mis sur la protection des frontières extérieures de l’UE, et non sur la répartition des migrants. Et la réalité quotidienne dans plusieurs pays occidentaux – des sociétés parallèles à la hausse des taux de criminalité et à la forte dépendance à l’égard des systèmes de protection sociale – montre que l’intégration n’a pas été aussi réussie que beaucoup l’espéraient.
Nous assistons à un lent réveil dans certaines régions d’Europe, où les partis anti-immigration gagnent du terrain à mesure que les sociétés prennent conscience des défis à long terme posés par une migration incontrôlée. Il reste à voir si ces partis finiront par entrer au gouvernement, mais le résultat est clair : la migration reste une question non résolue en Europe.
Illustration : breizh-info.com (DR) et DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine








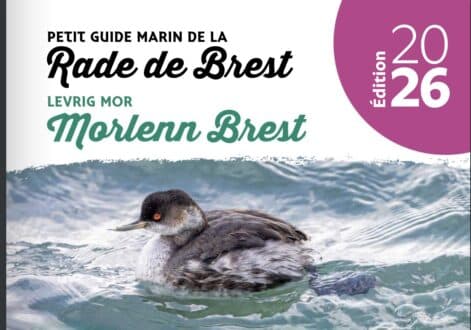





2 réponses à “SZabolcs Janik (MCC, Budapest) : « Protéger les frontières est la seule manière de sauver Schengen » [Interview]”
Quand on veut envoyer ballader Von der Leyen c’est possible mais il faut un certain courage ! Allo Mr Macron vous avez les félicitations de la DRH de l’Europe pour votre bonne conduite !
un pays sans frontière, sans monnaie, sans armée c’est le suicide assisté