Donald Trump et Vladimir Poutine devraient bientôt se rencontrer à Budapest pour discuter d’un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine. Derrière cette initiative, une fois encore, se trouve Viktor Orbán. Le Premier ministre hongrois apparaît désormais comme le seul chef d’État européen capable de parler à la fois à Moscou et à Washington — et de rappeler au Vieux Continent ses intérêts véritables.
L’annonce d’un futur sommet Trump-Poutine à Budapest – possiblement avec Zelensky – marque un tournant diplomatique majeur. Car si cette rencontre se concrétise, elle ne doit rien au hasard : Viktor Orbán, fidèle à sa ligne depuis février 2022, n’a jamais cédé à l’hystérie belliciste de Bruxelles ni aux injonctions morales de Washington.
Il a toujours plaidé pour la paix plutôt que pour l’escalade, pour le réalisme plutôt que l’idéologie. Et les faits lui donnent raison.
L’Ukraine est aujourd’hui exsangue, son armée à bout de souffle, son économie ruinée. L’Europe, elle, s’est appauvrie, tandis que les sanctions “punitives” contre la Russie se sont retournées contre ceux qui les ont décrétées.
Orbán, l’anti-idéologue
Contrairement à l’image véhiculée par les médias occidentaux, Orbán n’a aucune fascination pour la Russie. La mémoire de 1956 et de la répression soviétique reste vive en Hongrie.
Mais il refuse de se laisser aveugler par les bons sentiments ou les slogans moraux. Pour lui, la politique n’est pas affaire d’émotion, mais de rapport de forces. Et sur ce terrain, il sait que l’Europe n’a plus les moyens de sa rhétorique guerrière. Orbán n’est ni pro-russe ni anti-occidental. Il est pro-hongrois. Et c’est précisément ce que Bruxelles ne lui pardonne pas.
La guerre d’Ukraine a agi comme un révélateur : l’Occident n’est plus le centre de gravité du monde. Malgré les sanctions, la Russie n’a pas cédé.
Elle a réorganisé son économie, renforcé ses alliances et consolidé le bloc des BRICS, devenu une véritable alternative au G7.
Pendant ce temps, l’Europe s’enfonce dans la récession, étranglée par les prix de l’énergie et sa dépendance aux États-Unis.
Les armées européennes manquent d’hommes et de munitions, et leur autonomie stratégique relève du fantasme. Même les dirigeants européens, qui ont juré de “tenir jusqu’au bout” aux côtés de Kiev, savent que le front ne tiendra pas éternellement.
Trump, le pragmatique
À Washington, Donald Trump a compris que la poursuite du conflit ne sert plus les intérêts américains. Il se prépare à refermer le dossier ukrainien dès son retour à la Maison-Blanche.
Son vice-président pressenti, J.D. Vance, l’a rappelé lors de la conférence de Munich : « Quelle sécurité défendons-nous encore ? Et surtout, contre qui ? »
Son constat a glacé l’assistance : le véritable danger pour l’Europe n’est plus en Ukraine, mais à l’intérieur de ses frontières.
Perte de repères, fracture sociale, immigration incontrôlée : le continent se délite de l’intérieur pendant qu’il joue les va-t-en-guerre à l’Est.
C’est donc à Budapest, ville symbole de résistance et de souveraineté, que pourrait s’écrire le premier chapitre de la paix. Un comble pour les médias occidentaux, qui continuent de décrire la Hongrie comme un “régime illibéral” ou “autoritaire”.
Mais c’est justement ce pays honni des élites bruxelloises qui offre aujourd’hui un espace de dialogue entre les puissances, pendant que Paris et Berlin se débattent dans leurs crises internes. Et pendant que les donneurs de leçons s’indignent, Budapest demeure l’une des rares capitales d’Europe où les femmes peuvent encore marcher seules la nuit sans crainte — fait que peu de journalistes occidentaux relèvent.
Si la paix revient par la main de Trump, Poutine et Orbán, l’Histoire retiendra que ce sont les “parias” du système mondialiste qui auront mis fin à l’un des conflits les plus absurdes du XXIᵉ siècle. Le reste n’est que morale et posture.
“Les élites aboient, mais la caravane de l’Histoire avance.”
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



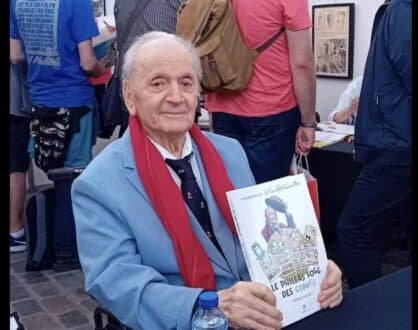










4 réponses à “Sommet de Budapest : Trump, Poutine et Orbán, les trois “méchants” qui pourraient ramener la paix en Europe”
Pardon, mais rien que le titre fait rire… 😂
Pardon, mais rien que le titre fait rire… 😂
heureusement qu’il y a des dirigeants comme Orban, surtout à l’Europe pour faire entendre avec les patriotes une autre vois, BRAVO MONSIEUR ORBANE.
BRAVO à ces trois Hommes !!!! Et au secours pour la FRANCE enlisée avec macronescu le fossoyeur …