Une nouvelle enquête révèle un constat massif et sans ambiguïté : 82 % des Français considèrent l’impôt sur la succession comme illégitime. Un rejet profond, qui s’accompagne pourtant d’un paradoxe : jamais la transmission du patrimoine n’a été aussi essentielle, et jamais elle n’a été aussi opaque au sein des familles.
Un rejet massif d’un impôt vécu comme une double peine
La taxation de l’héritage reste l’un des sujets les plus explosifs du débat fiscal français. Selon une étude menée par Yomoni auprès d’un millier de personnes, plus de huit Français sur dix jugent injuste que l’État prélève une part du patrimoine transmis.
Un sentiment partagé toutes catégories sociales confondues, qui traduit une fracture ancienne entre la vision étatique — l’héritage comme « reproduction des inégalités » — et la vision des familles — la transmission comme un droit naturel, fruit du travail d’une vie.
Cette opposition est d’autant plus forte que 73 % des Français réclament davantage d’informations pour pouvoir préparer sereinement leur succession. Le refus de l’impôt n’empêche pas la conscience des enjeux : il révèle une défiance grandissante envers une fiscalité jugée confiscatoire.
L’étude met en lumière une réalité méconnue : les familles parlent très peu de l’héritage. Les chiffres sont éloquents. Plus de la moitié des Français ignorent totalement le patrimoine de leurs parents, et 63 % discutent « presque jamais » ou « jamais » de transmission au sein du foyer.
Ce silence n’est pas anodin : il crée des conflits, des erreurs coûteuses, des déceptions. Et parfois des catastrophes juridiques lorsque des donations mal préparées ou des testaments imprécis déclenchent des années de procédures.
Le paradoxe français est là : dans un pays où l’État taxe fortement la succession, les familles, elles, s’y préparent très peu — par pudeur, par crainte du conflit, ou par méconnaissance totale des règles.
Une méconnaissance sidérante de la fiscalité successorale
Le chiffre est vertigineux : 52 % des Français n’ont aucune connaissance des règles fiscales encadrant les successions. Pas de maîtrise des abattements, peu de compréhension des régimes matrimoniaux, et une vision très confuse des dispositifs existants (assurance-vie, démembrement, donations).
Cette ignorance nourrit une situation paradoxale : ceux qui rejettent massivement l’impôt sur la succession ne savent pas comment l’éviter légalement — pourtant, les outils existent. Les notaires le répètent depuis des années : une succession bien préparée peut réduire fortement l’impact fiscal.
Encore faut-il oser en parler.
46 % des Français pensent qu’il faut anticiper la transmission avant 50 ans. À peine 42 % ont entrepris des démarches concrètes — testament, donation, clauses bénéficiaires. Une majorité remisera le sujet au lendemain, parfois jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Le principal obstacle reste l’absence d’information (51 %), suivie du coût perçu, de la complexité administrative, et d’une crainte bien française : l’éventualité de tensions familiales.
Derrière le sondage, une question civilisationnelle
La transmission du patrimoine ne concerne pas seulement l’argent : c’est un pilier de stabilité, de continuité, de mémoire familiale. Si les Français rejettent avec tant de force la fiscalité successorale, c’est aussi parce qu’ils y voient une intrusion de l’État dans la cellule familiale.
Préserver le logement familial (59 %), assurer l’équité entre les enfants (69 %), sécuriser juridiquement la volonté du défunt (55 %) : autant d’objectifs qui relèvent de la responsabilité des parents, non d’un pouvoir central méfiant envers tout ce qui ressemble à une autonomie patrimoniale.
Dans une France où les impôts et taxes s’accumulent — travail, énergie, transmission, consommation —, l’héritage apparaît comme la dernière frontière, celle que les Français ne veulent plus laisser franchir.
L’étude est limpide : 83 % des Français souhaitent réduire les droits de succession. Le message est sans ambiguïté, bien que depuis des années, les gouvernements successifs entretiennent l’idée que la taxation de l’héritage serait un instrument de « justice sociale ».
Dans les faits, elle pèse surtout sur les classes moyennes patrimoniales — celles qui ont travaillé dur, économisé, et veulent transmettre un bien, un terrain, une maison familiale.
C’est peut-être là que se joue le vrai débat : pas seulement sur la fiscalité, mais sur le rapport entre la famille et l’État, entre l’effort et la récompense, entre la mémoire et l’avenir.
Le sondage révèle une France lassée des ponctions, et décidée à défendre ce qui lui appartient.
*Méthodologie : enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 001 personnes représentatives de la population française en novembre 2025. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 600 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn). Réponses compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l’échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s’appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.












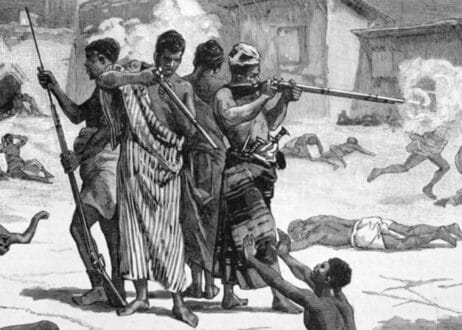

10 réponses à “Héritage et Succession : les Français se révoltent silencieusement contre un impôt jugé injuste adoré par LFI”
on travail toute notre vie pour laisser un peu de notre labeur et de nos privations pour laisser une aide à nos enfants, voila ces gauchos analphabètes et très cons, qui veulent encore taxer plus tous ces gens ! il faut les pendre haut et court !
tous nos gouvernant ne pensent qu’a taxer les personnes qui ont des bien ou de l’argent lors de leur décès je ne pense pas qu’ils les ont volé pas tous en tout cas bien souvent ils se sont privé toute leur vie pour avoir quel que chose à offrirent à leur décan dense peux partir en vacance sur des plage chaude pas de séjours au sommet des pistes travailler plus de 35 heure sans RTT avoir toujours remplie les caisse de l’état avec le payement des Impôts
Les droits de succession doivent être supprimés. Quand on a déjà payé l’impôt sur les revenus , ce qui reste est à nous, en toute liberté de transmettre comme il se doit.
Ces droits de succession impôt sont du racket, rien d’autre!
Oui ; outre la méconnaissance d’une fiscalité confiscatoire et des règles souvent complexes encadrant les successions (« maquis »), un élément de corset fiscal méconnu est le délai de paiement des droits de succession : c’est le seul délai que les héritiers et les notaires doivent respecter = 6 mois.
Ce délai a été fixé ainsi depuis longtemps, a priori pour obliger à la vente et faciliter la « rotation » rapide des biens à des prix « adaptés » (pour ne pas dire bas)> il est néanmoins effrayant. Vous devez vendre VITE le + souvent…(et pas toujours bien donc). Ensuite, si ce délai est dépassé, il y a toutefois des moyens (étalement impôt, faibles pénalités etc).
Ce délai devrait être porté à 8, 10 ou 12 mois selon les cas ou tranches de prix, ou bien passé à 1 an (12 mois) pour tous les biens, ce qui laisserait le temps de « souffler » aux héritiers !
Merci.
FJ
Pour parler concrètement, si je n’avais pas reçu l’héritage de mes parents, je serais mort de faim ou de froid comme étant à la rue.
355€ par mois ne permet pas de vivre ou même de survivre.
Le plus beau c’est qu’une partie du capital placé subit une impostion maximale avec une CSG majorée à 17,2%. Sans parler des droits de succession qu’il m’a fallu anticiper.
Tout ceci à cause du chômage subi lors de ma carrière professionnelle et des études longues.
L’ ultra gauche est contre tout ce qui est privé ! La propriété, les entreprises, les médias etc…ils veulent que tout soit régi par l’Etat comme dans les dictatures et l’idéologie mondialiste: » Ils n’auront rien et ils seront heureux ! Si une loi sortait sur cette corde sensible de l’ héritage des milliers de français seraient dans la rue et désobéiraient au fisc !
La Ripoublique c’est le racket, lorsque ce truc qui vous tomve sur la tête pour reprendre les termes de la platée de nouilles molles Yael Braun Pivet, hériter des parents racket, des collatéraux comme soeur la dose de sel augmente, pour une tante… »au secours ils sont fous »! Sachant que tous ces biens ont déjà été taxés à l’achat mais les salaires aussi!
Travailler plus et plus longtemps comme il est proposé avec le recul de l’âge de la retraite peut être supportable si au bout il y a un véritable intérêt qui va au delà de notre vie individuelle. La possibilité de mieux aider nos enfants ou petits enfants après notre mort transcende le simple intérêt matériel. Elle nous prolonge. Nous priver de cette possibilité par confiscation de nos épargnes à notre mort rend inutile tous les efforts qu’on accepte de consentir du temps de notre vivant. En jouant sur cette corde les amateurs du concours Lépine fiscal touchent à une corde sensible de notre civilisation.
Les questions d »héritage sont naturellement un sujet tabou dans les familles et il n’est pas toujours aisé d’en parler qu’on soit futur donateur ou futur héritier potentiel.
LA gauche déteste la propriété privé quelque soit sa forme, sont rêve est le collectivisme total , des familles s’entassant dans de petit appartement ou la cuisine et les sanitaires sont partager avec d’autres familles, pas de véhicule particulier, un contrôle étatique de ce que vous dépensez, de votre travaille, de vos déplacements autoriser par le services compétent.
Le rêve de cette gauche est une vie a la Nord Coréenne car même la vie façon Moscou ou Pékin est trop libérale pour eux.
De ce fait elle veux confisqué les biens accumulés pendant des années par les familles pour les transmettre de génération a génération.
Mon conseil que je donne au jeune est de quitter au plus ce pays au plus vite pour un pays qui respect ses habitants et ne les spolient pas de leur salaire, de leur bien.
tout ceci est d une telle complexité que seul les spécialistes s en tire au mieux et donc ceci est fait pour que les lambdas payent plein pot