Dans le premier papier, j’ai tenté de décrire la Chine telle que l‘ai comprises en visionnante des vidéos critiques du système communiste, comme un édifice dont les fondations se fissurent, démographie en berne, immobilier hypertrophié, comptes publics locaux en tension. Dans le second, le mal se révélait plus intime, un décrochage des âmes, cette jeunesse qui, faute d’horizon, préfère s’allonger plutôt que courir. Voici donc le troisième volet, celui où l’on observe ce qui devait sauver l’ensemble, la consommation intérieure, puis la réaction du pouvoir, et, au bout du chemin, le risque d’un géant blessé.
Longtemps, à New York comme à Pékin, on a chanté la même antienne, les usines ralentiront, soit, la Chine se retournera vers elle-même, et son immense classe moyenne prendra le relais. Sur le papier, l’idée a de l’allure. Qu’un milliard et demi d’hommes achètent un peu plus, et le monde trouvera une nouvelle source de croissance. Cette fable a bercé les banquiers, rassuré les industriels européens, et servi de décor à la “normalisation” de la Chine dans la mondialisation.
La réalité, si l’on en croit les récits que j’ai visionnés, est moins lyrique. Le consommateur chinois se dérobe. Le pays se heurte à ce qu’on pourrait appeler un piège de consommation, non par caprice, mais par structure. Les ménages y pèsent moins lourd dans la richesse nationale que dans les économies occidentales, et cela change tout. Un système où la famille doit financer de sa poche, ou presque, ce que l’État-providence prend ailleurs en charge, pousse naturellement à l’épargne de précaution. Le père de famille met de côté non pour spéculer, mais pour ne pas tomber.
Les Chinois évoquent trois montagnes, logement, éducation, santé. Le logement, nous l’avons vu, devient une boîte de béton qui coûte des décennies, et dont l’achèvement lui-même peut être incertain. L’éducation est un duel permanent, nourri par l’examen, par les cours privés, par la rivalité fébrile des familles. La santé, enfin, ressemble à une lame froide, car l’hôpital peut exiger des avances, et la couverture publique demeure inégale. Dans ces conditions, l’argent ne circule pas, il se cache, il se thésaurise comme on entasse du bois avant l’hiver.
Les confinements ont ajouté une cicatrice. L’Occident avait imaginé une “revanche” de la dépense après la levée des restrictions, une foule libérée se précipitant dans les restaurants, les magasins, les voyages. Le phénomène inverse a dominé, une revanche de l’épargne. Quand l’État peut verrouiller des quartiers entiers, quand le travail et les revenus deviennent réversibles, on apprend à serrer le poing sur ses billets. Une économie de confiance se mue en économie de crainte.
La crainte a un nom technique, déflation. Elle est insidieuse parce qu’elle persuade chacun d’attendre. Pourquoi acheter aujourd’hui ce qui sera moins cher demain, pourquoi investir quand le prix de vente baisse, pourquoi embaucher quand la demande se dérobe. Le cercle se referme, l’entreprise réduit ses marges, licencie, et la prudence des ménages se justifie après coup. Le Japon a connu ce brouillard durant des décennies. La Chine, dans cette lecture, y glisse à son tour, avec la différence qu’elle vieillit plus vite, et qu’elle n’est pas encore entrée dans la pleine richesse.
À ce ralentissement répond un changement des usages. Les marques prestigieuses perdent de leur éclat, le “premium” s’efface, la substitution bon marché gagne. Le succès d’applications de rabais et de prix cassés, au lieu d’être un signe d’ascension, devient le symptôme d’un pays qui, en bas, compte ses sous. L’économie qui devait “monter en gamme” découvre la pente inverse.
Le pouvoir pourrait, en théorie, soutenir directement les ménages. Les États-Unis, lors de la pandémie, ont pratiqué les chèques envoyés aux familles, avec leurs défauts et leurs excès. La Chine, selon ces vidéos, répugne à ce geste, qu’elle juge moralement suspect, trop proche d’une assistance qui encouragerait l’oisiveté. Elle préfère injecter dans l’offre, dans l’usine, dans l’infrastructure. On construit encore, on produit encore, on multiplie les véhicules électriques, les panneaux solaires, les batteries, parfois au-delà de l’absorption intérieure. Les surplus cherchent alors des débouchés au-dehors, et heurtent les défenses commerciales européennes et américaines. Un pays qui n’arrive pas à faire consommer ses ménages finit par exporter ses excédents, et ses tensions.
Ce choix, de l’offre plutôt que de la demande, conduit à un autre nœud, le rapport du régime à l’initiative privée. La Chine a connu, entre 2010 et 2020, une décennie d’audace commerciale et technologique. Des plateformes ont simplifié la vie quotidienne à un point que beaucoup d’Européens n’imaginent pas. Cette effervescence, pourtant, a effrayé le Parti. Trop d’influence, trop de données, trop de pouvoir non politique concentré dans des mains qui n’étaient pas celles de l’appareil.
L’affaire Jack Ma, telle qu’elle est racontée, résume ce tournant. Un entrepreneur brillant, devenu visage de la Chine moderne, prononce un discours trop libre, critique des régulateurs, et l’appareil abat le couperet. Une introduction en bourse gigantesque est suspendue, l’homme disparaît, puis revient amaigri, discret, presque effacé. Le signal est entendu. Réussir trop fort, c’est attirer l’ombre. Dès lors, le secteur privé, pourtant essentiel à l’emploi urbain et à l’innovation, marche sur des œufs. La prudence politique supplante l’audace économique.
Le mécanisme se raffine avec ces “actions dorées”, petites participations de l’État qui donnent un droit de regard, un siège, parfois un veto. L’entreprise demeure privée dans la forme, mais publique dans l’âme. Il en résulte un froid. Les entrepreneurs ne cherchent plus la lumière. Ils se réfugient dans les secteurs jugés “utiles” au pouvoir, semi-conducteurs, défense, industrie lourde, et évitent les domaines où le public, la culture, l’opinion pourraient s’agglomérer. Or l’innovation, par nature, naît dans le désordre, dans la transgression, dans l’idée imprévue. On ne la commande pas comme un pont.
Quand l’air se raréfie, les pieds bougent. Le récit insiste sur un phénomène qui, à lui seul, vaut baromètre, la fuite des capitaux et des talents. Les riches s’exilent, les cadres cherchent des issues, Singapour, Tokyo, parfois l’Occident. Le mot même de “science du départ” circule. Un système de contrôle des changes limite les transferts. Alors on invente, on fractionne, on contourne, on achète des biens, on passe par des intermédiaires. Dans la France d’autrefois, on appelait cela une évasion. Le terme moderne est plus élégant, la mobilité. L’effet est le même, la sève s’écoule.
Plus poignant, certains de ceux qui ne sont pas riches tentent la route longue, celle des visas faciles et des traversées à pied, jusqu’à des frontières lointaines. On ne quitte pas un pays par jungle et désert pour le plaisir de voyager. On le fait parce qu’on ne croit plus au lendemain. Là encore, la façade brille, la réalité pousse à partir.
Sur cette toile se dessine le piège du revenu intermédiaire. Passer de la pauvreté à l’atelier est relativement simple, on transfère des paysans vers des usines, la productivité grimpe. Passer de l’atelier à la haute technologie, à l’économie de la connaissance, est une autre affaire. Quelques pays asiatiques y sont parvenus, beaucoup s’y sont cassé les dents. La Chine possède des vitrines futuristes, des villes de premier rang, des laboratoires, des champions industriels. Elle porte aussi, selon ces analyses, un hinterland immense, rural, inégalement formé, et un système administratif, le hukou, qui maintient une hiérarchie de citoyennetés entre ville et campagne. Un pays ne devient pas une puissance d’innovation de masse si une part trop large de sa main-d’œuvre s’arrête tôt dans les études, ou si des millions d’enfants grandissent loin des écoles urbaines, laissés aux grands-parents.
Quand l’ascension ralentit, la légitimité se cherche ailleurs. Carl Schmitt rappelait, avec une brutalité de scalpel, que la politique vit de la distinction de l’ami et de l’ennemi. Un régime qui ne peut plus promettre l’enrichissement peut être tenté de promettre la grandeur, et, faute de pain, d’offrir des drapeaux. C’est ici que surgit la question de Taïwan, non comme simple dossier diplomatique, mais comme possible dérivation d’un malaise intérieur.
L’idée d’une guerre de diversion hante l’histoire. Les nations qui sentent leur fenêtre se fermer deviennent nerveuses. Une puissance montante peut attendre, une puissance qui pense avoir atteint son sommet peut être pressée d’agir. Taïwan, dans cette lecture, est un nœud stratégique et symbolique. Stratégique parce qu’elle s’inscrit dans un arc maritime qui conditionne les accès au Pacifique. Symbolique parce que l’unification sert de sceau historique à un chef. À cela s’ajoute le détail qui fait trembler les comptables du monde entier, les semi-conducteurs avancés produits en proportion écrasante sur l’île, ces carrés d’argent minuscules dont dépend l’automobile, l’électronique, une part de la médecine, et jusqu’aux systèmes militaires occidentaux.
Or, l’Occident, déjà, mène une guerre sans fumée, celle des exportations technologiques. Les contrôles américains sur les puces et les machines de lithographie, et les pressions exercées sur certains alliés, dressent un rideau de silicium. La Chine s’efforce de reconstruire une chaîne domestique, avec des succès partiels, coûteux, moins efficaces. Un pays peut réussir une prouesse ponctuelle, sortir un téléphone, prouver une capacité. Construire un écosystème complet, au même rythme que les leaders mondiaux, est une autre montagne. L’écart technologique, plutôt que se fermer, peut se déplacer, et s’approfondir, surtout si l’accès aux talents étrangers et aux outils critiques se resserre.
Dans ce contexte, les grands projets extérieurs, comme les routes de la soie, changent de couleur. Présentées naguère comme une générosité stratégique, elles peuvent apparaître, rétrospectivement, comme des prêts risqués à des États fragiles, générateurs de ressentiment local et de contentieux. Quand les finances se tendent à domicile, prêter au loin devient politiquement délicat. Quand les débiteurs peinent à rembourser, le créancier doit choisir, renoncer, saisir, ou refinancer. La route se transforme en chaîne.
Parallèlement, le régime perfectionne son filet intérieur. Une surveillance diffuse, capillaire, où caméras, données, listes et restrictions tissent une vie sous regard. L’objectif n’est pas seulement de punir, mais de prévenir, d’éteindre les braises avant la flamme. Cette sophistication, si elle impressionne, a son revers. Un pays où l’on surveille tout peut finir par étouffer ce qu’il a de plus précieux, la confiance spontanée, l’imagination, la franchise qui remonte du réel vers le sommet. Les bureaucraties aiment les chiffres. Elles aiment aussi les chiffres qui rassurent. Quand les échelons locaux maquillent les données par peur, la machine se nourrit d’illusions, et la surprise surgit quand même, plus brutale.
Il reste une vulnérabilité primitive, que ni caméras ni algorithmes ne guérissent, nourrir et énergiser le pays. La Chine, très peuplée, dispose d’une part limitée de terres arables, et l’industrialisation a dégradé des sols. Elle importe massivement. Pour l’énergie, les routes maritimes passent par des goulets, détroits, points d’étranglement. Une puissance dépendante de ces flux vit avec une angoisse stratégique. Elle cherche des contournements, pipelines, ports, alliances. Elle devient plus âpre dans son voisinage maritime, plus agressive dans des mers disputées. L’insécurité matérielle engendre une nervosité géopolitique.
Sur la scène internationale, cette nervosité a pris une forme de diplomatie rugueuse, dite des “loups guerriers”, qui flatte le public intérieur tout en braquant l’extérieur. Le résultat, si l’on suit ce récit, est un isolement relatif, l’Occident se crispe, des pays basculent vers des alliances de précaution, et Pékin se retrouve avec des partenaires souvent sanctionnés ou instables. L’erreur classique est celle de l’écho, on parle fort dans une salle où l’on n’est plus écouté, et l’on prend son propre bruit pour une victoire.
Au bout de ce chemin, apparaît une figure inquiétante, celle du géant blessé. Beaucoup, en Europe, commettent deux fautes symétriques. La première est de croire à la toute-puissance chinoise comme à une mécanique inexorable. La seconde est de se réjouir trop vite d’un affaiblissement annoncé. Une Chine ralentie n’est pas forcément une Chine paisible. Une Chine fragilisée peut devenir imprévisible. Un effondrement brutal, s’il survenait, ne ressemblerait pas à un défilé joyeux, il pourrait ressembler au vide, aux luttes internes, aux ruptures d’approvisionnement, et à des migrations d’échelle inouïe. Là encore, la façade rassure, la réalité inquiète.
C’est ici que l’Europe doit se regarder, non par masochisme, mais par lucidité. À bien des égards, notre continent partage, à sa manière, certaines lignes de fatigue, vieillissement, dénatalité, goût de la rente, bureaucratie tentaculaire, et, surtout, une difficulté à faire coïncider l’apparence de prospérité avec la robustesse réelle des fondations. La Chine a ses tours vides, l’Europe a ses usines fermées. La Chine a ses jeunes qui “s’allongent”, l’Europe a ses jeunesses qui doutent, et parfois se dérobent à l’effort commun, chacune pour des raisons différentes. La Chine compense par le contrôle, l’Europe compense par la norme. Dans les deux cas, l’instinct est de gérer, de réguler, de tenir, plutôt que de refonder.
Nous avons, en Bretagne, une expression rude, tenir la mer. Tenir la mer, ce n’est pas faire briller la coque, c’est savoir si la quille tiendra quand le grain viendra. L’Europe a longtemps vécu de l’illusion que le commerce suffisait à pacifier, et que l’abondance mondiale durerait toujours. La Chine a vécu de l’illusion que la croissance effaçait tout, et que l’autorité pouvait remplacer la confiance. Deux théâtres d’ombres, chacun avec ses décors, ses slogans, ses éclairages. Quand le vent tourne, les étoffes claquent.
La comparaison impose une conclusion moins spectaculaire qu’un appel au fracas. Si la Chine se durcit et cherche au-dehors une solution à ses impasses, l’Europe devra comprendre qu’elle ne peut plus être seulement un marché. Elle devra choisir ce qu’elle veut être, un espace de consommation protégé par d’autres, ou une puissance adulte, capable de défendre ses intérêts, de sécuriser ses approvisionnements, de protéger sa base industrielle, et de penser la démographie sans pudeurs factices. La Chine, même fragilisée, demeure un fait massif. L’Europe, même riche, demeure vulnérable si elle confond confort et puissance. Entre la façade et la réalité, la mer finit toujours par trancher.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]
Photo d’illustration : DR
[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.
Breizh-info.com, 2026, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine.




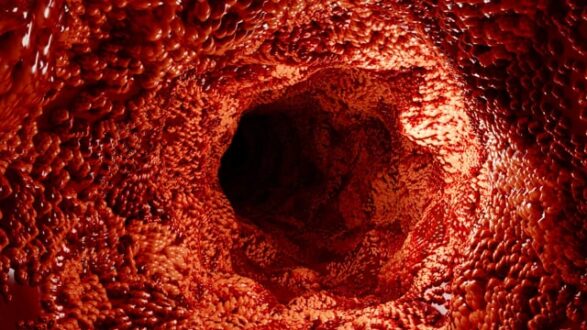




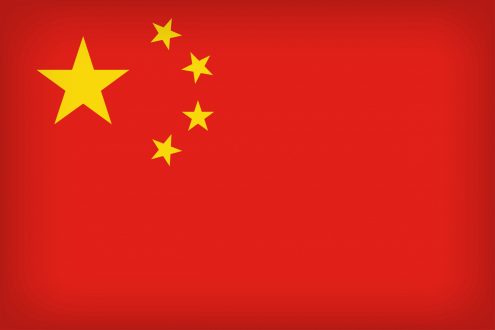

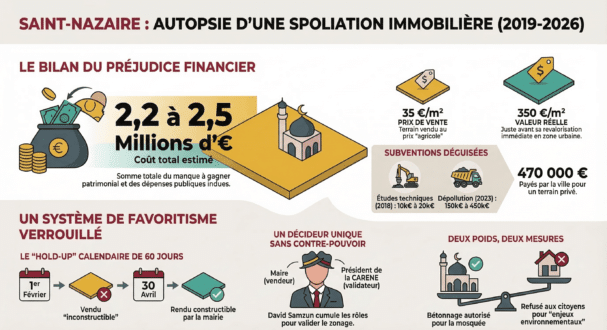


2 réponses à “Derrière la façade chinoise, le piège, et l’Europe face à elle-même – Partie 3”
Excellente analyse sans compromis qui colle à la réalité…on nous promettait le mondialisme heureux, une Chine à la croissance illimitée, une dictature pleine de succès économiques ( ce qui est rare ) et on assiste à l’image d’un géant aux pieds d’argile comme chantait Renaud. A trop vouloir transformer le citoyen en un consommateur docile et exploitable à merci, on a instillé des pensées de » survie » qui vont à l’encontre des « programmes » imaginés par le pouvoir autoritaire.
L’Europe, l’Europe… Pauvre Europe ! Pauvre Union européenne ! Je pense au mot cruel de Bismarck au sujet de la Confédération germanique : « Oh Bund, du Hund, du bist nicht gesund ! » (Ô Union, chienne, tu n’es pas en bonne santé ! »