Historien de formation, chroniqueur et analyste politique au style incisif, Dominic Green observe depuis des années le déclin des libertés publiques en Europe comme aux États-Unis. Spécialiste des rapports entre politique et religion dans les sociétés libérales, il alerte sur la montée d’un « autoritarisme doux », qui restreint progressivement la liberté d’expression, étouffe la critique démocratique et criminalise les dissidents tout en épargnant la criminalité réelle.
À l’occasion d’un long entretien accordé à Breizh-info.com, Dominic Green revient sur la dérive des régimes occidentaux, la complicité objective entre islamisme et wokisme, l’échec du multiculturalisme en Europe, mais aussi sur les espoirs de renversement de tendance par les urnes — tant qu’elles sont encore libres.
Loin des discours convenus, il dresse un constat lucide et sans concession sur l’évolution de nos sociétés, où l’opinion majoritaire est désormais jugée illégitime, et où la répression du langage est devenue un substitut à l’incapacité politique. Une parole rare et précieuse dans un paysage médiatique verrouillé.

Breizh-info.com : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Dominic Green : Je suis historien de formation et écrivain par habitude. Je me spécialise dans les relations entre religion et politique dans les sociétés libérales, y compris les empires. Je suis devenu chroniqueur parce que je trouve notre présent bien plus intéressant que le passé à bien des égards.
Breizh-info.com : Monsieur Green, vous écrivez souvent sur le déclin de la liberté d’expression en Europe. Comment décririez-vous l’état actuel de la liberté d’expression dans les démocraties occidentales ?
Dominic Green : La plupart des indicateurs sont négatifs, mais il y a aussi des signes positifs. En Europe, la méfiance traditionnelle à l’égard de la liberté d’expression est ravivée par l’Union européenne, hostile à la responsabilité démocratique, et par les gouvernements nationaux qui, on le comprend, craignent les critiques de la majorité. La Grande-Bretagne ne fait pas exception à cet égard. Mais parce que la liberté d’expression est si essentielle à notre liberté, de plus en plus de personnes s’expriment librement sur cette question.
Aux États-Unis, nous avons récemment assisté à une collusion entre des agences gouvernementales, de grands médias d’information et de télévision et des entreprises de médias sociaux pour étouffer et orienter le débat. Mais nous constatons également une opposition généralisée à cette tendance. À cet égard, le rachat de Twitter (aujourd’hui X) par Elon Musk et sa décision de divulguer les « Twitter files » ont constitué des tournants et des raisons d’être optimiste.
Breizh-info.com : À votre avis, quand ce glissement vers une plus grande censure a-t-il réellement commencé ? A-t-il été progressif ou déclenché par des événements spécifiques ?
Dominic Green : Il s’agit d’un glissement progressif, marqué par la tentative de gérer la réaction du public à des événements spécifiques (terrorisme de masse, crise migratoire qui a suivi la guerre civile syrienne, succès électoral des partis anti-UE et anti-immigration). Le consensus de l’après-guerre froide sur le sens et l’avenir des sociétés européennes, et des États-Unis également, s’est progressivement effrité. La crise financière de 2008 et la crise de la zone euro qui a suivi ont inauguré une ère de faible croissance dans les sociétés à forte immigration. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le Brexit et la première présidence Trump ont marqué le début d’un changement classique dans le monde anglophone : une révolution discrète, gérée constitutionnellement. Depuis lors, nous sommes entrés dans une « crise permanente » caractérisée par des défis constants et interdépendants que les gouvernements semblent incapables de gérer ou de résoudre. Une gouvernance stable nécessite donc la suppression des objections plutôt que la résolution des problèmes, dont beaucoup dépassent les pouvoirs des gouvernements libéraux.
Breizh-info.com : Des cas récents, tels que l’emprisonnement de Tommy Robinson ou l’interdiction d’entrée au Royaume-Uni de Renaud Camus, semblent montrer que les gouvernements occidentaux ciblent de plus en plus les dissidents plutôt que les criminels. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Dominic Green : En Grande-Bretagne, les gouvernements parlent désormais de « résultats concrets », comme si le rôle du gouvernement consistait à fournir des services aux consommateurs. Envoyer des personnalités médiatiques dissidentes en prison est au moins une tâche qui peut être accomplie et qui permet au gouvernement de revendiquer une certaine compétence. Contrôler la criminalité de masse, y compris la fraude à l’immigration et aux systèmes sociaux, est beaucoup plus difficile, voire impossible pour l’État tel qu’il se conçoit actuellement. Cela suffit à inciter à poursuivre les discours plutôt que les actes. Et si l’État est incapable de « fournir » les « services » fondamentaux, à savoir la garantie de la sécurité et de l’État de droit, il utilisera bien sûr ces pouvoirs pour assimiler la sécurité et la légalité à la réduction des droits de ses détracteurs les plus virulents.
Les affaires Robinson et Camus soulèvent des questions différentes. M. Robinson a révélé l’identité des suspects lors d’un procès contre un « gang de proxénètes ». Cela était illégal et aurait pu compromettre les poursuites contre des criminels dangereux. Il a été reconnu coupable d’« outrage à la cour ». Il est actuellement détenu à l’isolement, car les services pénitentiaires ne peuvent garantir sa sécurité autrement.
Cela soulève deux questions. Était-il nécessaire d’emprisonner M. Robinson pour une infraction non violente, plutôt que, par exemple, de lui infliger une amende ou de le placer en résidence surveillée, comme le système britannique préfère le faire avec les délinquants non violents ? Et l’isolement cellulaire, qui est la mesure la plus sévère, est-il approprié dans ce cas ? Il subit une punition cruelle non pas à cause de ce qu’il a fait, mais parce que l’État qui a choisi de l’emprisonner ne peut pas contrôler ses propres prisons.
Le cas de M. Camus est différent. Un ressortissant étranger n’a pas automatiquement le droit d’entrer au Royaume-Uni. L’entrée est laissée à la discrétion du ministère de l’Intérieur. Nous devons donc demander une explication de cette décision bureaucratique. Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore expliqué son raisonnement. Mais comme tout le monde constate l’application inégale de son pouvoir discrétionnaire, nous aboutissons au même problème que dans l’affaire Robinson : l’application inégale de la loi à des fins politiques.
Ces affaires illustrent la « justice à deux vitesses » que le gouvernement britannique affirme ne pas pratiquer.
Breizh-info.com : Est-il encore exact de qualifier la Grande-Bretagne de berceau de la liberté d’expression, compte tenu du traitement réservé aujourd’hui aux écrivains et aux dissidents politiques ?
Dominic Green : La Grande-Bretagne reste le berceau historique de la liberté d’expression. Mais les États-Unis en sont le principal défenseur depuis l’entrée en vigueur du premier amendement. Cela ne signifie pas que les discours « politiquement incorrects » ne font pas l’objet d’autres sanctions sociales ou autres aux États-Unis. C’est évidemment le cas : il suffit de voir le radicalisme étroit des universités américaines, où l’on a moins de chances de rencontrer un libéral classique, et encore moins un conservateur, dans les facultés de lettres et sciences humaines qu’en Grande-Bretagne.
Breizh-info.com : De nombreuses lois sur les « discours de haine » semblent être utilisées principalement pour réprimer certaines opinions politiques. Pensez-vous que le concept même de « discours de haine » soit incompatible avec la véritable liberté d’expression ?
Dominic Green : En tant que bi-national ayant vécu aux États-Unis pendant 20 ans (et travaillé dans des universités américaines qui ont tenté de restreindre le premier amendement et d’instaurer des lois sur les « discours haineux » à l’européenne), je ne peux qu’être d’accord. Il existe des discours de haine, mais les entendre est le prix à payer pour vivre dans une société libre. Il existe aussi des discours stupides, mais nous ne conditionnerions jamais le droit à la liberté d’expression à l’intelligence ou à la compassion d’une personne.
Breizh-info.com : En France, le harcèlement judiciaire à l’encontre des dissidents politiques et des lanceurs d’alerte s’intensifie. Diriez-vous que les démocraties européennes évoluent lentement vers des régimes « autoritaires doux » ?
Dominic Green : Si l’on examine l’histoire de l’Union européenne et la manière dont son processus législatif est conçu, on pourrait conclure que cela a toujours été l’objectif. La conclusion tirée de l’échec de la démocratie libérale en Europe dans les années 1920 et 1930, et des atrocités qui ont suivi, était qu’on ne pouvait pas faire confiance aux électeurs. Le système français à deux tours pour l’élection présidentielle a été conçu dans le même esprit. Le système britannique et américain du « first-past-the-post » est plus ancien, mais il contribue également à réduire l’impact de l’opinion populaire. L’autorité doit toujours trouver un moyen de se constituer.
C’est lorsque la légitimité de cette autorité constituée s’effondre aux yeux du public que « l’autoritarisme doux » devient un instrument utile. Les canaux par lesquels l’opinion publique se traduit en autorité constituée fonctionnent à l’envers : au lieu de transmettre l’opinion du peuple à la chambre élue, ils transmettent l’opinion de la chambre au peuple. Au lieu de leur dire comment nous voulons vivre, ils nous disent comment ils veulent que nous pensions et que nous parlions.
Je note que le contrôle « autoritaire modéré » du discours n’est pas seulement un phénomène propre aux sociétés à forte immigration d’Europe occidentale. C’est également un problème dans des pays à faible immigration comme la Hongrie, par exemple. En général, cependant, plus le gouvernement est technocratique et libéral, plus les conséquences imprévues du libéralisme technocratique sont importantes, et plus le recours à l’« autoritarisme modéré » comme stratégie de gestion est important.
Breizh-info.com : Dans votre analyse des sociétés parallèles islamistes en Grande-Bretagne, vous mentionnez que les autorités britanniques se soucient davantage de contrôler la réaction de la majorité que de s’attaquer aux groupes radicaux eux-mêmes. Selon vous, ce schéma est-il similaire dans toute l’Europe ?
Dominic Green : Nous observons la même réaction en Scandinavie et dans les pays d’Europe occidentale. Nous ne constatons pas cette réaction dans les pays d’Europe de l’Est à faible immigration. Le schéma n’est donc pas similaire dans toute l’Europe. Nous observons deux modèles, chacun étroitement lié aux niveaux d’immigration, à la montée des coutumes non traditionnelles et des sociétés parallèles, ainsi qu’au niveau de menace du terrorisme islamiste. Il s’agit là de réalités politiques et sociales quantifiables.
Breizh-info.com : Pensez-vous que le multiculturalisme, tel qu’il avait été initialement imaginé, a échoué en Europe ? Si oui, est-il encore possible d’inverser la tendance ?
Dominic Green : Après 1996, Tony Blair et le gouvernement travailliste ont tenté de redéfinir la Grande-Bretagne comme un collectif de communautés raciales ou religieuses (quelque chose qui s’apparente à ce que les Français appellent le communautarisme). Cette tentative a échoué pour deux raisons, quantitative et qualitative. L’augmentation du nombre de nouveaux immigrants a ralenti le rythme de l’intégration, entraînant une balkanisation. Dans ce contexte, la qualité des immigrants est devenue cruciale. Les musulmans pakistanais, en particulier, ont eu du mal à s’adapter et à s’intégrer à la société libérale britannique.
Cela ne signifie toutefois pas que le passage d’une société monoculturelle à une société pluraliste ait échoué en Grande-Bretagne. Le concept du Royaume-Uni est pluraliste : quatre nations sous une seule administration. Cela ressemble au nationalisme civique des États-Unis et offre de plus larges possibilités d’intégration que le modèle monoculturel de la Suède, par exemple.
En Grande-Bretagne, de nombreux groupes se sont exceptionnellement bien intégrés et sont exemplaires dans leur attachement au mode de vie britannique, avec une forte culture familiale, un niveau d’éducation et de contribution fiscale supérieur à la moyenne, un taux de criminalité inférieur à la moyenne et de nombreuses discussions sur la météo. Les dirigeants récents du Parti conservateur sont tous issus de l’immigration : Rishi Sunak, Sajid Javid, Kemi Badenoch, Priti Patel, Suella Braverman.
Je ne constate pas le même niveau d’intégration dans les autres pays d’Europe occidentale. Le multiculturalisme y a également échoué. C’est aux citoyens de chaque pays de décider s’ils souhaitent adopter le pluralisme britannique comme moyen d’intégrer leurs immigrants, ou une autre approche. Quoi qu’il en soit, cette méthode ne fonctionnera que si la majorité démocratique l’approuve.
Breizh-info.com : Vous avez écrit que ce que l’on décrit souvent comme la « diversité » est en réalité devenue une nouvelle monoculture impulsée par l’islam radical. Pourriez-vous développer ce paradoxe ?
Dominic Green : Le multiculturalisme a transformé les politiques britannique et française en en une compétition ethnique à l’américaine. Aux yeux des bureaucraties gouvernementales, de la police et des candidats à des fonctions électives, l’électeur n’est plus un individu autonome, mais un membre d’un collectif. Il en résulte des alliances électorales entre un parti politique et les groupes ethniques qu’il favorise : l’un des modèles classiques du clientélisme dans les démocraties. Ainsi, en Grande-Bretagne, le Parti travailliste est devenu le parti des électeurs musulmans, et les conservateurs celui des électeurs hindous.
Une autre conséquence est que les institutions de l’État, qui sont censées être neutres, peuvent également se remodeler autour de ces alliances politiques et être à leur tour remodelées par leur tentative de gérer et d’intégrer les immigrants non pas en tant qu’individus, mais en tant que membres de collectifs. Cela conduit l’État à encourager la politique identitaire, puis à adopter les valeurs des groupes favorisés, mais aussi craints.
Dans le cas britannique, la peur est devenue un facteur plus important que la faveur. Le Parti travailliste craint de perdre les électeurs musulmans au profit de candidats indépendants radicalement sectaires, comme cela s’est produit lors des élections de 2024. La bureaucratie, la police et les services de sécurité craignent, à juste titre, le développement d’une violence islamiste ingérable. Selon les services de sécurité, les musulmans, qui ne représentaient que 6 % des sujets britanniques lors du dernier recensement, constituent jusqu’à 75 % des cas de surveillance terroriste active. Il n’est donc pas surprenant que l’État cherche à apaiser ce défi par des compromis. Mais ces compromis affectent tout le monde, y compris les musulmans qui souhaiteraient s’intégrer mais qui sont en fait pris en otages par leurs propres communautés, avec l’approbation du gouvernement.
On pourrait dire que la culture du discours de tout État qui fonctionne est monoculturelle : la loi est censée être la même pour tous et les coutumes universellement comprises. C’est la nature même de la monoculture étatique qui est en train de changer, sans que la majorité démocratique ait été consultée au préalable.
Breizh-info.com : Dans quelle mesure attribueriez-vous la crise actuelle des sociétés occidentales à la lâcheté politique et dans quelle mesure à des changements culturels et démographiques plus profonds ?
Dominic Green : Cette crise n’est pas le fruit d’un plan délibéré, et certainement pas d’une conspiration, mais de l’ambition, de l’erreur et de l’arrogance. Les gouvernements des années 1950 et 1960 pensaient que l’immigration était bonne pour l’économie. Ils n’ont jamais envisagé ce qui pourrait se passer dans 20 ou 50 ans. Ils n’ont pas compris que l’immigration contrôlée des premières décennies après 1945 était la première vague d’un changement mondial, dans lequel les communications modernes ont donné aux sociétés en expansion démographique et économiquement appauvries l’image de l’émigration et les moyens de la réaliser. Les dirigeants européens pensaient que l’expérience européenne de la sécularisation était l’avenir imminent de tous, tout comme l’expérience de l’empire européanisé avait été le passé récent de tous.
Il est rapidement apparu qu’ils avaient tort, dès les années 1970 dans certains cas. Ce n’est pas seulement la lâcheté qui a conduit les gouvernements à nier cette réalité pendant des décennies et à stigmatiser ceux qui la décrivaient et mettaient en garde contre l’effondrement imminent du contrat social. C’était aussi dû à des changements culturels au sein des États libéraux occidentaux. Le christianisme était en déclin. Le PIB devenait la mesure de la valeur d’un gouvernement. L’incapacité à assumer l’entière responsabilité et les conséquences éthiques du génocide des Juifs d’Europe – un crime auquel tous les membres de toutes les nations européennes ont participé avec enthousiasme – a conduit à un vide moral. Ces facteurs ont créé un vide religieux, culturel et éthique dans la sphère publique, et la nature a horreur du vide.
Breizh-info.com : Vous avez récemment déclaré que la Grande-Bretagne ne devait pas encore être considérée comme perdue, malgré les tensions croissantes. Que faudrait-il pour que les sociétés occidentales évitent un conflit civil ?
Dominic Green : Le contrat social britannique a déjà été rompu et réparé par le passé. Le gouvernement conserve des pouvoirs étendus. Le système parlementaire continue de fonctionner. La grande majorité de la population ne souhaite pas voir sa société se transformer en une société marquée par une faible confiance et une forte criminalité, dirigée selon des lignes sectaires. Dans ces circonstances, il est tout à fait possible de remettre l’État au service de la majorité démocratique. C’est également la seule alternative à un conflit civil.
Quant à ce qui est nécessaire, les premières mesures sont assez évidentes. Élire des politiciens qui promettent de réparer les dégâts. Rétablir l’ordre public, la neutralité des tribunaux et de la police, et restaurer la culture de la liberté d’expression. Annuler la culture politico-juridique inconstitutionnelle des « relations communautaires ». Renforcer les contrôles aux frontières, expulser les immigrants illégaux et les ressortissants étrangers qui commettent des crimes, et être prêts à abandonner ou à modifier vos engagements envers les conventions internationales afin d’y parvenir.
Ce sont là les fondements. Ensuite, nous serons confrontés à un défi plus complexe. Nous devrons offrir un idéal positif de citoyenneté aux millions de personnes qui sont les enfants d’immigrés, qui sont nées citoyennes de notre pays et qui, dans la grande majorité des cas, n’ont commis aucun crime. Comme je l’ai dit plus haut, c’est à chaque nation d’en décider. Mais ces décisions doivent être prises rapidement, car nos sociétés deviennent ingérables et insoutenables sur leur lancée actuelle.
Tout cela vaut pour la France comme pour n’importe quel autre pays européen. Je dois mentionner ici que si l’Union européenne est l’instance chargée de faire respecter les pouvoirs juridiques et les changements culturels que je décris, alors la souveraineté restante de la France et les droits restants du peuple français seront nécessairement dissous dans le processus. Les Britanniques ne sont plus confrontés à ce problème : ils sont désormais confrontés au problème de la reconstitution de la souveraineté et de la responsabilité démocratique.
Quant aux autres aspects spécifiques du cas britannique, les Britanniques sont atypiques. La structure du Royaume-Uni et l’exportation de notre modèle politique à travers l’empire ont fait des Britanniques un peuple cosmopolite avant même l’ère de la migration post-impériale. Nous assistons aujourd’hui à la renaissance de l’identité historique dans les nations membres du Royaume-Uni. Les Anglais, de loin la plus grande des quatre nations, émergent comme une identité politique. La dernière étape du retrait impérial sera peut-être la dissolution du Royaume-Uni et le retour de la souveraineté anglaise. La crise de l’immigration et de l’islamisme a clairement accéléré ces processus.
En 2016, les Anglais et les Gallois ont voté pour reprendre le contrôle de leur souveraineté. (Les Écossais et les Irlandais du Nord ont voté pour rester dans l’UE. C’est un autre facteur qui accélère la désintégration du Royaume-Uni). Les Anglais écrivent aujourd’hui un nouveau chapitre de leur histoire. L’avenir est toujours incertain, mais un peuple qui aime sa liberté ne peut être écarté.
Breizh-info.com : Pensez-vous qu’une réaction publique majeure contre la censure et l’érosion des libertés civiles est inévitable ? Si oui, quelle forme pourrait-elle prendre ?
Dominic Green : Cette réaction est déjà en cours, tout comme les tentatives pour la contrôler et la bloquer. La dialectique de la protestation et de la répression a créé une phase instable dans laquelle la légitimité de l’État est remise en question. Je n’ai pas besoin de rappeler aux lecteurs français ce qui peut arriver à l’État dans une telle situation, surtout lorsque celui-ci est déjà en crise budgétaire quasi permanente.
Il est impératif que les formes de protestation restent légales. Comme je l’ai décrit plus haut, les voies légales et démocratiques vers des changements majeurs dans les objectifs de l’État et la nature de l’identité nationale restent ouvertes. Si elles sont bloquées, il y aura une radicalisation accrue, pouvant aller jusqu’au vigilantisme, au terrorisme et au racket, comme nous l’avons vu en Irlande du Nord. Ce serait catastrophique. Ce n’est pas encore inévitable.
Breizh-info.com : Certains observateurs affirment que l’idéologie « woke » et l’idéologie islamiste, malgré leurs différences apparentes, se renforcent mutuellement dans le démantèlement de l’identité occidentale. Êtes-vous d’accord avec cette analyse ?
Dominic Green : Elles ont les mêmes ennemis. Elles partagent un objectif révolutionnaire, et même le recours au suicide au nom de la cause. À l’heure actuelle, leurs intérêts communs sont évidents, elles collaborent donc. Mais cela ne peut pas durer. Nous voyons déjà en Angleterre comment les islamistes ont porté le Parti travailliste au pouvoir et se retirent maintenant pour former leur propre parti. (Je crois qu’un certain M. Houllebecq a écrit un roman sur ce thème.)
Le « wokisme », né dans les universités de la Nouvelle-Angleterre et du nord-est des États-Unis, est le stade terminal de l’identitarisme puritain : une spiritualité chrétienne fondée sur la rédemption personnelle et l’émotion débordante, mais dépourvue de la théologie chrétienne de la rédemption. À cet égard, le « wokisme » émerge de l’identité occidentale moderne et libérale et témoigne du déclin de sa vitalité, notamment de sa capacité à absorber et à résister aux nouvelles influences, et à se reproduire d’une génération à l’autre. Ainsi, le « woke » englobe les philosophies de la « décroissance » économique et même de l’abstinence parentale au nom de la guérison de la planète. Le programme « woke » est la plus longue lettre de suicide de l’histoire.
L’islamisme émerge clairement de l’extérieur des États occidentaux. Produit de l’ère de l’empire occidental, il est influencé par la tradition révolutionnaire occidentale, mais il ne se définit pas par celle-ci. Toutes les révolutions dans le monde islamique postcolonial, de la Tunisie et l’Algérie à l’Iran et l’Égypte pendant le Printemps arabe, se sont d’abord exprimées dans le langage de la révolution occidentale, mais elles se sont rapidement transformées en programme islamiste. L’islamisme est-il également un indice de déclin ? Selon les normes de la société libérale occidentale, oui. Mais l’islamisme reflète-t-il également une perte de vitalité et de foi, et adopte-t-il des philosophies de décroissance et d’abstinence ? Manifestement non.
Lorsque la révolution dévore ses propres enfants, nous découvrons à qui elle appartient. La gauche occidentale est déjà en train de découvrir que l’issue de sa dernière révolution pourrait ressembler à celle des sociétés postcoloniales. Et pourquoi pas ? Nous sommes nous aussi des sociétés postcoloniales.
Propos recueillis par YV
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







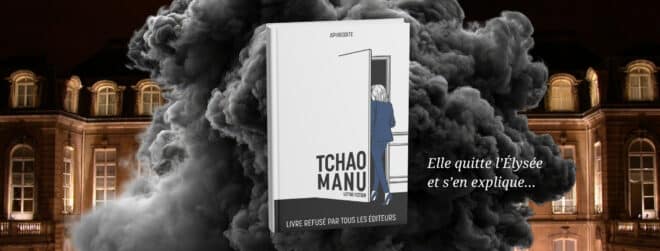



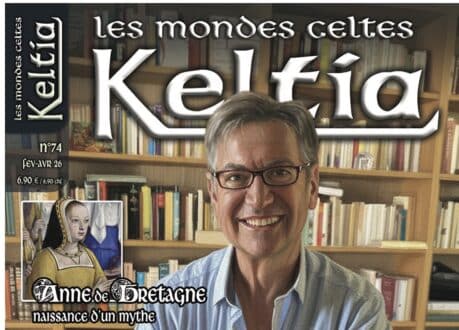


Une réponse à “Dominic Green : « Les États ne contrôlent plus le crime, alors ils contrôlent les mots » [Interview]”
Excellent entretien. Breizh infos fait honneur à sa vocation d’éclairer le débat public en donnant la parole à des personnes habituellement condamnées au silence par les médias dominants et la classe intellectuelle woke.