Par Balbino Katz
Une décision administrative, datée du 2 mai dernier, a fait sursauter les chancelleries attentives aux choses politiques. L’Office fédéral pour la protection de la Constitution, que l’on peut, sans grand abus, qualifier de vigie institutionnelle de la République fédérale allemande, a officiellement classé l’Alternative für Deutschland (AfD) parmi les organisations d’« extrême droite avérées ». En langage administratif, cela signifie que l’État se reconnaît le droit de placer sous surveillance étroite un parti politique représentant plus d’un électeur sur cinq — et qui siège avec 152 représentants au Bundestag.
Il faut, pour mesurer la portée d’un tel geste, considérer le contexte singulier de la démocratie allemande, issue des ruines de la Seconde Guerre mondiale. C’est une démocratie dite « militante », où l’État ne se contente pas de garantir les libertés fondamentales, mais se donne pour mission active de les protéger, y compris contre ceux qui, par les urnes, contesteraient ses fondements. La Loi fondamentale de 1949, rédigée sous la houlette anglo-américaine, permet ainsi l’interdiction de partis jugés incompatibles avec l’ordre constitutionnel. Ce fut le sort du KPD (Parti communiste) en 1956 ; ce pourrait être, demain, celui de l’AfD.
Or, c’est bien là que le bât blesse. Car si l’on ne saurait ignorer les outrances, les provocations, les dérapages sémantiques — pour user d’un vocable journalistique devenu rituel — de certaines figures de l’AfD, notamment dans ses bastions orientaux, il n’en demeure pas moins que ce parti représente aujourd’hui une fraction considérable du corps électoral allemand. L’on peut blâmer ses idées, mais prétendre l’extirper du jeu politique au motif de sa radicalité, c’est s’avancer sur une pente glissante. L’histoire, même lorsqu’elle s’habille de prudence, ne protège pas toujours des effets pervers de l’orthodoxie légale.
Le gouvernement allemand assure que la décision repose sur une enquête approfondie, alimentée par un rapport de quelque 1 100 pages. Il y est question d’atteintes à la dignité humaine, de rhétorique xénophobe, de réseaux internes défendant des thèses identitaires. Rien de cela n’est anodin. Mais la question demeure : un État démocratique peut-il surveiller, discriminer, voire interdire un parti légitimement élu sans altérer sa propre nature ?
Cette question n’est pas que théorique. Elle a traversé l’Atlantique, trouvant un écho inattendu dans la bouche du secrétaire d’État américain Marco Rubio, dont la sortie sur le réseau X (anciennement Twitter) n’est pas passée inaperçue :L’Allemagne vient d’accorder à son agence de renseignement de nouveaux pouvoirs pour espionner l’opposition. Ce n’est pas de la démocratie, c’est une tyrannie déguisée. Ce qui est véritablement extrémiste, ce n’est pas l’AfD populaire – qui est arrivé deuxième lors de la récente élection – mais plutôt les politiques migratoires d’ouverture des frontières, mortelles, de l’establishment, auxquelles l’AfD s’oppose. L’Allemagne devrait changer de cap. ».
La réponse allemande n’a pas tardé. Le ministère des Affaires étrangères, dans une formule à la fois sèche et solennelle, a rappelé que « c’est cela, la démocratie » — entendez : une vigilance active contre ses fossoyeurs. Mais cette définition, si elle se veut noble, n’échappe pas au soupçon d’un élargissement dangereux du spectre de la menace. À force de voir l’ennemi partout, l’on finit par oublier que le combat démocratique se nourrit aussi d’adversité. Une opposition, même rugueuse, même populiste, même irritante, est encore préférable au silence d’une assemblée unanime.
Il faut dire que l’AfD, dans son ascension, bénéficie aussi d’un terreau social propice : une population de l’Est marginalisée par la mondialisation, une classe moyenne inquiète de la pression migratoire, une jeunesse désorientée par les mots d’ordre interchangeables du progrès sans boussole. Le vote AfD, qu’on le veuille ou non, n’est pas qu’un réflexe protestataire : il exprime une angoisse existentielle. En le réduisant à une menace pour l’ordre public, le pouvoir en place se prive de la chance d’en comprendre les ressorts.
Il est tentant, pour ceux qui détiennent l’autorité, de transformer l’adversaire en suspect. Mais lorsque la procédure remplace la politique, la démocratie s’éteint à petit feu. La surveillance des élus, les écoutes, les fichiers : tout cela évoque davantage un ministère de l’Intérieur sous tension qu’un parlement en débat. Le danger n’est pas que l’AfD prenne le pouvoir — elle en est encore loin — mais que l’on habitue l’opinion à l’idée que l’exclusion, le fichage, la stigmatisation sont des armes licites contre le suffrage universel.
Certains, comme la députée de gauche Heidi Reichinnek, vont jusqu’à réclamer l’interdiction pure et simple du parti. Que ces propos viennent de l’extrême gauche ne doit étonner personne. L’histoire a montré que la gauche taraudée par la haine de tout ce qui n’est pas elle, rêve d’exterminer ses adversaires politiques. Mais l’idée même qu’un parti recueillant près d’un quart des voix soit interdit devrait, à elle seule, alarmer ceux qui se prétendent les gardiens de l’État de droit.
Car enfin, si l’AfD est un péril, que le régime diversitaire allemand l’affronte à visage découvert. Qu’il débatte, qu’il réfute, qu’il convainque. Mais qu’il ne se cache pas derrière les barreaux dorés de la légalité formelle pour écarter un trouble-fête. L’histoire allemande, si souvent invoquée comme repoussoir, devrait au contraire rappeler que c’est par la force de la loi, et non par son abus, que l’on préserve l’essentiel.
Les Américains, en la personne de Rubio, et avant lui le vice-président Vance, ont rappelé avec force qu’une démocratie digne de ce nom ne se protège pas en reconstruisant des murs, fussent-ils administratifs. Ce rappel, venu d’outre-Atlantique, n’est pas à balayer d’un revers de main. Ce sont ces mêmes Américains, rappelons-le, qui ont contribué à rebâtir l’Allemagne d’après-guerre sur le modèle politique anglo-saxon.
La vigilance ne doit pas devenir soupçon systématique. Et le droit, pour rester respectable, ne doit jamais perdre de vue sa finalité : garantir à chacun, même à l’opposant, même à l’encombrant, sa place dans le concert républicain. Car la démocratie, disait jadis Tocqueville, ne périt pas de ses ennemis, mais de ses excès.
Balbino Katz est chroniqueur. Né à Buenos Aires, il vit en Europe, et regarde la politique du Vieux Continent avec un œil formé aux lettres classiques et aux leçons de l’histoire.
Crédit photos : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine




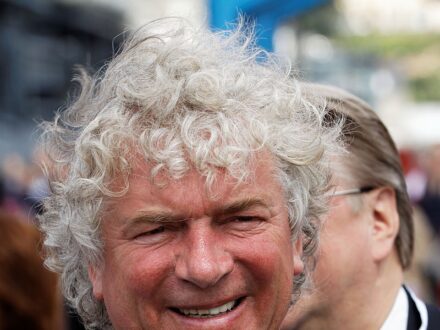









4 réponses à “L’Allemagne à la croisée des vents : une démocratie sur ses gardes”
L’on se trompe du tout au tout
L’Extrême-Droite, ce n’est ni le nationalisme ni le populisme
L’Extrême-Droite, c’est l’hyper-capitalisme globalo-mondialiste qui opprime la Nation et la dilue par une immigration-invasion absurde pour mieux dominer la fraction de nationaux qui réfléchissent par eux-mêmes et n’acceptent pas la pâtée mondialiste-wokiste ni les tentatives de »gouvernement planétaire »
En France, l’Extrême-Droite réelle, c’est Macron le Très Excité… qui a de fortes velléités dictatoriales !
En Allemagne , avec la condamnation des partis politiques qui ne sont pas dans le politiquement correct de ceux qui dirigent, on se croirait revenu « aux heures les plus sombres » de l’histoire. A quand « la nuit des longs couteaux » ?
Toute la bienpensance va évidemment se pâmer devant cette prétendue « défense de la démocratie » que constitue cette offensive contre un parti qui ose ne pas bien penser en matière, entr’autres, d’immigration. Mais elle ne semble pas s’interroger sue le fait que c’est justement dans ce qui fut la RDA que l’AFD réalise ses meilleurs scores.
éliminer les « malpensant » comme en roumanie et comme avec mme lepen en france