Il arrive parfois qu’un discours politique résonne comme une pierre jetée dans les eaux stagnantes de l’histoire. Non par la hardiesse rhétorique — les envolées de M. Trump sont connues — mais par ce qu’il révèle, en creux, d’un basculement doctrinal majeur. Le récent discours du président américain à Riyad, accueilli avec les honneurs dus à un souverain en visite, marque à plus d’un titre un tournant : celui de l’abandon par les États-Unis de l’idéologie néoconservatrice et de son messianisme guerrier.
Depuis les années 1990, Washington, coiffé de lauriers démocratiques, avait pris l’habitude de dicter au monde ses préférences de gouvernement, ses normes sociales, ses dogmes économiques, avec cette fatuité qui naît chez les empires vieillissants persuadés de confondre leur intérêt avec l’universel. Ce fut l’époque des interventions au nom des droits de l’homme, des guerres d’exportation idéologique, des croisades en cravate pour « libérer » les peuples en bombardant leurs capitales.
Or voici que Donald Trump, dans le faste oriental du royaume saoudien, tourne la page avec une brutalité sans ambages. Son propos, bien que fleuri de superlatifs à l’américaine, contient une vérité que nombre de commentateurs feignent d’ignorer : la paix ne procède pas d’un modèle unique plaqué partout à coups de drones et d’ONG. Elle est le fruit d’un enracinement, d’une autonomie, d’un équilibre propre à chaque civilisation.
Ce que Trump a dit, avec la subtilité d’un bulldozer mais la justesse d’un vieil empirique, c’est que les peuples doivent être maîtres chez eux. Les gratte-ciel de Riyad ne doivent rien aux think tanks de Harvard. Ce ne sont pas les puissances occidentales qui ont transformé le Golfe, mais les dirigeants du Golfe eux-mêmes. Et de rappeler que les néoconservateurs — ces jacobins planétaires du Pentagone — ont davantage ruiné que bâti : Bagdad, Kaboul, Damas en témoignent. Le chaos fut leur legs. L’humilité, le commencement de la sagesse.
En cela, le discours de Riyad s’inscrit dans une tradition politique que nos élites républicaines, aveuglées par un universalisme abstrait, peinent à comprendre : celle de la Realpolitik. Le réalisme stratégique, hérité de Richelieu et de Bismarck, ne consiste pas à aimer ou haïr les régimes, mais à faire prévaloir la stabilité, la puissance, et les intérêts durables sur les passions éphémères. C’est le contraire de la croisade. C’est aussi, en un sens, la quintessence du conservatisme, qui ne prétend pas remodeler l’humanité, mais préserver l’ordre là où il peut encore tenir.
Derrière la franchise brutale de Trump, il y a l’ombre portée de ce que Carl Schmitt appelait le Nomos de la Terre : un ordre du monde fondé non sur des valeurs abstraites, mais sur la reconnaissance des sphères, des souverainetés, des lignes de partage. C’est à ce titre que le discours de Riyad mérite d’être lu avec sérieux. Il ne s’agit pas simplement d’un plaidoyer pour l’alliance américano-saoudienne, mais d’une rupture, presque théologique, avec la religion du Bien.
L’ironie de l’époque veut que ce soient les milieux jadis classés « conservateurs » — les faucons de Washington, les anciens disciples de Leo Strauss — qui hurlent aujourd’hui à la trahison. Pour eux, abandonner la mission civilisatrice de l’Amérique, c’est déjà pactiser avec les ténèbres. Il n’est donc pas surprenant que la gauche libérale, bien qu’autrefois pacifiste, se retrouve soudain défenseuse d’un impérialisme moral, pourvu qu’il promeuve les « droits » des minorités sexuelles ou les quotas de diversité.
Là encore, les masques tombent. Ce n’est pas la guerre qu’ils abhorrent, c’est le fait qu’elle ne serve plus leur agenda. Leur indignation face au réalisme de Trump en dit long sur l’alliance objective, désormais ancienne, entre la gauche morale et la droite impériale.
On pourra objecter que Trump n’est ni Talleyrand, ni Metternich. Certes. Il n’en a ni l’élégance, ni la profondeur doctrinale. Mais il est, comme le furent parfois les princes de guerre du passé, un homme dont l’instinct dépasse les doctrines. Là où ses prédécesseurs voyaient des ennemis héréditaires, il discerne des partenaires possibles. Là où d’autres veulent juger, punir, redresser, lui propose de négocier, de commercer, de conclure des traités. C’est un vieux rêve américain qui s’effondre — celui d’un monde à leur image — et c’est peut-être la condition pour que l’équilibre renaisse.
Dans les salons de l’idéologie, on feindra d’ignorer ce tournant. On parlera de flatterie à l’égard de régimes autoritaires, de naïveté stratégique, de recul des valeurs. Ce ne sont là que les cris d’orfraie de ceux qui se croyaient les gendarmes de la planète. Pour une fois, l’Amérique semble prête à laisser les peuples respirer selon leurs lois. Que cela vienne d’un homme comme Trump — haï autant par l’establishment que par les intellectuels — ne fait que renforcer l’ironie de l’histoire.
À l’heure où l’Europe s’enlise dans une guerre qu’elle ne maîtrise pas, et où la France, éternel donneur de leçons, ne sait plus distinguer entre puissance et posture, il n’est pas interdit de regarder, avec un œil neuf, cette doctrine de paix sans illusion, de puissance sans croisade. Elle est plus proche de notre vieille sagesse gauloise que les lubies abstraites qui nous venaient autrefois d’outre-Atlantique.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : DR



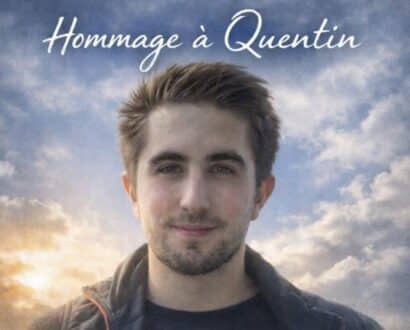


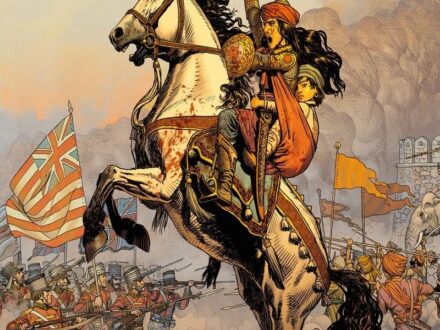






2 réponses à “Trump à Riyad : le crépuscule des néoconservateurs”
Troisième ligne du texte :Trump…. »L’ancien président américain « .
Pourtant hier soir c’était encore lui le président des USA. Comme quoi tout bascule très rapidement !
Bravo pour la subtilité de cet article.