L’histoire de la péninsule armoricaine recèle pourtant des trajectoires héroïques et méconnues. Parmi elles, celle des missionnaires bretons partis évangéliser les confins du monde entre le XVIe et le XVIIIe siècle. De Saint-Malo aux Antilles, de Nantes à la Chine, ils furent des centaines à répondre à l’appel de la foi – et à incarner, parfois jusqu’au martyre, une Bretagne missionnaire, conquérante et universelle.
C’est cette épopée que retrace avec minutie le mémoire de Master 2 en Histoire de Marc-Antoine Alix, Missionnaires bretons dans les Nouveaux Mondes (XVIe-XVIIIe siècles), soutenu à l’université Rennes 2 en 2017 sous la direction de Georges Provost. Déposé sur HAL Open Science (réf. hal-01586706), ce travail éclaire d’un jour nouveau le rôle majeur de la Bretagne dans la grande aventure missionnaire catholique.
Une terre tournée vers la mer et vers Dieu
Au XVIIe siècle, dans le sillage du concile de Trente, la Bretagne vit un renouveau catholique intense. Des figures comme Michel Le Nobletz ou Julien Maunoir sillonnent les campagnes pour y raviver la ferveur populaire. Mais l’horizon spirituel ne s’arrête pas aux chapelles de granit. La découverte des Amériques, l’expansion coloniale française et l’élan missionnaire jésuite ouvrent de nouveaux champs d’action. Naturellement tournée vers l’Atlantique, forte de ses 3 500 km de côtes et de ports actifs (Saint-Malo, Nantes…), la Bretagne devient une pépinière de missionnaires.
Marc-Antoine Alix recense plus de 400 missionnaires bretons identifiés, souvent issus des grandes villes (Nantes, Rennes, Saint-Malo) mais aussi des terroirs bretonnants de Basse-Bretagne. Leur départ culmine sous Louis XIV, entre 1640 et 1680. Jésuites, Capucins, Récollets, puis prêtres séculiers se relaient pour évangéliser les terres lointaines.
Entre vocation spirituelle et aventure familiale
Ces hommes – et quelques femmes, comme les Ursulines envoyées aux Antilles – ne partent pas par hasard. Le contexte maritime breton, les réseaux familiaux et ecclésiastiques, les récits des anciens alimentent un imaginaire héroïque. Si la foi anime leurs pas, l’aventure, l’ascension sociale ou le désir de rédemption comptent aussi.
La moyenne d’âge au départ est jeune, les origines sociales modestes (artisans, petits notables, marchands), et les parcours souvent marqués par une éducation religieuse solide dans les séminaires ou les congrégations locales. L’idéal du missionnaire, c’est l’abandon total à Dieu, parfois jusqu’au martyre.
L’enfer et la foi : réalités de la mission
La réalité des missions contraste violemment avec les images pieuses. Le voyage est périlleux (tempêtes, pirates, maladies), l’arrivée brutale : climat, famine, incompréhension culturelle. Dans les Amériques, en Inde ou à Madagascar, les missionnaires bretons font face à des résistances indigènes, à la concurrence entre ordres, et parfois à l’hostilité des colons. Beaucoup meurent jeunes – 30 % décèdent en mission, à 45 ans en moyenne.
Mais ils laissent aussi des traces : fondations d’églises, apprentissage des langues locales, toponymes (l’Île de Bréhat au Canada, par exemple), récits édifiants envoyés en métropole. Certains marquent profondément les territoires où ils ont œuvré.
Le mémoire d’Alix interroge enfin la dimension identitaire de ces missionnaires. Sont-ils bretons, français ou simplement religieux ? Sans tomber dans l’anachronisme, il semble clair qu’un « esprit breton » les animait : endurance, foi rigoureuse, goût du large. La Bretagne fournit 15 à 20 % des missionnaires français recensés sur la période, un chiffre révélateur.
Cet esprit missionnaire breton, forgé entre landes et océans, s’est exporté aux quatre coins du monde, contribuant à une mondialisation religieuse précoce. L’histoire de ces hommes de foi, trop souvent oubliés, mérite d’être redécouverte.
Marc-Antoine Alix, Missionnaires bretons dans les Nouveaux Mondes (XVIe-XVIIIe siècles), mémoire de Master 2 en Histoire, Université Rennes 2, 2017.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine





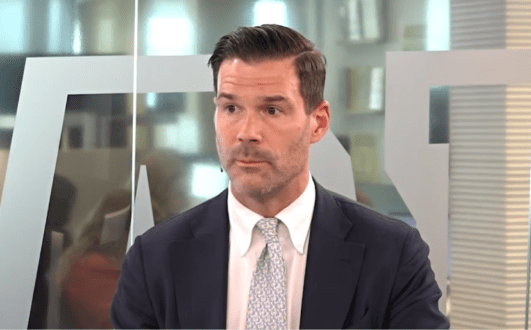
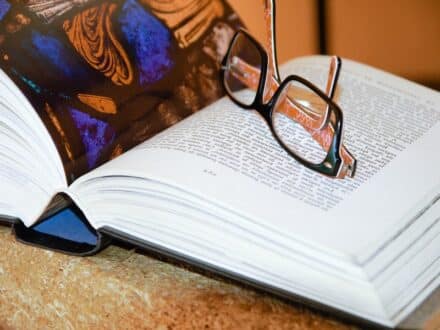

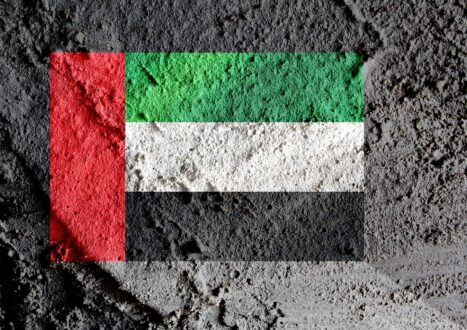


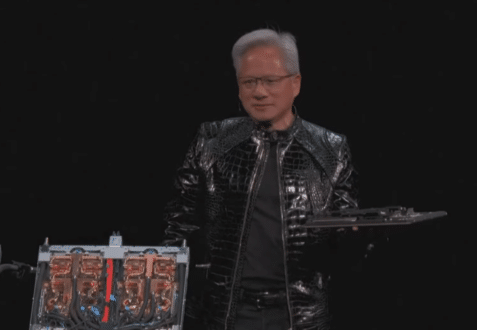


2 réponses à “Les missionnaires bretons, pionniers oubliés de la foi dans les Nouveaux Mondes (XVIe-XVIIIe siècles)”
Oui, tous oubliés! français bretons et autres français, évangélisateurs des 16, 17, 19, et début 20 ème. Et pourtant ce qu’ils ont laissé donne parfois un cardinal SARAH. Qui aurait été un meilleur pape que ce sud américain jésuite médiocre et politicien médiocre.
Maintenant nous importons des prêtres africains francophones qui devraient être les nouveaux évangélisateurs de l’afrique qui en a besoin tant spirituellement que socialement pour se prendre en mains.
Saluons le courage et la qualité de ces étudiants qui atteignent ce niveau rien à voir avec les lopettes qui encombrent les amphithéâtres à chaque rentrée et qui passeront l’année à faire la fête à vociférer, à bloquer et saccager la Fac aux frais des contribuables alors qu’il suffirait de traiter le problème d’une poigne de fer! Mais ce qui m’amuse c’est qu’il fallut que Le Nobletz et Maunoir battent la campagne pour raviver la foi pourquoi? Parce que le substrat celtique montrait de plus en plus le bout de son nez;