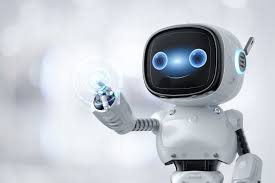Alors que des discussions de sortie de la clandestinité sont en cours, les négociateurs du gouvernement britannique ont opposé une fin de non-recevoir à une exigence jugée explosive : autoriser certains anciens membres de l’UVF à porter légalement des armes à feu.
La scène aurait pu sembler ubuesque si elle ne rappelait pas une réalité toujours sensible en Irlande du Nord. Dans le cadre de négociations visant à la dissolution progressive des groupes paramilitaires loyalistes, l’Ulster Volunteer Force (UVF) aurait récemment réclamé, en échange de son retrait officiel, que ses cadres puissent se voir délivrer des armes de poing à des fins de protection personnelle. Une demande immédiatement rejetée par les autorités britanniques.
Un processus de désarmement toujours flou
Depuis plusieurs années, l’UVF, groupe paramilitaire loyaliste historiquement impliquée dans de nombreux actes de violence durant les Troubles, dialogue avec Londres pour préparer son démantèlement total. Mais les discussions patinent, notamment sur l’absence de cadre légal permettant de garantir que les armes sont véritablement mises hors d’usage. De nombreux négociateurs reconnaissent d’ailleurs que le désarmement annoncé par les groupes est surtout symbolique : dans les faits, l’accès à l’arsenal reste relativement simple pour les factions criminelles actives qui pour beaucoup ont plongé dans le trafic de drogue plus que dans la lutte politique armée.
Si les obstacles initiaux portaient sur l’exigence d’une amnistie pour les crimes commis par le passé – une revendication largement satisfaite avec la loi sur les dossiers non résolus, malgré la promesse des travaillistes de l’abroger –, la nouvelle revendication choque par son audace : légaliser le port d’armes pour une poignée de dirigeants loyalistes, sous prétexte de menace persistante.
Porter une arme en toute légalité : une exception très encadrée
En Irlande du Nord, il est possible d’obtenir une autorisation de port d’arme à des fins de protection personnelle. Encore faut-il convaincre le PSNI (Police Service of Northern Ireland) d’un danger réel et immédiat. Chaque dossier est examiné rigoureusement, et les antécédents judiciaires sont passés au crible. Ce qui, en théorie, exclut toute personne ayant un passé paramilitaire.
Historiquement, ces permis furent délivrés à des personnalités politiques, à des magistrats, ou à certains hauts fonctionnaires à l’époque du conflit. Mais accorder ce statut à des membres d’une organisation toujours illégale comme la UVF – même en voie de dissolution – serait un précédent inacceptable, selon les services de sécurité britanniques.
L’UVF, dont le chef de file actuel, John « Bunter » Graham, mène les discussions en petit comité, aurait également suggéré, dans un premier temps, de conserver une unité armée de 240 hommes pour assurer la « sécurité » de ses cadres. Une idée également balayée.
Selon plusieurs sources, la priorité de l’UVF – comme d’une partie de l’UDA – serait aujourd’hui de garantir la pérennité des financements publics vers les associations communautaires locales, souvent contrôlées par d’anciens paramilitaires, ainsi que la protection contre d’éventuelles poursuites judiciaires pour les actes commis avant la paix.
Mais ces revendications, rendues publiques ces dernières semaines, provoquent de vives tensions en interne. Des cadres loyalistes dénoncent des fuites visant à saboter les négociations. Certains demandent désormais à ce que les pourparlers cessent. C’est le cas de Lord Alderdice, ancien dirigeant de l’Alliance Party et ex-président de la Commission de surveillance indépendante, qui a appelé à « un arrêt immédiat » des discussions sur la transition loyaliste.
Au-delà des armes, une autre exigence de la UVF provoque des crispations : la possibilité de continuer à utiliser légalement le nom de l’organisation, notamment pour des événements commémoratifs ou des clubs d’anciens combattants. Une revendication jugée problématique par les autorités, dans la mesure où certains individus pourraient s’en servir comme couverture pour des activités illicites, notamment dans les trafics de drogue.
Vingt-sept ans après les accords du Vendredi saint, la pacification totale de l’Irlande du Nord reste entravée par des héritages complexes, mêlant enjeux identitaires, mémoriels… et très concrets. La question n’est plus seulement de désarmer les milices : c’est de savoir si l’on peut tourner la page tout en continuant à lire les notes en bas.