Le dernier baromètre de WTW en France, publié le 2 septembre 2025, met en évidence une progression continue de l’absentéisme dans le secteur privé. Avec un taux moyen de 5,1 % en 2024, en hausse de 3 % par rapport à 2023, la tendance devient préoccupante pour les entreprises, les salariés et les assureurs.
Des arrêts plus longs, des causes plus lourdes
Si la fréquence des arrêts diminue légèrement, leur durée moyenne s’allonge, atteignant désormais 24,1 jours contre 23,3 jours l’année précédente. Près de 35 % des salariés se sont arrêtés au moins une fois dans l’année. La grande majorité des absences (94 %) sont liées à des maladies courantes, mais les accidents de travail et de trajet, bien que ne représentant que 6 % des arrêts, pèsent lourd : leur durée moyenne s’élève à 71 jours.
La montée des arrêts longs accentue ce phénomène. En 2024, 6 % des arrêts ont dépassé 90 jours, représentant à eux seuls 57 % du volume total d’absentéisme (contre 48 % en 2019). Les risques psychosociaux (RPS) demeurent la première cause de ces arrêts prolongés, pesant pour 36 % d’entre eux.
Des disparités marquées selon les profils
Les écarts se creusent entre les catégories de salariés. Les femmes, surreprésentées dans les secteurs les plus exposés, affichent un taux de 6,1 % contre 4,5 % pour les hommes. Les jeunes (20-30 ans) sont plus nombreux à connaître des arrêts, souvent pour des motifs psychologiques, tandis que les seniors accumulent les durées les plus longues, avec jusqu’à 44,5 jours en moyenne pour les plus de 60 ans.
Sur le plan socio-professionnel, les ouvriers (7,37 %) et les employés (6,79 %) restent les plus touchés, quand les cadres présentent un taux plus faible (2,37 %) mais en nette progression. Côté contrats, l’absentéisme reste deux fois moindre chez les salariés en CDD (2,3 %) par rapport à ceux en CDI (5,3 %).
Les secteurs les plus fragilisés restent inchangés : santé et action sociale (8,5 %), hébergement et restauration (8 %), et transport/entreposage (6,8 %). Certaines régions apparaissent particulièrement affectées, comme les Hauts-de-France, où plus d’un salarié sur trois a connu un arrêt en 2024, avec une durée moyenne de 27,6 jours.
Un coût colossal pour les entreprises
Au total, l’absentéisme pèse plus de 120 milliards d’euros par an sur l’économie française. Cette somme inclut les indemnités journalières de la Sécurité sociale, le maintien de salaire par les employeurs, mais aussi des coûts indirects comme la désorganisation des équipes, la baisse de productivité ou la surcharge des collègues présents.
La réforme entrée en vigueur en avril 2025, plafonnant les indemnités journalières à 1,4 SMIC, accentue encore la pression financière sur les entreprises et les régimes de prévoyance, qui doivent compenser l’allongement des arrêts longs.
Face à ce constat, de plus en plus d’employeurs investissent dans la prévention et la qualité de vie au travail. Dans la construction, secteur historiquement sinistré, l’introduction de nouvelles pratiques de sécurité et de formation a permis de ramener le taux d’absentéisme à 4,2 % en 2024, preuve qu’une stratégie proactive peut donner des résultats durables.
[cc] Article relu et corrigé (orthogaphe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..









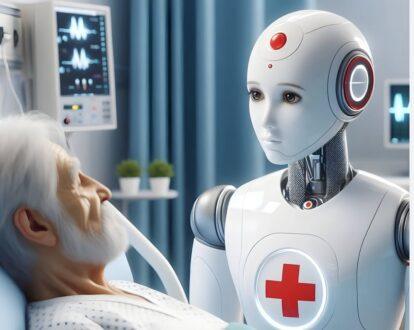


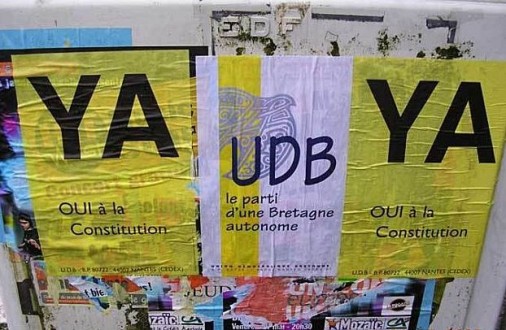

2 réponses à “Absentéisme en hausse en 2024 : un signal d’alerte pour les entreprises françaises”
Ça serait intéressant la même étude dans le secteur public….
Il faudrait , peut être , parler , aussi , de la conscience professionnelle qui semble avoir complètement disparue, mais l’exemple venant « d’en haut » avec la chianlit de l’Assemblée Nationale, et le comportement de certains hommes et femmes publics, ceci peut expliquer cela.