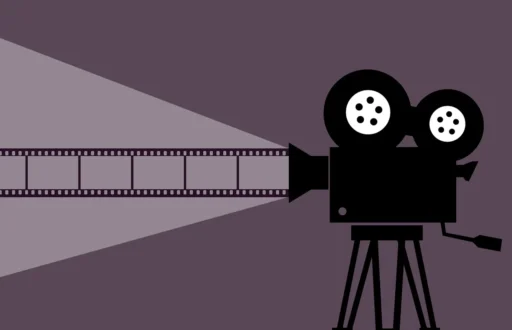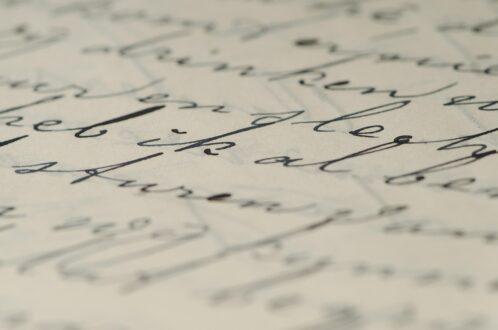L’histoire a parfois des résurgences spectaculaires. Cet été, le dolmen de Guadalperal, surnommé le « Stonehenge espagnol », est réapparu sur les rives du Tage, en Estrémadure. Immergé depuis 1969 sous les eaux du barrage de Valdecañas, ce site mégalithique vieux de plusieurs millénaires intrigue autant les archéologues que le grand public. Car au-delà de ses pierres monumentales, une question obsède désormais les chercheurs : où se trouvait le village qui l’entourait ?
Un monument englouti, redécouvert à plusieurs reprises
Découvert en 1925 par le prêtre et archéologue Hugo Obermaier, le dolmen était initialement recouvert d’un tumulus de quartzites. Il se composait d’une chambre circulaire de cinq mètres de diamètre, accessible par un long couloir de 21 mètres, et entourée de cercles concentriques de pierres. Une architecture funéraire imposante, dont il reste aujourd’hui une partie des dalles, érodées par des décennies d’immersion.
Submergé lors de la mise en eau du barrage, Guadalperal n’a refait surface qu’épisodiquement : en 1992, en 2012, puis surtout à l’été 2019, déclenchant une vague d’intérêt international. La sécheresse de 2022 l’avait à nouveau révélé, mais c’est l’actuel recul des eaux qui permet aux archéologues de reprendre l’étude du site dans des conditions inédites.
Un patrimoine lié à un habitat oublié
Selon les spécialistes, le dolmen, érigé entre le Ve et le IIIe millénaire av. J.-C., ne se dressait pas isolé. Les fouilles menées dans les années 1920 avaient déjà mis au jour des fragments de céramique, des outils en silex et des vases campaniformes, signes d’un habitat humain à proximité. « Les matériaux archéologiques témoignent d’un habitat installé autour du monument », confirme aujourd’hui le ministère espagnol de la Culture.
Ces populations vivaient d’agriculture et d’élevage, cultivant le blé et consommant légumineuses, viande ovine et bovine. On sait également, grâce à d’autres sites du bassin du Tage, qu’elles confectionnaient du pain à base de glands et de céréales. À Guadalperal, les archéologues espèrent retrouver des traces de ce village englouti : meules, structures domestiques, sépultures… autant de pièces manquantes d’un puzzle vieux de 6 000 ans.
Depuis deux semaines, l’Institut du Patrimoine Culturel d’Espagne coordonne une campagne scientifique avec plusieurs universités et musées nationaux. Des sondages sont menés autour du site, complétant les prospections subaquatiques réalisées en 2024. Objectif : reconstituer le paysage originel, comprendre les échanges économiques et culturels de ces communautés et documenter la relation étroite entre mégalithes et cours d’eau.
Cette quête s’inscrit dans une démarche plus large : sauver un patrimoine fragilisé par des décennies d’immersion. Dans les années 1960, la construction des barrages espagnols n’avait tenu aucun compte des sites archéologiques, reléguant au fond des lacs artificiels des monuments préhistoriques entiers.
Un symbole européen
Le « Stonehenge espagnol » n’est pas seulement un site local : il illustre l’unité culturelle de la préhistoire européenne, ces cercles de pierres dressés de l’Atlantique aux Carpates. Sa réapparition offre une chance rare d’éclairer la vie quotidienne de ces communautés du Néolithique, trop souvent réduites à leurs monuments funéraires. Mais elle pose aussi un dilemme : faut-il laisser Guadalperal livré aux cycles du barrage, au risque de le voir disparaître sous l’érosion ? Ou envisager son déplacement vers un site à sec, hypothèse déjà rejetée par Madrid en 2019 ?
En attendant, le cromlech de Guadalperal, classé bien d’intérêt culturel en 2022, attire curieux et chercheurs. Plus qu’un cercle de pierres, il est devenu le témoin d’un passé englouti que l’Espagne tente aujourd’hui de sauver des eaux.
Crédit photo : Wikipedia (cc)
[cc] Article relu et corrigé (orthogaphe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..