C’est un petit séisme politique passé à une voix près. Jeudi 30 octobre, l’Assemblée nationale a adopté, par 185 voix contre 184, une résolution du Rassemblement national demandant la dénonciation de l’accord franco-algérien signé en 1968. Une première historique pour le parti de Marine Le Pen, qui voit dans ce vote le signe d’un basculement des équilibres politiques au Parlement.
Un texte symbolique mais lourd de sens
La résolution, déposée dans le cadre de la « niche parlementaire » du RN, n’a pas de portée législative directe : elle n’oblige pas le gouvernement à agir. Mais son adoption marque un tournant. Pour la première fois, un texte du RN reçoit le soutien d’une majorité de députés, grâce à la convergence de voix venues des bancs des Républicains, d’Horizons et de quelques élus non-inscrits.
Le résultat du scrutin révèle un hémicycle profondément fragmenté. Sur les 185 votes favorables, figuraient la quasi-totalité du groupe RN, une quinzaine de députés de l’Union des droites républicaines autour d’Éric Ciotti, plusieurs élus LR, ainsi qu’une partie du groupe Horizons, proche d’Édouard Philippe. À gauche, les groupes socialiste, écologiste et LFI ont voté contre, tandis que de nombreux députés macronistes étaient absents – un fait qui a provoqué la colère des opposants au texte.
Un accord hérité d’une autre époque
Signé six ans après la guerre d’Algérie, l’accord du 27 décembre 1968 avait été conçu pour faciliter la venue de travailleurs algériens dans une France alors en pleine expansion économique. Il accorde encore aujourd’hui des avantages délirants aux ressortissants algériens, aux frais des contribuables français : titres de séjour de dix ans obtenus selon une procédure accélérée, simplification du regroupement familial, droits élargis en matière d’emploi et de résidence.
Ces dispositions, uniques en Europe, placent les Algériens dans une situation privilégiée par rapport aux autres ressortissants étrangers, ce que de nombreux élus dénoncent depuis des années. Plusieurs rapports parlementaires, dont un présenté début 2025 par les députés Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre, ont souligné le caractère discriminatoire et juridiquement obsolète de cet accord bilatéral.
L’adoption de cette résolution illustre une évolution du climat politique français. Alors que la question migratoire s’impose au cœur des débats publics, une partie de la droite parlementaire rejoint désormais les positions longtemps marginalisées du RN. Édouard Philippe et Gabriel Attal eux-mêmes s’étaient prononcés ces derniers mois pour une révision de l’accord de 1968, tout en refusant d’appuyer le texte du RN – ce qui n’a pas empêché son adoption, du fait de l’absence d’une cinquantaine de députés macronistes lors du vote.
À gauche, l’indignation fut immédiate : socialistes, insoumis et écologistes ont dénoncé une « alliance de circonstance » entre la majorité présidentielle, la droite classique et le RN. Mais cette stratégie de diabolisation n’a pas suffi à empêcher le basculement d’une voix, preuve que la frontière politique entre droite et extrême droite se brouille désormais sur la question migratoire.
Une victoire symbolique, un signal politique clair
Si cette résolution ne change rien dans l’immédiat au droit français, elle envoie un signal politique fort : une majorité relative de députés estime aujourd’hui que l’accord franco-algérien n’a plus lieu d’être. Le texte adopté ouvre la voie à une future dénonciation formelle de cet accord par un gouvernement décidé à reprendre la maîtrise de sa politique migratoire.
Pour le RN, il s’agit d’un moment charnière : la reconnaissance parlementaire de son rôle d’opposition structurée et capable de rallier des alliés sur des sujets nationaux majeurs. Pour le pouvoir en place, en revanche, ce vote sonne comme un avertissement : sur la question de l’immigration, les équilibres politiques de l’après-macronisme sont déjà en train de se redessiner.
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



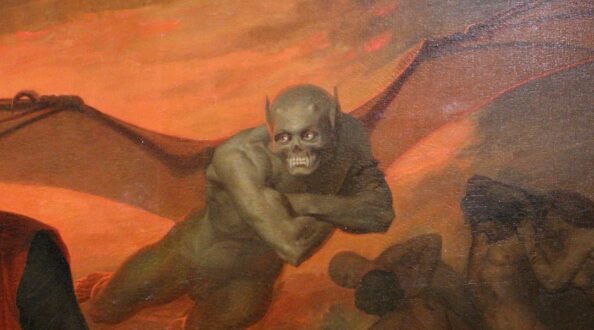






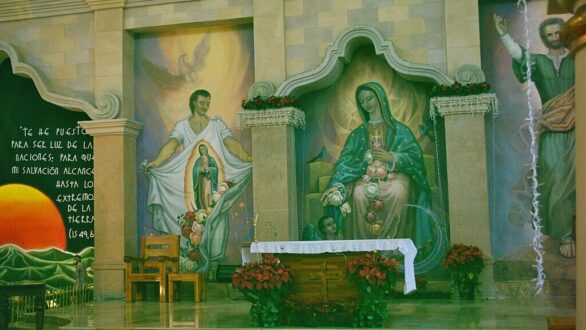
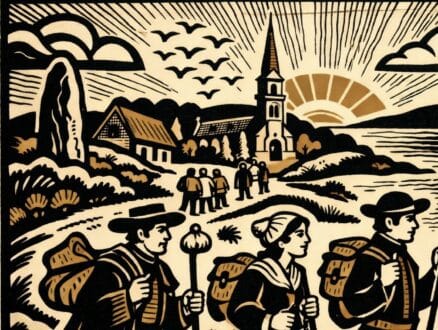


5 réponses à “L’Assemblée nationale adopte la résolution du RN contre l’accord franco-algérien de 1968”
Par curiosité allez sur le site de l’assemblée nationale et cherchez :
« Analyse du scrutin n°3260. »
Vous aurez le choix de connaitre; ce que votre député a voté.
On voit que le renaissance eric woerth ex-LR lui a voté contre l’abrogation du traité.
Alors que le député renaissance Charles Rodwell qui a fait un rapport sur le coût de cette immigration algérienne.
Estimée a 2 milliards d’euros par an.
Ce député C Rodwell visiblement n’pas pris part au vote .
Que pas mal de députés étaient absents 203 abstentions
Ah les Macronistes toujours dans la totale hypocrisie. Le député Rodwell travaille pendant des mois sur un rapport clair contre ces accords et voilà qu’il oublie de venir voté . Mensonges ,duplicité, louvoyages, pirouettes et postures sont leurs boussoles , à l’image des chefs de pacotilles que sont les Attal, Macron , Bayrou et consorts .
Quand à la gauche , le visage du traître vendue au gouvernement Algerien lui va de mieux en mieux. Le moment d’en finir avec ces gens approche.
Je n’ai jamais compris pourquoi le général de Gaulle a fait cette loi, qui avantage les Algériens, et pourquoi il a »désarmé » les Harkis après avoir signé »Les Accords d’Evian »!…La proposition de résolution est »un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question déterminée » c’est-à-dire que le texte adopté est »une proposition de résolution et n’a pas de valeur législative ou contraignante ».. Emmanuel Macron est favorable non pas à dénoncer cet »Accord Franco Algérien » mais à le renégocier!…Il ne veut pas se brouiller avec le FLN!…
La gauche et autres progressistes ne sont pas à une incohérence près : ils dénoncent sans cesse le colonialisme alors que l’accord de 1968 revient à considérer l’Algérie comme une exception au lieu d’un pays indépendant comme les autres.
Une résolution sans aucune « portée législative directe » et qui « n’oblige pas le gouvernement à agir. »
Finalement un coup d’épée dans l’eau. Le dictateur algérien et ses complices pourront continuer à chier sur la gueule.