Dans les Vosges de Lorraine, la vigne a durement périclité pour se laisser supplanter par d’autres cultures. Après la crise du phylloxera, s’impose dans les campagnes, une boisson fermentée à base de rhubarbe aux accents clandestins, qui à l’image du vin d’épine pour la Vendée, compterait autant de recettes qu’il y a d’habitants.
Si le niveau général de ses fermentations domestiques s’inscrit dans un répertoire rustique bien sympathique, avec l’approximation artisanale qui s’y rattache. En contrepoint de ce folklore, se démarque toujours un esprit plus ambitieux, désireux de vouloir transcender une ancienne tradition régionale pour vouloir hisser son travail à un niveau supérieur.
En l’espèce, il s’agit de la famille Moine qui porte haut les couleurs de leur savoir-faire au travers du blanc des Vosges et du Crillon des Vosges (dans sa version moelleuse). Parler de vin de rhubarbe serait impropre car le terme renvoie uniquement au jus de raisin fermenté, pour autant leurs blancs de rhubarbe s’apparentent de manière confondante à des vins et leur succès ne se dément pas. Aux origines, simple breuvage des pauvres et pis-aller de misère pour ceux qui ne pouvaient consommer de vin, le blanc de rhubarbe s’érige désormais en produit de haute gastronomie.
Aux origines du blanc de rhubarbe, l’achat de 400 pieds…
Tout commence à la faveur d’un voyage en Belgique, dans le milieu des années 80, Michel Moine fermier de Lorraine, tombe sur une opportunité d’achat de 400 pieds de rhubarbe, que veut lui vendre un maraîcher au seuil de la retraite.
En recherche d’une diversification d’activité pour son exploitation, Michel Moine s’en fait l’acquéreur à bon compte. À l’origine cultivée pour de la vente en frais afin de couvrir les besoins de restaurants, confituriers et autres pâtissiers. Mais très vite, la production gagne en ampleur et la nécessité de trouver des débouchés pour les excédents devient prégnante. L’aventure du vin de rhubarbe commence.
De l’empirisme à l’œnologie
Les premières années, Michel Moine s’appuie sur les anciennes pratiques de vinification léguées par les grands-parents, avec une part d’aléas laissée en suspens sur le résultat final : tantôt pétillant tantôt non pétillant.
Mais devant le succès d’estime des premiers « vins » de rhubarbe, Michel Moine comprend assez vite la nécessité de maitriser le processus de fermentation. Il se forme en œnologie en Champagne, afin de mieux garantir la régularité d’une production en plein développement. Aujourd’hui, les fils de Michel Moine dorlotent 12 000 pieds de rhubarbe couvrant près de 3 hectares. La cuverie est aux meilleurs standards, équipée de cuves en inox thermorégulées et la famille Moine veille avec rigueur sur toutes les étapes de fabrication de son vin de référence.
L’importance de la récolte
Elle se condense sur une dizaine de jours entre mai et juin, le travail se répartit entre les cueilleurs et les coupeurs.
Ces derniers occupent un rôle crucial dans la recherche d’une qualité optimale du produit : ils enlèvent les feuilles (toxiques) et retirent la ligule située aux extrémités de la tige, responsable d’une amertume très désagréable.
La suite concerne le traitement de la rhubarbe, qui doit être défibrée et broyée avant de subir sa fermentation. Une machine ad-hoc, conçue par Damien Moine permet désormais d’automatiser cette étape fastidieuse mais déterminante pour la limpidité du « vin ». Avec la rhubarbe les fermentations sont lentes et poussives, il faut en effet compter sur un temps de 3 années avant de voir les blancs de rhubarbe mis sur le marché, ce qui explique en partie les prix relativement onéreux* de la famille Moine.
L’aventure japonaise et le succès parisien
Comme bien souvent, le rôle des sommeliers va se révéler très important pour assoir la notoriété d’un produit hautement atypique, susceptible de susciter pas mal de défiance.
Par le canal de leur professionnalisme, ils ont su rassurer une clientèle peu encline à aller vers ce type de boisson, tout en trouvant dans le « vin » de rhubarbe une véritable martingale pour étonner leur clientèle.
C’est au célèbre salon gastronomique Foodex à Tokyo en 1993, que le destin de Michel Moine bascule grâce à l’enthousiasme d’un des meilleurs sommeliers japonais de l’époque.
Puis le vin de rhubarbe se fait une place auprès des sommeliers des palaces parisiens, le Crillon en tête, qui ne pouvait ne pas éluder la cuvée éponyme (Crillon des Vosges) pour sa table gastronomique.
Blanc des Vosges et Crillon des Vosges
Sur un profil de vin blanc sec, le blanc des Vosges étonne en premier lieu par sa verticalité, à l’image de l’élégante flûte alsacienne bleutée dans laquelle le vin de rhubarbe est embouteillé. La ligne est élancée, fraîche et tonique tandis que l’aromatique laisse apparaître tout logiquement les senteurs de rhubarbe. Son caractère aromatique n’est pas envahissant et renvoie au répertoire du cépage chenin dont la rhubarbe est un des fameux descripteurs aromatiques. Le blanc des Vosges offre ainsi la structure d’un véritable vin et dégusté à l’aveugle, il parvient aisément à tromper ses origines !
Dans sa version moelleuse, le Crillon des Vosges tutoie les sommets, un équilibre souverain adosse le fruit luxuriant de la rhubarbe au moelleux du sucre, le tout avivé par l’acidité naturelle du fruit. Une superbe option originale pour votre foie gras de fin d’année.
Raphno
*Le vin de rhubarbe est commercialisé autour de 20 euros.
Crédit photo : David Morris/Wikimedia (cc)
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







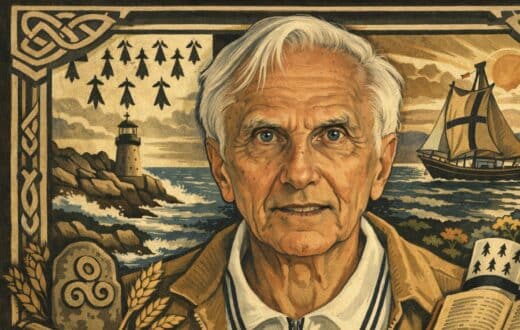


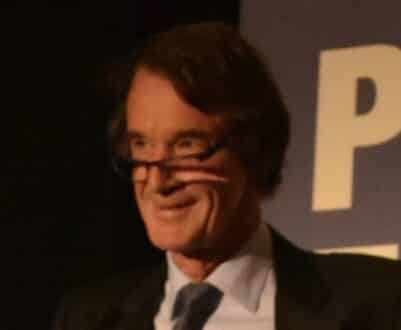

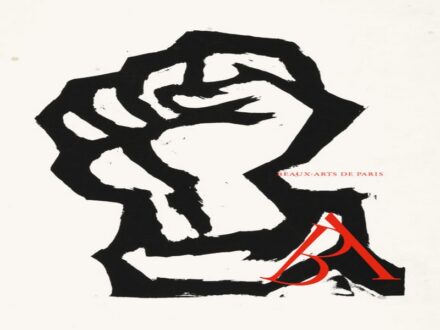

2 réponses à “La rhubarbe et son blanc fermenté, une spécialité des Vosges”
merci de faire connaitre ce produit, très bonne idée pour Noël j’ai acheté!
Je n’aime pas la rhu barba papa! En revanche excellent pour lâcher les petits boyaux comme les pruneaux! Quoi un produit de Lorraine comme celui qui nous montre le bout de sa langue rose…euh…euh…euh…la semaine prochaine je note sur un carnet avec des barres