C’était un matin humide comme en connaît la côte bigoudène à l’approche de l’hiver. Dans ma cuisine, je pelais quelques pommes de terre pour un ragoût Pétain, hérité du temps des restrictions et resté populaire dans le Pays bigouden : lard, oignons, laurier, patates, carottes et un peu d’eau. Pendant que le bouillon frémissait, je regardais sur mon téléphone les images de la visite du président argentin Javier Milei en Bolivie, saluant le nouveau gouvernement de droite. Ce qui m’a frappé d’emblée, c’est la couleur : ces dirigeants boliviens auraient pu être croisés dans les rues de Milan ou de Londres, visages pâles, costumes ajustés, diction policée. Rien ne rappelait les visages aymaras, les ponchos ou les tissages bariolés qui peuplaient naguère les tribunes officielles de La Paz. Le contraste m’a ramené à une idée fixe : sous toutes les latitudes américaines, d’Alaska au détroit de Magellan, le pouvoir conserve le teint des conquistadors. Les visages du commandement sont restés européens, et cela se devine dans les cabinets ministériels, dans les campagnes d’affichage, jusque sur les plateaux de télévision, où la couleur dominante du pouvoir demeure celle de la vieille Europe.
En Argentine, Milei s’est entouré d’un gouvernement absolument monocolore, non seulement libéral et libertarien, mais européen jusqu’au bout des ongles. Rien ne reflète cette moitié créole et métisse du pays, celle qui habite le Nord-Ouest, les faubourgs des grandes villes ou les marges du Chaco. Au Brésil, le même phénomène se constate : un gouvernement où dominent les descendants des Portugais et des Italiens. En Afrique du Sud, c’est l’inverse exact : la majorité noire gouverne comme si les autres composantes n’existaient plus. L’idéologie égalitaire proclame la fin des hiérarchies, mais les images la trahissent : le pouvoir a gardé la même couleur. Il suffit de regarder les lieux du pouvoir politico-médiatique pour deviner, sous le vernis démocratique, la persistance du visage européen en Amérique ou de l’ethnie dominante en Afrique.
C’est à cela que je pensais, le couteau à la main, lorsque je parcourus la presse française et tombai sur la polémique qui secoue les réseaux X : un certain Pierre-Yves Rougeyron, figure du « souverainisme », pris pour cible par les milieux identitaires. Un affrontement symptomatique : la droite morale contre la droite charnelle, la France contractuelle contre la France organique. Rougeyron, c’est le verbe gras du patriotisme juridique, celui qui s’imagine que la nation tient dans un décret de naturalisation.
Depuis mon arrivée en Europe, j’ai toujours été fasciné par ces hommes qui croient ressusciter la grandeur de la France en ignorant son identité physique pour n’épouser que son identité morale. Étudiant, j’avais lu dans L’Action française un titre indigné contre une mesure d’autonomie accordée à la Nouvelle-Calédonie : « nos compatriotes kanaks s’éloignent de la France ! » Ces rédacteurs, sincères peut-être, croyaient qu’une phrase de droit suffisait à combler un abîme d’histoire et de sang. Il y a là un aveuglement persistant : celui qui nie la réalité humaine pour ne voir que l’étiquette, celui qui affirme que les Antillais ou les Réunionnais sont « aussi français » que les descendants de Gaulois, en oubliant que leur identité afro-descendante et leur mémoire d’esclaves composent une autre réalité, ni meilleure ni pire, mais distincte.
Les souverainistes d’école me rappellent cette vieille présidente de l’association des Filles de la Révolution américaine à qui un journaliste anglais facétieux demanda : « Qu’est-ce qu’être américain ? » Elle répondit : « Adopter les principes de la Constitution. » Être, pour elle, se réduisait à signer un contrat. Rougeyron pense de même. Pour lui, la nationalité est un bail qu’on peut résilier à volonté, comme celui d’un véhicule de location qu’on rend à la sortie de l’aéroport. C’est pourquoi il peut prétendre se sentir « plus proche d’un Algérien que d’un Estonien », confondant la langue française apprise à l’école avec l’héritage génétique transmis par les siècles.
La polémique qui le déchire aujourd’hui ne tombe pas du ciel : elle prolonge, sous nos latitudes, la querelle qui divise la droite américaine entre les universalistes à la Ben Shapiro et les identitaires à la Nick Fuentes. Là-bas, comme ici, l’illusion du droit abstrait se heurte à la permanence du réel. Le réel, c’est comprendre qu’un papier ne fait pas un peuple, qu’une carte d’identité ne suffit pas à engendrer une âme collective. Il suffit de descendre dans le métro parisien pour constater que la République a beau tamponner, elle ne transforme pas, n’intègre pas, elle juxtapose.
Rougeyron, nourri de rêves de puissance, croit que le nombre fait la victoire : qu’il suffirait d’ajouter cent millions d’Africains francophones à quelques millions d’Européens pour retrouver la puissance de l’empire de 1805 ! Vision absurde, qui confond démographie et destin. Ce n’est pas la quantité qui sauve les civilisations, c’est le sang, pourrait dire Spengler et, Rougeyron, lui, n’a ni forme ni colonne vertébrale idéologique.
Né en 1982, ancien de l’ESSEC, fondateur du Cercle Aristote, il s’est voulu le dernier des gaullistes, le trait d’union entre la gauche sociale et la droite nationale. En réalité, il incarne le confusionnisme contemporain : il vend du gaullisme aux identitaires, du social aux gauchistes, et de l’anti-libéralisme aux libéraux repus. En 2024, sa liste anti-UE fit moins de 1 %.
Puis, en novembre 2025, la droite numérique le livra à la curée. Les citations volèrent bas mais frappèrent juste.
« La surestimation de Rougeyron dans nos cercles, écrivait un internaute, vient du biais pro-géopolitique de notre public. Tout glandu qui géopolitise sur YouTube passe pour un génie, même s’il se trompe trois fois sur quatre. Dès qu’on dit Chine, Iran, missiles, Wall Street ou Poutine, ça les fait mouiller. »
Et un autre : « La droite internet n’aime pas la culture. Ces types n’ont jamais vu un film de Bergman ni lu Flaubert, mais ils sont incollables en Xavier-Moreau-logie de mes couilles. »
Rougeyron cristallise cette misère culturelle. Il parle lentement, pontifie, mais ne dit rien. Son débat face à Bégaudeau, en 2024, fut un désastre. À la question : « Citez une œuvre vivante qui perpétue l’esprit gaulliste », il balbutia : « Braudel ? Tavernier ? » Bégaudeau éclata de rire, et la toile tout entière avec lui. Depuis, les mèmes se succèdent : « Regarde PYR comme un insecte qui se noie », « Jabba le Hutt à lunettes », « Ce type doit tomber ».
Le plus grave fut sa réaction après le meurtre de Lola, commis par une OQTF algérienne. Rougeyron osa dire : « Les européistes identitaires ont du sang sur les mains », visant Zemmour, mais touchant tous les nationaux. Phrase qui scella sa rupture avec les milieux non souverainistes. « Je suis peut-être grande gueule, déclara Conversano, mais jamais il ne me serait venu à l’idée de condamner les miens pour la mort d’une enfant. » L’affaire suffit à transformer le souverainiste en traître aux yeux de toute une génération identitaire.
Sur X, leur colère s’épancha en torrent :
« C’est un cuistre suivi par des cuistres. »
« Les pines d’huîtres qui l’écoutent religieusement se sentent très intelligentes parce qu’il name-droppe des historiens. »
« Ce gaullo-souverainisme antiraciste est une farce. »
Ces outrances disent pourtant quelque chose : la fatigue d’une droite qui ne croit plus qu’à la géopolitique. On ne lit plus, on cartographie ; on ne pense plus, on commente. « La droite internet, écrit un autre, croit que la revue d’actualité est la seule connaissance valable. » Cette génération parle de Poutine, de Zelensky, d’Eurasie ou de missiles, et se sent savante. La culture, la poésie, le sang, tout ce qui faisait une civilisation, s’est effacé sous le bavardage analytique.
Rougeyron, comme tant d’autres, croit encore que la France est une entreprise à sauver, non une chair à protéger. Il parle de « souveraineté » sans savoir de qui. Il rêve d’un État fort peuplé de citoyens interchangeables. Il ne comprend pas que le droit sans identité est un corps sans os. Le général de Gaulle, qu’il invoque à tout propos, avait ce réalisme charnel : « On ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. » Rougeyron, lui, s’enivre de symboles.
Les peuples, pourtant, finissent toujours par revenir. Spengler l’avait pressenti, Jünger l’avait vécu : le réalisme, c’est sentir le sang battre sous la peau de l’Histoire. Ceux qui refusent de l’accepter parleront longtemps encore de souveraineté, de constitution et de contrats ; ils s’éteindront en bavardant.
Dehors, la pluie bretonne redoublait. Le ragoût épaississait. Le gras remontait à la surface comme un souvenir d’Ancien Monde. Je le versai sur une tranche de pain grillé, en songeant que, dans les civilisations comme dans les cuisines, il faut du feu dessous pour que tout prenne.
La France, paradoxalement, abrite aujourd’hui les deux pôles de ce grand affrontement : le souverainisme le plus archaïque, figé dans ses rêveries pseudo gaulliennes et ses déclamations sur l’État multicolore, et, dans le même temps, l’école de pensée qui a conçu les outils intellectuels du souverainisme identitaire. D’Alain de Benoist à Guillaume Faye, cette France-là, qu’on croit disparue, a déjà formulé les prémisses de l’Europe de demain, comme l’Amérique identitaire se cherche un chemin vers la survie. Les nations renaissent d’abord dans les têtes avant de reprendre chair dans l’Histoire.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



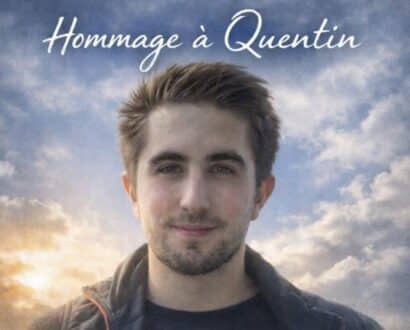
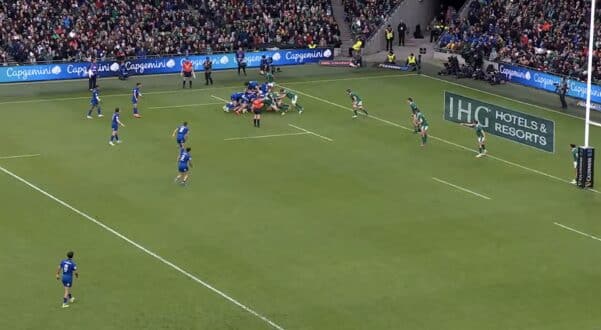

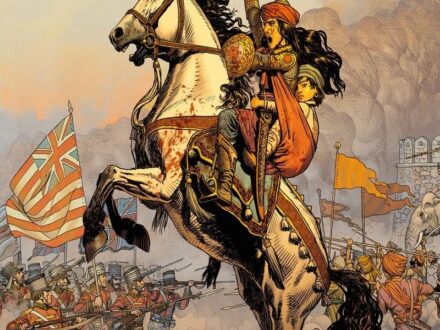



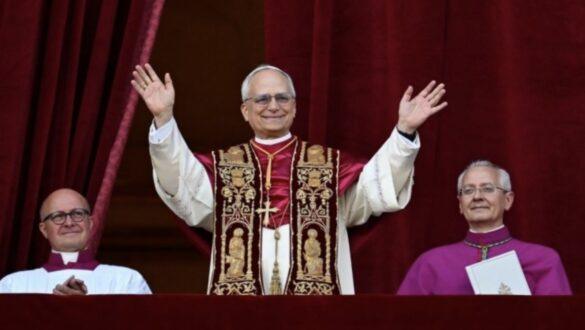


5 réponses à “Pierre-Yves Rougeyron ou l’illusion souverainiste”
Bonjour,
Ce qui est terrible, c’est que les européistes identitaires ne valent pas plus cher.
Cdt.
M.D
Tellement d’accord ! Pitoyable…
Quel malheur d’avoir cité à la fin de l’article les clowns de la Nouvelle Droite Faye et de Benoist.
C’est comme bicher sur une nana et découvrir à la fin que c’est un mec.
Si je comprends bien, PYR serait le pire des souverainistes ; ce n’est pas plus pire que si c’était pire dixit notre regretté Coluche ; au contraire, les identitaires gaullistes et les souverainistes doivent s’unir qu’ils soient de droite ou de gauche d’où qu’ils viennent, quel que soit l’origine du parti ou de l’association pour réaliser un score honorable aux futures élections ; par exemple, son analyse sur TVL sur la décision du gouvernement allemand de faire drastiquement chuter les coûts de l’énergie pour sauver son industrie et de quoi tirer vers le bas l’économie française et européenne est pertinente (source : Macron : des Rafale pour Zelensky noyé dans un scandale de corruption -JT du lundi 17 novembre 2025 https://www.youtube.com/watch?v=MJBx82apmKk). Des fois c’est vrai, je ne comprends pas tout ce qu’il dit mais ce n’est pas si grave ; la situation de notre beau pays l’est bien plus actuellement.
Très bel article qui relate très bien les forces en présence et les psychés qui vont avec.