Une enquête menée par ACASI auprès de 1 701 travailleurs indépendants met en lumière un fait rarement quantifié : la grande majorité d’entre eux n’exploite pas les déductions fiscales auxquelles ils ont droit. Selon les résultats, seuls 5 % des répondants parviennent à identifier correctement les principaux leviers légaux d’optimisation. Un manque de maîtrise qui représenterait, à l’échelle nationale, entre 10 et 17 milliards d’euros de déductions non utilisées chaque année.
L’étude montre d’abord un décalage net entre les dispositifs perçus comme importants et ceux qui produisent réellement un impact immédiat. Les montages complexes — holdings ou SCI — sont très souvent cités, alors qu’ils ne concernent que des situations patrimoniales spécifiques. À l’inverse, des outils simples et directement applicables, comme les indemnités kilométriques, le loyer du domicile ou le Plan épargne retraite, restent peu utilisés alors qu’ils figurent parmi les leviers les plus efficaces.
Interrogés sur les pratiques qu’ils appliquent déjà, beaucoup d’indépendants évoquent une “optimisation du statut juridique”, sans que la nature exacte de ces choix soit précisée. Les chiffres montrent plutôt des usages partiels ou incohérents : une minorité déclare utiliser les chèques-vacances, les CESU ou la rémunération du compte courant d’associé, tandis que les dépenses de formation et le PER, pourtant accessibles, restent loin d’être systématiques.
L’un des apports essentiels de l’enquête concerne la perception des montants déductibles. Seuls 22 % des répondants estiment correctement le potentiel annuel moyen, situé entre 3 000 et 5 000 euros. ACASI souligne que certains profils, bien accompagnés, dépassent 10 000 euros de déductions. Transposé aux 3,4 millions d’indépendants recensés en France, ce déficit d’utilisation représente plusieurs milliards chaque année.
L’étude identifie également les raisons de cette sous-optimisation. La majorité des indépendants évoque un manque d’information claire, une complexité administrative dissuasive et une crainte persistante de l’erreur ou du redressement. Plus de la moitié indiquent ne pas disposer du temps nécessaire pour gérer ces questions fiscales, et près de six indépendants sur dix reconnaissent qu’ils ne conservent pas systématiquement les justificatifs requis en cas de contrôle.
Au-delà des perceptions, les craintes exprimées portent surtout sur la mauvaise qualification des dépenses ou sur les erreurs liées aux plafonds et aux proratas, deux points qui concentrent effectivement l’essentiel des redressements. Le contrôle fiscal en tant que tel arrive seulement en troisième position, mais reflète un climat d’incertitude plus large.
Lorsqu’on leur demande ce qui pourrait faciliter leur passage à l’action, les répondants citent en priorité des outils concrets : automatisations, modèles de documents, guides pas-à-pas et, dans une moindre mesure, un échange direct avec un expert-comptable. L’enjeu, pour beaucoup, n’est pas théorique mais pratique.
Le tableau dressé par ACASI est celui d’un secteur où l’information circule mal et où des dispositifs simples demeurent peu utilisés, faute de temps ou de clarté. L’étude rappelle qu’une part importante de l’optimisation fiscale des indépendants repose sur des gestes administratifs accessibles mais peu connus, alors même qu’ils pourraient améliorer sensiblement le revenu net de millions de travailleurs.
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..










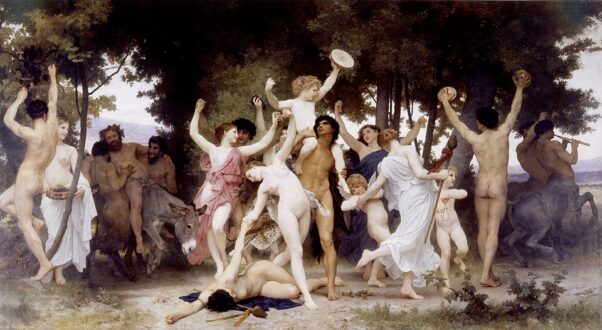



3 réponses à “Les indépendants laissent filer des milliards en déductions fiscales : une étude révèle l’ampleur du gâchis”
Bonjour,
Les indépendants ont choisi ce métier pour travailler et faire de l’argent, pas pour perdre du temps en déclarations fiscales qui les assomment par ailleurs. Ces déductions, comme l’ensemble du système, est fait pour les grosses entreprises.
Cdt.
M.D
Les artisans et travailleurs indépendants n’ont pas les moyens de se payer des avocats fiscalistes pour remplir leurs feuille d’impôts . Eux , ils paient plein pot et n’expatrient pas une partie de leurs revenus et avoir, à l’étranger
C’est simple, plus on complexifie la fiscalité et plus les petits indépendants ou libéraux sont largués avec des règles compliquées et changeantes tous les ans…seuls les grands groupes payant des fiscalistes ( experts comptables, avocats fiscalistes ) à l’année ne font aucune erreur et profitent à fond du système….