Alors que l’Occident doute de lui-même, que la natalité s’effondre et que l’individualisme règne, un sociologue américain sonne l’alarme. Brad Wilcox, professeur à l’université de Virginie, défend dans un livre à contre-courant une vérité simple mais délaissée : se marier, fonder une famille, transmettre. Non par nostalgie, mais parce que c’est vital.
À l’heure où le divorce est banalisé, où l’on célèbre l’« indépendance » affective et financière, le livre Get Married: Why Americans Should Defy the Elites, Forge Strong Families, and Save Civilization (2024) (qui mériterait d’être traduit en français) remet les pendules à l’heure. Son auteur, Brad Wilcox, est sociologue, père de famille, et directeur du National Marriage Project. Son constat est limpide : le déclin du mariage et de la famille est un effondrement social majeur, et il est urgent d’en inverser la tendance.
Le mariage n’est pas un fardeau, c’est un accomplissement
Le discours dominant, explique Wilcox, présente le mariage et la parentalité comme des fardeaux, des contraintes à fuir pour préserver son confort personnel. Or, si la vie de famille suppose des sacrifices, elle est aussi source d’amour, de joie, de stabilité et de sens.
Le sociologue évoque l’exemple personnel de ses jumelles. Lui et sa femme ont traversé des années difficiles, mais aujourd’hui, il savoure ces instants simples : une étreinte, un baiser sur le front, une attention reçue en fin de journée. « Rien de cela n’aurait existé si je n’avais pas choisi, vingt ans plus tôt, de construire une famille », confie-t-il.
À l’instar d’un athlète qui s’entraîne pour atteindre l’excellence, devenir un bon conjoint ou un bon parent requiert discipline et engagement. Mais les bénéfices sont durables, profonds, structurels.
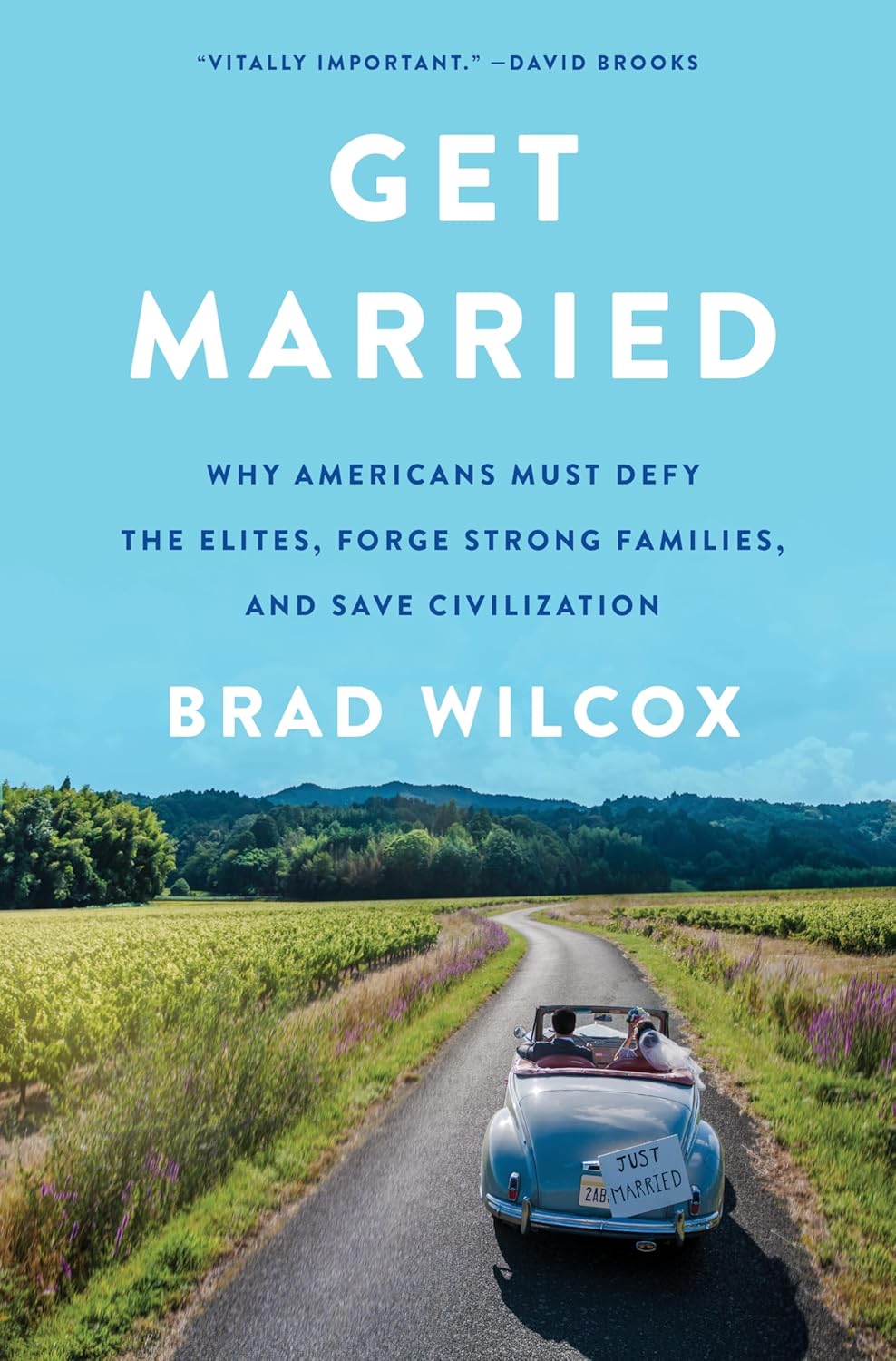
Effondrement chez les classes populaires : le prix de l’individualisme
Wilcox met en lumière une fracture préoccupante : les Américains les plus modestes, notamment ceux sans diplôme universitaire, se marient de moins en moins. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la chute de la pratique religieuse, la précarisation du travail masculin, la culture de l’instant, et les politiques de l’État-providence qui ont marginalisé l’institution matrimoniale.
« Le travail à plein temps est un prédicteur majeur du mariage et de sa stabilité », rappelle Wilcox. Or, la disparition progressive de l’emploi stable dans certaines couches sociales a rendu le projet familial plus difficile à envisager, notamment pour les hommes.
Ajoutez à cela des décennies de relativisme moral sur les relations, la sexualité, les responsabilités parentales… et vous obtenez un cocktail explosif : moins de mariages, plus de séparations, et des enfants livrés à eux-mêmes.
Pop culture et “Moi d’abord” : la fabrique du désastre
Depuis les années 1970, les messages culturels vantent un idéal centré sur l’accomplissement personnel, la quête du plaisir immédiat, l’idée que l’on peut (et doit) tout quitter dès que la relation devient difficile. Résultat ? Une perte de repères, des attentes irréalistes, et une instabilité chronique.
Wilcox dénonce le mythe du « partenaire parfait » : ce fantasme, martelé par les chansons, les films, les romans, fait croire que l’amour doit toujours être passionné, fluide, exempt de conflits. Un idéal impossible, qui pousse nombre de couples à renoncer trop vite, à défaut d’avoir appris à aimer vraiment – c’est-à-dire avec persévérance.
Le sociologue défend au contraire un mariage « orienté famille » : une union fondée sur la solidarité, la responsabilité, la construction d’un foyer commun. « Le mariage est un contrat social, pas une simple aventure émotionnelle », martèle-t-il.
Si le mariage n’est pas réservé aux croyants, il est indéniable – chiffres à l’appui – que les couples religieux sont plus souvent mariés, plus heureux et plus stables que les couples séculiers. Ils ont aussi, fait peu médiatisé, une vie sexuelle plus épanouie.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont soutenus par des normes de fidélité, des réseaux communautaires, et une dimension spirituelle qui donne sens aux sacrifices. La foi, résume Wilcox, aide à accepter les épreuves inévitables de la vie familiale et à y trouver de la grandeur.
Richesse, stabilité, héritage : les fruits invisibles du mariage
Au-delà des considérations affectives, le mariage a des effets tangibles. Les hommes mariés ont environ 50 % de risque en moins d’être pauvres. Pour les femmes, c’est 80 %. Les couples mariés possèdent dix fois plus d’actifs que les célibataires du même âge.
Ils investissent, épargnent, travaillent avec plus de sérieux. Ils construisent. Et surtout, ils transmettent : des biens, des valeurs, des récits familiaux. Le sociologue évoque avec émotion son beau-père racontant sa jeunesse et la guerre du Vietnam à ses petits-enfants – perpétuant ainsi une mémoire, une lignée, un sens.
Brad Wilcox ne parle pas de morale, mais de survie culturelle. Une société qui marginalise le mariage, qui saborde la famille, qui érige l’individualisme en dogme, court à sa perte. Le mariage n’est pas une mode dépassée, c’est une institution fondatrice.
« Vivre pour soi, c’est mourir seul. Vivre pour les autres, c’est exister vraiment », semble nous dire Wilcox.
Son message est limpide : il est temps de refonder nos vies non sur le caprice, mais sur l’engagement. Non sur l’illusion de liberté totale, mais sur la fécondité d’un “nous”. Car c’est là que commence toute civilisation.
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












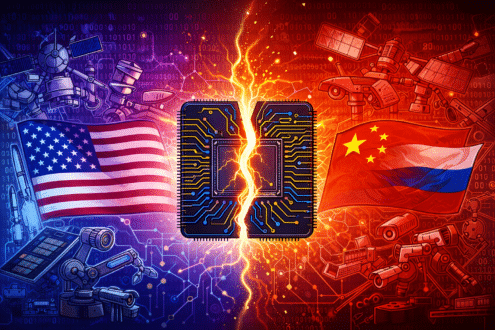

8 réponses à “Mariage et famille : les piliers oubliés de la civilisation moderne”
Tout à fait d’accord, mais il est difficile de trouver une fille de nos jours ouverte au mariage. Elles ont peur de l’engagement et cherche l’homme idéal sans jamais le trouver.
Ayant eu deux enfants avec une femme rencontrée au travail, je pense, à 65 ans, qu’il faut donner l’exemple d’une famille unie, solidaire et bienveillante ; et pourtant, il y en a eu des hauts et des bas depuis ce mariage célébré en Cathédrale il y a maintenant 35 ans car si on se marie, c’est pour le meilleur et pour le pire ; Dieu me dit cela tous les jours et finalement la vie coule cool aujourd’hui et demain aussi, j’en suis sûr.
La normalité, c’est un mariage d’Amour, quand même assez rare, à mes yeux.
Un mariage de Raison peut y suppléer dès lors que la confiance, la similitude des expériences vécues même malheureuses et la solidarité sont assurées.
Il est vrai que maintenant: « Si tu n’as pas divorcé, tu as raté ta Vie ».
Au plan des idées je suis d’accord mais c’est encore un bouquin yankee et nous n’en voulons plus de la main mise de ces chiens de puritains du May Flower sur notre pensée tout comme nous en avons ras le bol des études sur tout et sur rien de ces donneurs de leçons mondiaux sur notre santé… »yaka fokon… fokon yaka »! Qu’ils se préoccupent de leurs 20 à 25 millions de pauvres sans carte bleue qui n’ont aucun soin médical les sublimes donneurs de leçons à la planète entière! Très récemment dans le Tarn ou le Lot un enfant de deux ans décède de mauvais traitements…encore un couple de feignassous de la Gueuse! Deux siècles de bordel avec cette république, beau bilan!
En mai 68:Cohn-Bendit et d’autres gauchistes criaient: »Il est interdit d’interdire » et la Sorbonne était devenue un vaste bor…,les »fils à papa » allaient vivre en »communauté » sur le Larzac à élever des chèvres tout en acceptant les sous que leurs parents leur envoyaient…Les divorces sont devenus de plus en plus nombreux…les parents voulaient »vivre leur vie » comme s’ils avaient été malheureux AVANT…ils ne se rendaient pas compte qu’ils rendaient leurs enfants malheureux…ceux-ci se mettaient à se droguer pour oublier que leurs parents ne les aimaient plus!…Maintenant les »Jeunes » Français ne se marient plus:…mais sont-ils plus heureux que nous l’étions »autrefois »?…J’en doute!…Je pense que pour les enfants perdre l’amour de leurs parents est catastrophique!…Je crois que des enfants de parents pauvres mais pas divorcés sont plus heureux que des enfants de parents riches qui sont divorcés…ceux-ci ont de l’argent plein leurs poches mais ils ne sont pas heureux!..
@Florian : Après 35 ans de vie commune avec ma douceur sans être marier , cette dernière sur un lit d’hôpital ou elle était hospitalisée pour un problème dermatologique ma demander le mariage, le lendemain je lui est dit oui ; 6 mois après c’était fait en petit commité devant monsieur le maire ; c’était il y a deux ans , j’ai 66ans et elle 79 , nous nous sommes connue a l’age d’or du minitel sur un « forum » dont le fondateur était le patron de Free.
Trugarez deoc’h pour ce résumé de livre.
On y retrouve la raison de la fondation de notre association « Emglev an Tiegezhioù » association catholique de familles bretonnantes https://emglev.wordpress.com/
Cette semaine est né notre quatrième petit fils. Pebezh levenez !
Il faut dire clairement que le mariage est la voie principale du bonheur humain dans la civilisation chrétienne ; il est ordonné à l’amour trinitaire. La Trinité est communauté d’amour, et ce lien de l’amour est si grand qu’il en est la troisième personne, l’Esprit Saint. A méditer. Graet eo an den evit karout.
Chapeau camarade Poulbot pour votre fidélité…Généralement ce sont les époux qui sont plus (voire beaucoup plus âgés).
Mon épouse décédée, parfaite en tout point, avait 20 mois de plus que moi.