La Cour des comptes vient de publier, le 15 septembre 2025, un rapport au vitriol sur le financement des transports collectifs urbains (TCU). Loin de l’image séduisante d’une mobilité « gratuite », l’institution rappelle une réalité simple : ce qui n’est pas payé par l’usager l’est par le contribuable. Et le modèle français, fragile, accuse un retard inquiétant face à ses voisins européens.
Une chute spectaculaire de la part des usagers
En 1975, les recettes tarifaires assuraient 75 % du financement des transports urbains. En 2022, elles ne couvrent plus que 28 % des coûts d’exploitation. Dans certains territoires, cette part tombe à 18 %. En moyenne, un trajet en transport collectif coûte 3,58 €, mais l’usager n’en paie que 0,79 €. Le reste est couvert par l’employeur (via le versement mobilité) et surtout par la collectivité, c’est-à-dire l’impôt.
La Cour souligne que les Français n’ont souvent plus conscience du coût réel de ces services, alimentant un discours politique trompeur sur la « gratuité ».
Les dérives de la gratuité
En 2024, 46 territoires représentant 2,8 millions d’habitants avaient instauré la gratuité totale. Si les petites agglomérations y trouvent parfois un outil d’attractivité, les grandes métropoles paient le prix fort. À Montpellier, la suppression des tickets représente une perte de 40 millions d’euros de recettes annuelles. Dunkerque ou Calais ont vu leurs coûts bondir pour absorber une fréquentation en hausse, sans que le report de la voiture vers les transports en commun ne soit à la hauteur des espérances.
La Cour des comptes dénonce un manque d’évaluations sérieuses avant ces décisions politiques : absence d’études socio-économiques, faible transparence sur les coûts, concertation insuffisante.
Un financement reposant sur l’impôt et le versement mobilité
Aujourd’hui, les usagers assurent à peine un quart du financement. Les employeurs, via le versement mobilité (VM), en portent près de la moitié. Le reste est supporté par les collectivités locales, c’est-à-dire les contribuables. Mais le VM, plafonné à 2 % hors Île-de-France et 3,2 % en Île-de-France, atteint ses limites dans la moitié des grandes agglomérations.
Résultat : les budgets des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont sous tension, alors même que les besoins explosent : modernisation des réseaux, extension des lignes, verdissement des flottes. La seule conversion de la moitié des bus en véhicules électriques d’ici 2035 représenterait un surcoût de 6,3 milliards d’euros.
Sept recommandations pour rééquilibrer le système
La Cour propose un ensemble de mesures pour réintroduire de la responsabilité tarifaire, sans fragiliser les plus modestes :
- publier des comptes déplacements transparents sur les coûts et financements ;
- renforcer la lutte contre la fraude ;
- cibler les réductions tarifaires sur des critères de ressources ;
- faciliter l’octroi automatique de tarifs sociaux ;
- améliorer l’enquête nationale TCU ;
- évaluer ex ante et ex post les changements tarifaires ;
- moduler les aides de l’État en fonction de la part contributive des usagers
En clair : recentrer les efforts sur ceux qui en ont vraiment besoin, tout en rappelant aux autres que le service public de transport n’est pas gratuit.
Le gouvernement partage le diagnostic et annonce des incitations via la modulation des aides de l’État. Le Gart, qui fédère les AOM, se dit favorable à une réflexion sur la tarification mais regrette une focalisation excessive sur la gratuité, encore marginale dans les grandes villes. Montpellier, en revanche, persiste et signe : pour la métropole, la gratuité est un investissement social, écologique et économique, financé par un versement mobilité « dynamique ».
Ce rapport met en lumière une hypocrisie persistante : présenter comme « gratuite » une offre de transport dont le coût croissant est transféré aux contribuables et aux entreprises. Derrière l’argument écologique et social, la Cour des comptes alerte sur une impasse budgétaire : la gratuité généralisée est un mensonge comptable.
La vraie question posée est celle de la répartition équitable des charges. Si l’on veut que les transports collectifs demeurent un outil de cohésion et de transition écologique, il faudra assumer une vérité simple : rien n’est gratuit, et celui qui paie in fine, c’est toujours le contribuable.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












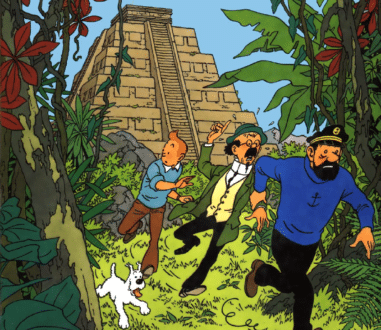

Une réponse à “Transports collectifs : la « gratuité » est un leurre, le contribuable en paie l’essentiel”
Il n’y a rien de gratuit et nous, nous payons partout car nous ne sommes que des cochons de payants, nos parents de même et de nos grands bien sûr également de même. C’est d’un gouvernement « à poigne » que nous avons besoin pour remettre chacun à sa place et les aides à tout va ce sera terminé! Et les fainéants seront mis au boulot à coups de rangers dans le cul s’il le faut.