Découvert en Ukraine et daté de plus de 40 000 ans, un fragment d’ocre taillé par des Néandertaliens bouleverse notre vision de ces “cousins” préhistoriques : ils peignaient, gravaient et pensaient bien avant Homo sapiens.
Les clichés ont la vie dure : pendant longtemps, on a décrit les Néandertaliens comme des brutes épaisses, des chasseurs maladroits sans imagination ni langage symbolique. Mais une nouvelle découverte en Crimée vient, une fois de plus, remettre les pendules à l’heure.
Selon une étude internationale publiée dans Science Advances, des fragments d’ocre façonnés et réutilisés par des Néandertaliens il y a environ 70 000 ans ont été mis au jour sur plusieurs sites de Crimée et d’Ukraine. Parmi eux, un objet exceptionnel : un véritable “crayon” d’ocre jaune, long de cinq à six centimètres, dont la pointe — encore affûtée — porte les traces d’un usage répété et d’un entretien minutieux.
Un outil pour dessiner, pas pour chasser
Les chercheurs, menés par Francesco d’Errico (Université de Bordeaux), ont analysé ces fragments à l’aide de la microscopie électronique et de la fluorescence X. Résultat : tous présentent des marques de raclage, de meulage, de polissage ou de gravure, preuve d’un façonnage intentionnel.
« Ce crayon a été entretenu et retaillé plusieurs fois. C’était un outil précieux », explique d’Errico.
Un second fragment révèle des surfaces polies et gravées, un troisième des lignes inscrites volontairement. Les traces d’usure suggèrent que ces “crayons” étaient frottés sur des surfaces souples, probablement pour tracer ou peindre. Autrement dit, il ne s’agissait pas d’un usage utilitaire, mais bien d’un acte symbolique ou artistique.
Les premières traces d’un imaginaire
Cette découverte s’ajoute à un ensemble de preuves accumulées ces dernières années : des tracés digitaux dans la boue de la grotte de La Roche-Cotard (Loire), des cercles de stalagmites dressés à Bruniquel, ou encore des mains soufflées et des signes géométriques dans les grottes espagnoles de Maltravieso ou La Pasiega.
Toutes ces marques, vieilles de 60 000 à 175 000 ans, ont été réalisées avant l’arrivée d’Homo sapiens en Europe.Elles témoignent d’un esprit capable d’abstraction, de rituel, voire d’un début de conscience de soi.
« On ne garde une pointe de crayon affûtée que si l’on cherche à tracer des lignes précises », souligne la paléoanthropologue April Nowell (Université de Victoria).
Autrement dit, ces hommes “primitifs” savaient déjà ce que signifie créer — et transmettre.
Quand l’art précède “l’homme moderne”
L’analyse chimique de l’ocre montre qu’elle provenait d’un gisement situé à 1,5 km du site. Les Néandertaliens transportaient donc volontairement la matière première, preuve d’une planification et d’une intention claire. Ces pigments servaient sans doute à orner le corps, les outils ou les parois, mais aussi à marquer des signes d’appartenance, d’identité ou de mémoire.
Pendant des décennies, on a voulu voir dans l’art pariétal — celui de Lascaux ou de Chauvet — l’acte fondateur de l’humanité moderne. Les Néandertaliens viennent rappeler que l’art n’est pas né d’un seul coup, ni d’un seul peuple. Il a germé lentement, dans des têtes d’hommes que l’on croyait sans âme.
Redéfinir ce que signifie “être humain”
Les paléontologues le reconnaissent désormais : les Néandertaliens n’étaient pas des bêtes, mais des hommes différents, dotés d’émotions, de mémoire et d’une forme d’esthétique. Ils naviguaient dans l’obscurité des grottes, choisissaient leurs pigments, traçaient leurs lignes — et, ce faisant, laissaient une trace d’eux-mêmes dans le temps.
Leur art n’était pas figuratif comme celui de nos ancêtres sapiens, mais il portait déjà la marque du sens : des lignes, des signes, des gestes. Les premières formes de pensée symbolique, les premiers échos de notre humanité commune.
Crédit photo : (photo credit: SHUTTERSTOCK)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



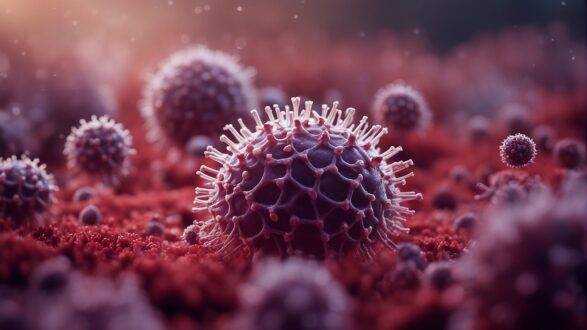


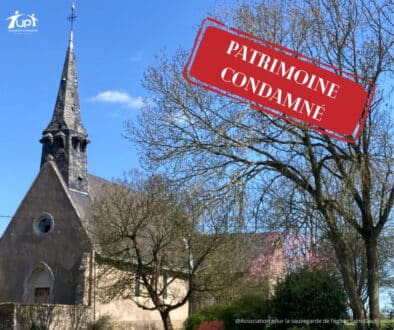
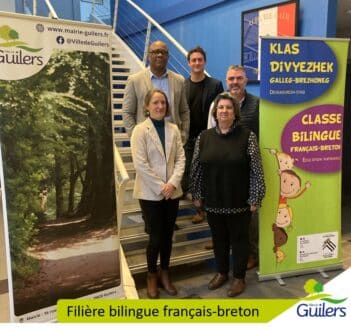

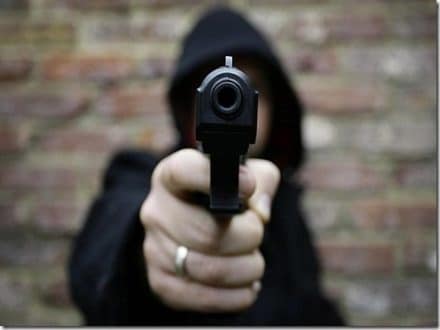
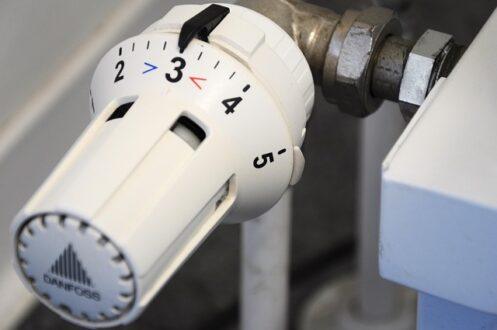

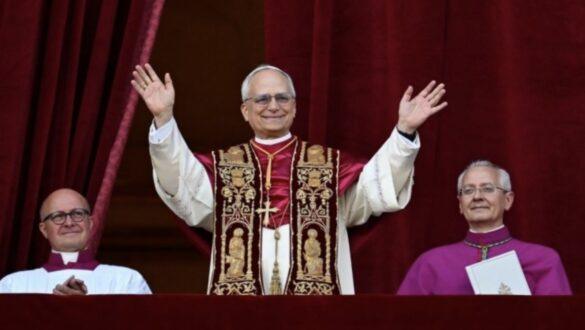

4 réponses à “Quand les Néandertaliens dessinaient déjà : en Crimée, un “crayon” d’ocre révèle la plus ancienne trace d’art symbolique humain”
Vous écrivez « Les paléontologues le reconnaissent désormais : les Néandertaliens n’étaient pas des bêtes, mais des hommes différents ». Ce n’est pas tout à fait exact. Les Néandertaliens n’ont jamais été considérés comme des bêtes. Au contraire, quand ils ont été découverts au 19e s., on a vu en eux un rameau de l’Homo Sapiens — nos cousins, en somme. On les considère aujourd’hui comme une autre espèce humaine, mais le débat demeure puisque l’hybridation entre Sapiens et Néandertaliens a été possible : nous avons tous, en Europe, quelque chose comme 2 % de gènes hérités des Néandertaliens (contre 0 % en Afrique noire, mais à part ça les races n’existent pas…).
Par ailleurs, votre illustration peut être trompeuse : on n’a trouvé à ce jour aucune représentation humaine ou animale tracée par un Néandertalien.
« Que sont mes amis les Pharaons nègres devenus » me demande mon ami Rutebeuf. Vous vous en souvenez de cette sublime découverte? Les négros descendus des cocotiers devenus d’un coup de baguette magique du Grand Prêtre de RA intelligents. A quand l’Inca nègre? A conseiller à Netflix. Vite un petit orangina frais qui fera « Pschitt » à l’ouverture!
d’après mon ADN (myheritage et genomnlink), j’ai 2.8% de neandertal, mais je n’ai pas pris l’aptitude à deesiner…;-) bizarre mais de toutes façons tout mon adn est bizarre, ex 36.6% en commun avec ma soeur, au lieu des 50 habituels, ce qui est très bas, mais nous n’avons aucun doute sur notre lien de parenté, nous sommes uniques eh eh eh l’avantage, c’est une grande résistance au froid et maladies depuis 79 ans
Raymond, on vous a perdu… Il va falloir arrêter les boissons énergisantes