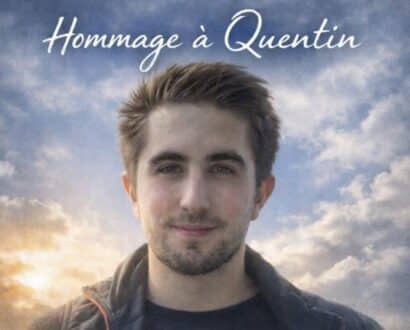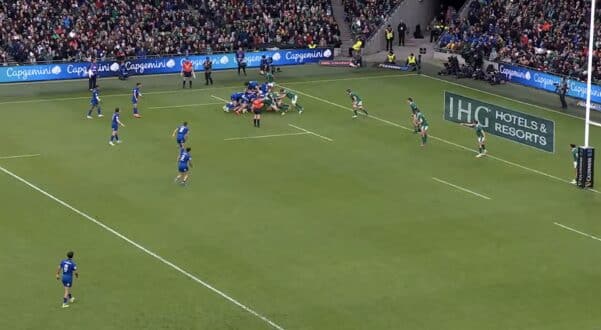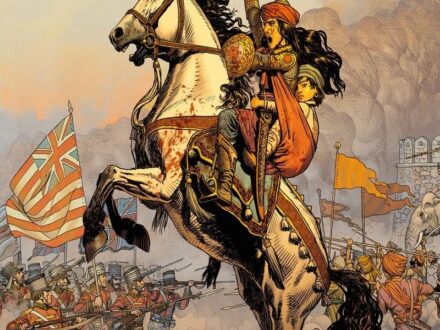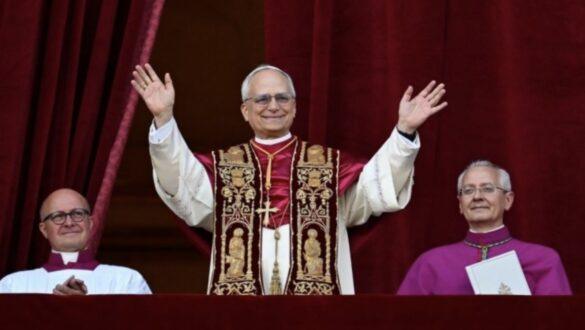Il y a, sur la Plaza Baquedano, au centre de Santiago, un vide plus éloquent qu’une statue : celui du général Manuel Baquedano, démonté de son cheval après les émeutes de 2019. Le socle est resté nu, couvert de poussière et de filets de chantier. C’est là, me disent les pages du Mercurio que je parcours de temps en temps en ligne quand l’actualité en Argentine est en berne, que tout avait commencé. Fumées, stations de métro incendiées, drapeaux rouges, cris de revanche sociale. Six ans plus tard, ce tumulte n’a laissé qu’un goût amer. Le Chili revient à droite, lassé de sa propre fièvre.
Les élections approchent et l’air de Santiago semble plus lourd que jamais. La gauche, incarnée par Jeannette Jara, la ministre communiste du Travail, caracole encore en tête des sondages, mais de peu : José Antonio Kast, du Parti républicain, la talonne. Johannes Kaiser, le libertarien, et Evelyn Matthei, héritière politique de Piñera, complètent le paysage. Tous savent pourtant qu’au second tour, la droite part favorite. Ce n’est pas un raz-de-marée idéologique, c’est un réflexe biologique : après la convulsion, vient le besoin d’ordre.
Le Chili d’aujourd’hui ne ressemble plus à celui des jours de Gabriel Boric. En 2021, la jeunesse progressiste rêvait d’un pays nouveau, d’une Constitution sortie des entrailles du peuple. L’utopie a tourné court. La grande Convention constituante, ivre de symboles, déguisée en carnaval, s’est autodétruite sous le ridicule. On voulait refonder la République ; on a fini par effrayer la nation. Le texte fut rejeté massivement. Puis vint un second projet, cette fois piloté par la droite, rejeté lui aussi. Deux naufrages en deux ans : de quoi vacciner tout un peuple contre la rhétorique des grands soirs.
Ce double échec a brisé le charme. Le pays qui croyait se réinventer s’est réveillé exsangue, frappé par l’inflation, les violences, l’immigration désordonnée, et une insécurité devenue obsession nationale. À Santiago, à Valparaíso, les slogans de 2019 ont cédé la place aux mots d’ordre de 2025 : « ordre », « sécurité », « respect de Carabineros ». Ceux qui jadis criaient contre la police réclament aujourd’hui qu’on la protège. La gauche, à force de s’excuser d’exister, a perdu l’autorité du réel.
Jeannette Jara, la candidate communiste, en est la démonstration : respectée pour son sérieux, elle traîne cependant l’ombre du président Boric, figure juvénile déjà vieillie. Son gouvernement n’a rien bâti de durable sinon la loi des 40 heures et quelques réformes salariales. Tout le reste s’est dissous dans le bavardage universitaire. Les Chiliens, eux, ne parlent plus d’égalité, mais de peur : peur du vol, peur du chaos, peur du migrant sans papiers. La rue est redevenue le thermomètre politique, et elle indique froidement le retour du conservatisme.
« Primero seguridad, después economía », explique un professeur cité par le Mercurio. La hiérarchie des besoins a basculé. Le rêve socialiste de 2019, nourri d’étudiants et de poètes, a fait place à la hantise sécuritaire de 2025. José Antonio Kast promet d’amnistier les carabineros jugés pour répression et d’augmenter leurs moyens ; Johannes Kaiser propose de créer un corps d’élite, d’envoyer les délinquants et les migrants illégaux purger leurs peines à l’étranger, suivant le modèle du président salvadorien Bukele. Des idées que l’on eût dites impensables il y a cinq ans sont désormais reçues avec soulagement.
Le plus tragique dans cette métamorphose, c’est qu’elle ne vient pas d’un coup d’État, mais d’un épuisement moral. Le peuple chilien n’a pas été vaincu, il s’est lassé. Les mêmes étudiants qui dressaient des barricades s’inquiètent aujourd’hui pour leurs enfants ; les ouvriers qui lançaient des pierres en 2019 travaillent désormais à reconstruire les murs qu’ils avaient abattus. Une nation entière s’est réveillée de son rêve d’égalité comme on sort d’une ivresse.
Il faut dire que le Chili a toujours été plus discipliné que sa voisine argentine, plus attaché à la rigueur qu’à l’éloquence. Là où Buenos Aires se grise de verbe, Santiago se crispe de méthode. L’Argentine, avec Milei, a choisi la rupture anarchique ; le Chili, lui, cherche à se reconsolider dans l’ordre. Deux peuples frères, mais deux tempéraments : l’un s’abandonne à la fureur libérale, l’autre au retour du gendarme. D’un côté, l’explosion de l’individualisme, de l’autre, la nostalgie de la hiérarchie. Et pourtant, sous ces formes contraires, on lit le même désenchantement : la fatigue d’une Amérique du Sud qui, après avoir cru au mythe de la justice sociale, redécouvre que la liberté sans autorité n’engendre que le chaos.
Relisant les pages du Mercurio, je songe aussi à l’histoire de ce journal, fondé en 1827 et devenu, au fil du temps, l’une des voix les plus puissantes du continent. C’est lui, rappelons-le, qui, au début des années 1970, osa dénoncer la dérive collectiviste du président Salvador Allende, au risque de la censure et de la ruine. La presse mondiale l’accusa d’avoir préparé le terrain au coup d’État du 11 septembre 1973 ; les Chiliens, eux, savent qu’il fut l’un des rares journaux à alerter sur le désastre économique et moral du socialisme. Le Mercurio n’a jamais été neutre : il a défendu l’ordre contre l’utopie, la hiérarchie contre la démagogie. Et, à sa manière, il continue aujourd’hui ce combat, en rappelant que la sécurité et la stabilité demeurent les deux colonnes de la civilisation.
Le Chili aura été, dans cette décennie, le miroir de l’Occident : une explosion d’utopie suivie d’un reflux brutal vers le besoin d’autorité. La statue de Baquedano, tombée sous les flammes de la révolte, attend toujours son cavalier. Le pays aussi.
Et tandis que j’éteins mon ordinateur après avoir lu les dernières analyses du Mercurio, je songe que le Chili, dans sa fatigue, nous ressemble. Nous aussi, Européens, vivons cette alternance de vertiges et de réveils. Nous aussi, entre l’excès d’égalité et la nostalgie de l’ordre, cherchons un équilibre que nous ne trouvons plus.
La France, à sa manière, abrite ce double visage du monde contemporain : le souverainisme le plus archaïque, figé dans ses certitudes jacobines, et, dans le même temps, l’école de pensée la plus lucide sur l’avenir identitaire des peuples. D’Alain de Benoist à Guillaume Faye, c’est ici, dans cette vieille Europe qui doute, que s’inventent déjà les catégories intellectuelles de demain — celles qui annoncent, sous les décombres du progressisme, le retour des civilisations enracinées.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]