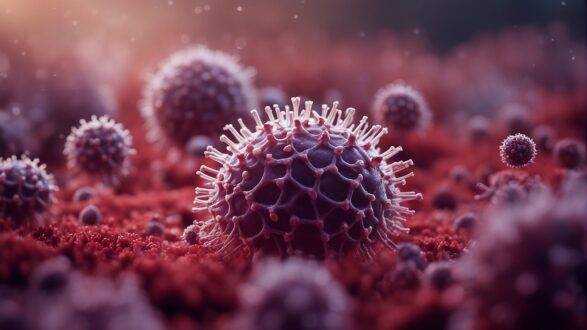Voici un nouvel extrait de La Légende de la mort en Basse-Bretagne, recueillie par Anatole Le Braz, pour accompagner jour après jour les lecteurs de Breizh-info.
Quoique Ludo Garel ne fût que domestique, ce n’était pas le premier venu. Il avait sans cesse l’esprit occupé d’une foule de choses auxquelles ne pense généralement pas le vulgaire. Ses continuelles méditations l’avaient mené très loin. Il avouait lui-même qu’il possédait à peu près à fond tout ce qu’il est donné à un homme de connaître.
— Toutefois, ajoutait-il, il y a encore un point qui m’embarrasse et sur lequel je n’ai aucune lumière : c’est la séparation de l’âme d’avec le corps. Quand j’aurai éclairci ce point, il ne me restera plus rien à apprendre.
Son maître, un des derniers survivants de la noble maison du Quinquiz, avait en lui grande confiance, le sachant homme d’honneur et de bon conseil.
Un beau jour, il le manda à son cabinet.
— Mon pauvre Ludo, lui dit-il, je ne suis pas du tout à mon aise aujourd’hui. Je couve, je crois, quelque mauvaise maladie, et j’ai le pressentiment que je n’en réchapperai pas. Si encore mes affaires étaient en règle !… Ce maudit procès que j’ai à Rennes me donne bien du tourment. Voici près de deux ans qu’il traîne. Si du moins je voyais le terminer à mon avantage, avant de mourir, je m’en irais le cœur plus léger. Je te tiens pour un garçon avisé, Ludo Garel. D’autre part, — tu me l’as assez prouvé, — il n’est pas de service que tu ne sois prêt à me rendre. Je te demande celui-ci, qui sera probablement le dernier. Demain matin, à la prime aube, tu te mettras en route pour Rennes. Tu feras visite à chacun des juges, et tu leur demanderas de se prononcer au plus vite ou pour ou contre moi. Tu as la langue bien pendue ; je compte que tu trouveras moyen de les disposer en ma faveur. Quant à moi, je vais me mettre au lit. Plaise à Dieu de ne me rappeler de ce monde que lorsque tu seras de retour.
Ludo, avant de prendre congé, s’efforça de relever les esprits abattus de son maître.
— Ne vous occupez que de vous remettre sur pied, monsieur le comte. Vous n’êtes pas encore mûr pour l’Ankou. Tâchez que je vous retrouve bien portant. Je me charge du reste, sur ma foi !
Il passa toute l’après-midi à faire ses préparatifs de voyage et à ruminer dans sa cervelle les discours qu’il tiendrait aux juges.
À la trouble-nuit[114], il se coucha, afin d’être réveillé de meilleure heure. Il dormit mal. Mille idées, mille propos incohérents lui galopaient dans la tête.
Soudain, il lui sembla entendre le chant du coq.
— Ho ! Ho ! se dit-il, voici la prime aube. Il est temps de déguerpir.
Et Ludo Garel en route.
On était au cœur de l’hiver. À peine s’il voyait clair pour marcher. Après une heure, une heure et demie de marche, il se trouva au pied d’un mur qui lui barrait le chemin. Il se mit à le longer, et arriva devant un escalier de pierre dont il gravit les degrés. C’était l’échalier d’un cimetière.
— Hum ! pensa Ludo, en se voyant entouré de tombes et de croix, heureusement que la mauvaise heure doit être passée depuis longtemps.
Il n’avait pas fini de se parler de la sorte qu’il vit une ombre se lever de terre et se diriger sur lui par une des allées latérales. Quand l’ombre fut toute proche, Ludo s’aperçut qu’il avait affaire en elle à un jeune homme de figure distinguée, vêtu d’étoffe noire et fine.
Il bonjoura le jeune homme.
— Bonjour, répondit celui-ci. Vous êtes de bonne heure en voyage.
— Je ne sais pas au juste quelle heure il peut être, mais le coq chantait quand j’ai quitté la maison.
— Oui, le coq blanc[115] ! repartit le jeune homme. Quel chemin faites-vous ?
— Je vais du côté de Rennes.
— Moi aussi. Si vous voulez bien, nous ferons un bout de route ensemble.
— Je ne demande pas mieux.
La mine et le ton du jeune homme inspiraient la confiance. Ludo Garel, un peu inquiet d’abord, fut bientôt enchanté de l’avoir pour compagnon, d’autant plus que le jour tardait terriblement à venir. Chemin faisant, ils causèrent. Peu à peu, Ludo devint expansif. Il mit l’inconnu du cimetière au courant de tout ce qui le concernait, de la maladie mystérieuse de son maître, des sombres pressentiments qu’il lui avait exprimés la veille, et du motif pour lequel il l’avait chargé d’entreprendre ce voyage. L’inconnu écoutait, mais ne disait presque rien.
Sur ces entrefaites, le chant du coq retentit dans une ferme voisine.
— Pour le coup, s’écria Ludo, l’aube va poindre.
— Pas encore, répondit le jeune homme. Le coq qui a chanté, c’est le coq gris.
En effet, le temps s’écoula, la nuit restait toujours aussi noire.
Nos gens continuèrent de marcher. Mais Ludo ayant vidé le sac de ses confidences, et l’inconnu ne paraissant pas disposé à livrer les siennes, la conversation languit, puis finit par s’éteindre.
Quand on ne cause pas, le jour, on s’ennuie ; la nuit, on a peur[116].
Ludo Garel commençait à dévisager son compagnon du coin de l’œil et à trouver son allure singulière. Il appelait la lumière de tous ses vœux. Enfin, un troisième coq chanta.
— Ah ! fit Ludo, avec un soupir de soulagement, cette fois du moins c’est le bon !
— Oui, répondit le jeune homme, cette fois c’est le coq rouge. Maintenant l’aube va blanchir le ciel. Mais vous voyez que vous l’aviez devancée de beaucoup. Il était à peine minuit quand vous êtes entré au cimetière où vous m’avez rencontré.
— C’est possible, fit Ludo à voix basse.
— Une autre fois, tâchez de tenir meilleur compte de l’heure. Si je ne vous avais accompagné jusqu’à ce moment, il vous serait arrivé plus d’une fâcheuse aventure.
— Grand merci, en ce cas ! murmura Ludo Garel humblement.
— Ce n’est pas tout. J’ai à vous dire qu’il est inutile que vous poursuiviez votre route. Le procès de votre maître est jugé depuis hier soir et c’est en faveur de votre maître que se sont prononcés les juges. Retournez donc près de lui, pour lui annoncer cette bonne nouvelle.
— Jésus-Maria-Credo ! Tant mieux, en vérité. Monsieur le comte va guérir du coup !
— Non. Il va mourir, au contraire. À ce propos, Ludo Garel, il vous sera permis de voir la séparation de l’âme d’avec le corps. C’est une chose, je le sais, que vous désirez voir depuis longtemps.
— Vous l’ai-je dit ! s’exclama Ludo qui se demanda, un peu tard, s’il n’avait pas trop bavardé au long de la route.
— Vous ne me l’avez pas dit. Mais Celui qui m’a envoyé à votre secours vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même.
— Et je pourrai voir la séparation de l’âme d’avec le corps ?
— Vous la verrez. Votre maître trépassera tantôt, sur les dix heures, dix heures et demie. Comme on croira que vous êtes allé jusqu’à Rennes et que vous en êtes revenu (car vous ne soufflerez mot de notre rencontre), on insistera pour que vous preniez du repos. Mais refusez de vous coucher. Restez au chevet du comte, et ne quittez pas des yeux sa figure. Quand il sera mort, vous verrez son âme s’échapper de ses lèvres sous la forme d’une souris blanche. Cette souris disparaîtra aussitôt dans quelque trou. Vous ne vous en soucierez point. Par exemple, vous ne laisserez à personne le soin d’aller quérir la croix funéraire à l’église du bourg. Vous irez vous-même. Arrivé sous le porche, vous attendrez que la souris vous ait rejoint. N’entrez pas à l’église avant elle. Contentez-vous toujours de la suivre. C’est essentiel. Si vous vous conformez strictement à mes recommandations, vous saurez avant ce soir ce que vous aspirez tant à connaître. Et maintenant, Ludo Garel adieu !
Sur ce, l’étrange personnage s’évanouit en une vapeur légère, vite confondue avec celles qui montaient du sol humide, dans le jour naissant.
Ludo Garel s’en revint au Quinquiz.
— Dieu soit loué ! dit le maître en voyant entrer son domestique. Tu as eu raison, brave serviteur, de faire diligence. Je suis au plus bas. Si tu avais tardé d’une demi-heure, tu n’aurais guère trouvé qu’un cadavre. Comment cela a-t-il marché, à Rennes ?
— Vous avez gagné votre procès.
— Je t’en sais bon gré, mon ami. Grâce à toi, je puis mourir tranquille.
Cette fois, Ludo Garel ne tenta point de réconforter son maître par des paroles d’espérance. Il savait que la destinée[117] doit s’accomplir. Il alla tristement se placer à la tête du lit, de façon néanmoins à ne jamais perdre de vue le visage du comte. La salle était pleine de gens en larmes. La comtesse prit Ludo par le bras et lui dit à l’oreille :
— Vous êtes harassé de fatigue. Il ne manque pas ici de monde pour veiller mon pauvre mari. Allez dormir.
— Mon devoir, répondit le domestique, est de rester au chevet de mon maître jusqu’au dernier moment.
Et il resta, malgré toutes les instances.
Dix heures sonnèrent. Ainsi qu’avait prédit l’inconnu, le seigneur du Quinquiz entra en agonie. Une vieille femme entonna les « grâces. » L’assistance murmura les répons. Ludo Garel mêla sa voix à celles des autres, mais sa pensée n’était pas à la prière qu’il marmottait. Elle était toute tendue vers ce qui se passerait tout à l’heure, au moment de la séparation de l’âme d’avec le corps.
Le comte, cependant, commençait à balancer la tête de droite et de gauche, sur le traversin. C’est qu’il entendait venir la mort, sans savoir encore de quelle direction.
Tout à coup il se raidit. La mort l’avait touché.
Il poussa un long soupir, et Ludo vit son âme s’exhaler de ses lèvres sous la forme d’une souris blanche.
L’homme du cimetière avait dit vrai.
La souris ne fit d’ailleurs que paraître et disparaître.
La vieille femme qui avait entonné les « grâces » entreprit le De profundis. Ludo profita, pour s’esquiver, de l’émotion causée par la fin dernière du comte. Et de trotter, par un sentier de traverse, jusqu’au bourg. L’ordre n’était pas encore donné, au Quinquiz, d’aller quérir la croix funéraire, qu’il était déjà sous le porche de l’église. La souris blanche y arrivait presque en même temps que lui. Il la laissa pénétrer la première dans la nef. Elle se mit à trottiner vite et menu. Mais lui, faisait de grandes enjambées, et il put ainsi la suivre, sans trop de peine. Trois fois, il fit derrière elle le tour de l’église. Le troisième tour terminé, elle sortit de nouveau par le porche. Ludo se précipita sur ses traces, tenant embrassée sur sa poitrine la croix funéraire qu’il avait enlevée au passage. Les sonnailles de la croix tintaient, tintaient, et la souris détalait, détalait. La souris, la croix et Ludo qui la portait parcoururent ensemble tous les champs du Quinquiz. La petite bête blanche sautait par-dessus chaque barrière, comme le maître avait coutume de faire, de son vivant, puis longeait les quatre fossés.
Une fois fini le tour des champs, elle reprit la direction du manoir. Arrivée dans l’aire, elle s’achemina vers un bâtiment isolé où l’on enfermait les instruments de labour. Sur tous elle posa les pattes[118]. Charrues, hoyaux, bêches, à tous elle dit adieu.
De là, elle regagna la maison.
Ludo la vit grimper sur le cadavre et se laisser mettre avec lui dans le cercueil.
Le clergé vint chercher le corps. La messe d’enterrement fut chantée ; le cercueil fut descendu dans la fosse. Mais dès que le prêtre célébrant l’eut aspergé d’eau bénite, dès que les proches parents eurent jeté dessus les premières mottes de terre, Ludo en vit sortir derechef la souris blanche.
Le jeune homme inconnu lui avait expressément recommandé de la suivre jusqu’au bout, fut-ce par ronce, épine ou fondrière.
Le voilà donc de planter là l’enterrement et de se remettre à pèleriner derrière la souris.
Ils traversèrent des bois, franchirent des marais, escaladèrent des fossés, passèrent des bourgs, tant et si bien qu’ils aboutirent à une vaste lande au milieu de laquelle se dressait le tronc à demi desséché d’un arbre. Il était si vieux, si pelé, qu’on n’aurait su dire si c’était un tronc de hêtre ou de châtaignier. L’intérieur en était creux. Vraiment, il ne se maintenait debout que par miracle. Encore sa maigre écorce était-elle fendue de haut en bas. La souris se glissa dans une de ces fentes, et Ludo vit aussitôt apparaître le seigneur du Quinquiz dans le creux de l’arbre.
— Ô mon pauvre maître, s’écria-t-il, les mains jointes, que faites-vous ici ?
— Tout homme, mon cher Ludo, doit faire sa pénitence à l’endroit que Dieu lui assigne.
— Puis-je au moins vous venir en aide de quelque façon ?
— Oui, tu le peux.
— Comment ?
— En jeûnant pour moi, l’espace d’un an et un jour. Si tu le fais, je serai délivré pour jamais, et ta béatitude suivra de près la mienne.
— Je le ferai, répondit Ludo Garel.
Il tint promesse. Son jeûne accompli, il mourut.
Photo : DR
[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.
Breizh-info.com, 2026, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine.