Alors que l’Éducation nationale prévoit d’imposer sans le consentement des parents (signe d’une tyrannie qui ne dit pas son nom) dès la rentrée 2025 le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) dans les écoles, une enquête de l’INED révèle que la pornographie n’est pas la première source d’information des jeunes adultes sur la sexualité. Loin des caricatures médiatiques, ce sont les pairs et les professionnels qui tiennent le haut du pavé.
Famille, amis, soignants : les piliers de la transmission
L’étude ENVIE, menée en 2023 auprès de plus de 10 000 jeunes de 18 à 29 ans, remet les pendules à l’heure : 9 jeunes sur 10 affirment avoir reçu leurs premières informations sur la sexualité via leurs partenaires, 8 sur 10 via leurs amis. Viennent ensuite les professionnels de santé ou du milieu éducatif, notamment auprès des jeunes femmes, plus souvent suivies médicalement (gynécologie, contraception).
Loin de l’image du jeune isolé face à son écran, les relations affectives, amicales et familiales jouent encore un rôle structurant. Les sœurs, les mères, les amies sont largement citées comme sources fiables par les femmes. Les hommes se tournent plus vers leurs frères ou leurs partenaires. Preuve que la sexualité, loin d’être un tabou dans la sphère privée, s’inscrit d’abord dans une logique de proximité et de confiance.
Réseaux sociaux et pornographie : un rôle, mais pas central
Internet, bien entendu, n’est pas absent de cette cartographie. Mais son rôle est à nuancer. Les jeunes citent d’abord les fictions (films, séries, documentaires) puis les réseaux sociaux comme sources d’information numérique. La pornographie, souvent accusée d’être l’unique école sexuelle des jeunes, n’arrive qu’ensuite — et surtout chez les garçons.
Les jeunes hommes sont 85 % à avoir visionné du contenu pornographique dans les 12 derniers mois (contre 43 % des jeunes femmes), ce qui explique en partie qu’ils soient plus nombreux à le considérer comme une source d’information. Mais il s’agit moins d’un manuel éducatif que d’un support d’excitation précoce, souvent lié aux premières masturbations ou fantasmes adolescents.
Derrière la diversité apparente des sources d’information se cachent des fractures sociales tenaces. Les jeunes issus de milieux favorisés (parents cadres) accèdent en moyenne à plus de quatre sources différentes sur la sexualité. À l’inverse, ceux des milieux populaires ont un accès plus restreint, tant en quantité qu’en qualité.
Ce déficit de ressources influe directement sur la capacité à dialoguer avec un partenaire sur la contraception, les IST ou le consentement. Là encore, l’inégalité d’accès à la connaissance fabrique de l’inégalité dans les pratiques, dans les protections, dans les droits.
L’école, acteur secondaire mais incontournable
Dans ce contexte, l’école est appelée à jouer un rôle clé. Non pas pour se substituer à la famille ou aux proches, mais pour garantir à tous un socle de connaissances scientifiques, neutres, et adaptées à l’âge des élèves.
L’étude souligne que l’éducation à la sexualité permettrait de prévenir plus efficacement les violences sexuelles, les grossesses non désirées, et les IST. Encore faut-il que cette éducation ne verse pas dans l’idéologie ou l’endoctrinement, mais reste centrée sur la santé, le respect et la responsabilité.
Loin des fantasmes médiatiques ou des caricatures militantes, il semblerait que les jeunes adultes français s’informent d’abord par les autres – amis, familles, professionnels. Si Internet est omniprésent, il ne s’y substitue pas. C’est dans la combinaison des sources, dans la diversité des voix, que se construit une culture affective et sexuelle plus saine, plus lucide, plus libre. Reste à garantir que tous y aient accès, sans condition sociale ni pression idéologique.











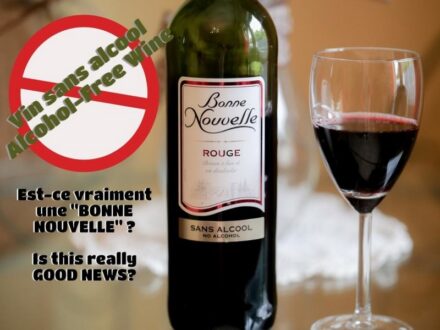


2 réponses à “Sexualité : ce que les jeunes apprennent… et à qui ils font confiance”
Il existe une source non citée ici: les ouvrages y afférant.
Le couple et l’amour
des ouvrages d’éducation sexuelle gradués en fonction de l’âge avec des versions différentes selon l’âge du lecteur.
Cela permettrait un contôle plus aisé car difficile de contrôler la transmission orale enseignante.
L’Amour platonique, idéalisé est extrèmement puissant au point que trop souvent il paralyse la communication entre les êtres aimés, une fois le cap franchi du « silence qui tue » et bien plus encore d’un contact physique ne serait-ce que tenir la main, l’effet devient fulgurant et dès lors la passion emporte tout jusqu’à la sexualité.
Et c’est là que la citation de Sénèque prend tout son sens: « Est-ce que c’est parce que c’est difficile que je n’ose pas, ou est-ce que c’est parce que je n’ose pas que c’est difficile. »