Depuis trois décennies, l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) vit au rythme des massacres, des viols et des déplacements massifs de populations. Plus de dix millions de morts en trente ans, une région mise à feu et à sang dans l’indifférence générale : tel est le bilan de la guerre du Kivu. Un conflit qui n’est pas seulement ethnique ou régional, mais directement lié à l’exploitation de ressources stratégiques.
Le M23, bras armé de Kigali
Le dernier épisode marquant s’est joué en janvier dernier, lorsque les combattants du Mouvement du 23 mars (M23), appuyés par plusieurs milliers de soldats rwandais, se sont emparés de Goma, capitale du Nord-Kivu. Une ville d’un million d’habitants située au cœur d’une zone qui concentre coltan, étain, tungstène et or, ces « minerais de sang » indispensables à la fabrication des smartphones et de nombreux équipements électroniques.
En prenant le contrôle de zones minières clés comme Rubaya, qui fournit à elle seule 15 % du coltan mondial, le M23 impose taxes et prélèvements, finançant son effort de guerre grâce à une économie militarisée. Selon l’ONU, ce système rapporterait près de 800 000 dollars par mois au groupe rebelle.
Depuis la première guerre du Congo en 1996, ces ressources ont alimenté une véritable économie de guerre. La rente minière nourrit la corruption, enrichit les élites locales et régionales, et entretient l’instabilité. Le Rwanda, qui sert de plaque tournante pour l’exportation, joue un rôle central dans ce pillage, avec la complicité tacite d’autres États de la région, comme l’Ouganda.
Mais Kinshasa n’est pas exempt de responsabilités : éloignée de plus de 2 000 kilomètres du Kivu, la capitale peine à exercer son autorité sur cette région frontalière où l’État est largement absent.
Catastrophe humaine et écologique
Le prix de cette guerre est vertigineux. Des millions de morts, plus de 7 millions de déplacés internes, près de 4 millions de réfugiés et une malnutrition endémique qui touche 30 millions de Congolais. Le viol est utilisé comme arme de guerre, la population vit sous la menace constante de groupes armés, et les jeunes sont enrôlés de force.
À ces drames humains s’ajoute une destruction écologique massive. Les terres fertiles sont ravagées par les exploitations minières, les rivières et nappes phréatiques sont polluées aux métaux lourds, et certaines zones ont vu disparaître toute vie aquatique. Le Bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète, est amputé par la déforestation et la chasse des espèces protégées.
La demande mondiale en minerais critiques nourrit directement ce désastre. Sans coltan, pas de condensateurs pour smartphones ; sans étain, pas de soudures électroniques ; sans tungstène, pas de haut-parleurs ; sans or, pas de cartes mères. L’industrie numérique siphonne à elle seule une part considérable de cette production.
De longue date, les grandes entreprises occidentales sont accusées d’alimenter le conflit. Déjà en 2019, une action collective visait Apple, Microsoft, Tesla, Google et Dell, accusées de profiter du travail d’enfants dans les mines congolaises. En 2016, Amnesty International dénonçait les mêmes pratiques. La production de masse de la Playstation 2 de Sony, au tournant des années 2000, avait même provoqué une flambée du coltan et une ruée vers les mines congolaises, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales.
Le scandale ne se limite pas aux multinationales. Les États occidentaux eux-mêmes soutiennent ces pratiques sous couvert de sécuriser leurs approvisionnements. En février dernier, Bruxelles et Kigali ont signé un accord pour un approvisionnement « durable » en minerais critiques. Une hypocrisie flagrante, puisque 90 % des minerais exportés par le Rwanda proviennent en réalité du sol congolais.
Avec ses millions de victimes et sa dimension géopolitique, la guerre du Kivu est sans doute la plus grande tuerie civile du XXIe siècle. Pourtant, elle demeure largement ignorée par les opinions publiques occidentales, davantage focalisées sur d’autres conflits médiatisés. Le reportage Mines de sang de la chaîne Omerta brise ce silence en rappelant une vérité dérangeante : derrière chaque smartphone, chaque ordinateur ou chaque console de jeux, il y a peut-être un peu de sang congolais.




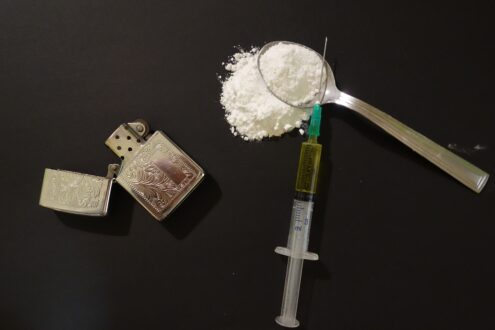









5 réponses à “Congo : Reportage d’Omerta sur les « mines de sang » qui alimentent la guerre du Kivu”
mais on ne parle que de la Palestine…
Excellent reportage sur un sujet qui doit rester dans l’ombre car , sans doute, il y a trop d’intérêts financiers en jeux. Mais comme d’habitude c’est le petit peuple qui trinque.
Ou de l’Ukraine …
Le Congo n intéresse personne , les morts là-bas ne valent rien aux yeux des bonnes âmes de la conscience humaine que sont nos gauchistes nationaux , ces victimes n ont qu’un seul tort leurs tortionnaires ne sont pas Juif , il ne viennent pas d Israel pays qui est l exemple de tous les vilénies possibles et imaginables !
Pendant que l on veut interdire de toute compétition possible l état d Israel , les championnats du monde de cyclisme se déroule a Kigali la capitale du Rwanda , cherchez l erreur !!!
ils ne sont pas de « bonnes victimes » donc les zélites européistes, les féministes s’en contrefichent