Il y a des guerres qu’il ne faut pas perdre. Celle que le Mexique a livré aux États-Unis en 1846 en est une. Car si la paix de Guadalupe Hidalgo, signée deux ans plus tard, fut pour les Mexicains une humiliation cruelle, elle fut surtout une sanction historique de leur hubris. Le désir d’être empire, en se séparant de la couronne espagnole, s’était retourné contre eux comme un cheval ombrageux. De cette défaite naquit la Californie moderne, arrachée au monde hispanique pour être livrée à la loi des pionniers anglophones et à la rapacité mercantile.
Et pourtant, qui se souvient que San Francisco ne fut point fondée par des pionniers yankees à bretelles, mais par une colonne espagnole partie en 1775 du Mexique, conduite par le capitaine Juan Bautista de Anza, homme de cheval et de foi, missionné par la Couronne pour étendre vers le nord l’autorité de l’Empire ? Traversant déserts, sierras et broussailles avec cent soldats, femmes, enfants, bétail, charriots et croix, cette expédition atteignit en mars 1776 la baie alors inhabitée que les Espagnols baptisèrent « San Francisco », du nom du saint d’Assise. Ils y fondèrent un presidio et une mission, établissant l’autorité castillane à l’extrême pointe du Pacifique. Les maisons étaient d’adobe, les chants en latin, et les cloches venaient de Sinaloa. C’étaient des Mexicains, certes, mais dans la langue, la foi et le droit, ils étaient encore Espagnols.
Et qui se souvient encore que Los Angeles, la mégalopole tentaculaire des mirages hollywoodiens, fut d’abord un petit pueblo fondé le 4 septembre 1781 sous le nom de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula ? Ce ne furent ni des promoteurs californiens, ni des prospecteurs d’or qui tracèrent ses premiers chemins, mais onze familles mexicaines, gens de peu, venus de Sinaloa et de Sonora, conduites par le gouverneur Felipe de Neve, agissant sous les directives de Théodore de Croix, serviteur zélé de la Couronne espagnole. Ce Flamand d’Amérique, catholique austère au front large, administra la province de Californie comme un bout de Flandre impériale, traçant les rues, répartissant les lots, ordonnant les cultures. Il fut secondé par un franciscain, le père Junípero Serra, autre figure fondatrice de cet ordre missionnaire qui, tout au long de la côte pacifique, érigea un chapelet de vingt et une missions, de San Diego à Sonoma. À Los Angeles, point d’or, point de pétrole, point de célébrité encore, seulement des champs, des orangers, des chevaux et des cloches. Le monde hispanique y régnait par la charrue, la croix et l’ordre des castes. Le peuple y parlait espagnol, priait en latin, et vivait sous les édits du roi Charles III.
La Californie, qui s’enorgueillit d’être le laboratoire d’une société inclusive, repose en vérité sur une base servile. Pas un secteur n’échappe à cette règle : agriculture, construction, restauration, soins à domicile, ramassage d’ordures, entretien des piscines et des jardins, distribution alimentaire. Un récent rapport du Financial Times est éloquent : près de 65 % des travailleurs agricoles sont des immigrés, dont plus d’un quart en situation irrégulière. Dans le centre maraîcher d’Oxnard, après les descentes musclées d’ICE, les champs sont vides, les semis abandonnés, les fraises fanées sur pied.
Ce modèle a un nom : esclavage moderne. Les patrons de la Californie, si prompts à financer des campagnes contre le patriarcat ou pour la diversité, tolèrent sans broncher que des milliers de Mario, de Carmen ou d’Irene triment du dimanche au dimanche pour des salaires de misère, sans droits ni assurance. On les acclame comme «travailleurs cruciaux» quand souffle la pandémie, on les traque comme des clandestins quand revient le beau temps. On les veut discrets, efficaces, invisibles. C’est le secret honteux de la Californie progressiste.
Et ce secret a un prix, payé non en billets verts, mais en stagnation déguisée. Car ce recours massif à une main-d’œuvre bon marché, malléable, souvent clandestine, agit comme un verrou sur l’innovation. Pourquoi investir dans des récolteuses automatisées quand il suffit de faire plier l’échine à une armée de journaliers mexicains, dociles, remplaçables, invisibles ? Pourquoi concevoir des bâtiments durables, repenser les matériaux ou optimiser l’énergie, lorsque des escouades de maçons sans statut, robustes et silencieux, coulent le béton à la chaîne, sans poser de question ni signer de contrat ? La Californie, matrice du monde numérique, s’interdit elle-même de grandir. Elle cède à cette forme de paresse orgueilleuse propre aux empires finissants. Spengler l’avait pressenti : les civilisations refusent parfois leur propre mort en la déléguant à d’autres, en sacrifiant une humanité périphérique pour prolonger un rêve central. La Californie, elle, prolonge son chant du progrès sur des reins d’emprunt.
Et voilà que la mécanique s’enraye. Trump, l’homme que toute la Californie aime haïr, renvoie la première pelletée sur ce bel échafaudage. Il déploie la Garde nationale, arrête, expulse, menace. Et la machine s’arrête. Les prix grimpent, les vendanges n’ont pas lieu, les reconstructions post-incendies sont paralysées faute de bras. Les classes moyennes délocalisent. Les employeurs s’affolent. Le système vacille. L’économie californienne pourrait perdre jusqu’à 275 milliards de dollars par an. Et l’on crie au fascisme.
Ceux-là mêmes qui imposaient au reste du pays une morale sévère sur les droits humains découvrent que leur propre confort repose sur la soumission d’une population que l’on n’ose ni régulariser, ni expulser, ni remplacer. Ce modèle, pourtant, n’est pas unique. Il est le jumeau de tant de systèmes de domination historiques. Il a sa rhétorique, sa logique, sa brutalité. Il aura, comme les autres, sa fin.
Alors, plutôt que de gémir sur les raids d’ICE, les Californiens pourraient tenter de redéfinir un modèle économique qui ne repose pas sur l’exploitation cynique des miséreux. Ils pourraient réapprendre à produire, à payer, à rémunérer à leur juste prix les travailleurs de la terre et du bâtiment. Et peut-être, alors, retrouveraient-ils une dignité perdue.
Car les guerres ont des conséquences. Celle de 1848 a fait perdre au Mexique la Californie. Celle de la morale contre le réel pourrait bien faire perdre à la Californie son âme.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine




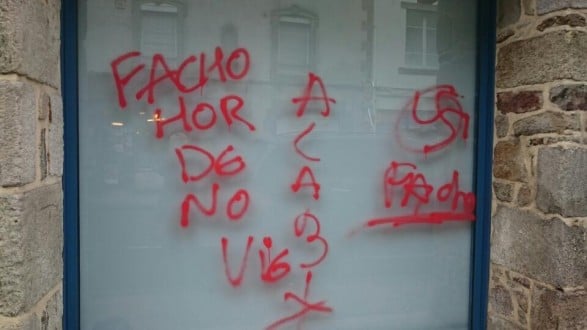

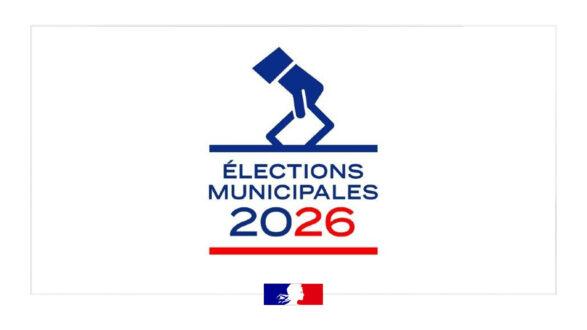






2 réponses à “La Californie ou l’hypocrisie radieuse”
J’adore vos articles, ils sont vraiment excellents !
Merci !