Le 25 septembre 2025, la Commission relative au droit à la santé de l’Assemblée nationale équatorienne a approuvé un rapport historique en vue de la première lecture de la loi sur la « reproduction humaine assistée ». Alors que le texte initial envisageait d’autoriser la gestation pour autrui (GPA), les parlementaires ont finalement retenu une position claire : interdire la pratique sur le territoire.
Une bascule politique sous l’influence de la société civile
La décision n’est pas sortie de nulle part. Elle résulte d’un travail conjoint entre l’association équatorienne Dignidad y Derecho, engagée dans la défense de l’État de droit et des droits fondamentaux, et la Déclaration de Casablanca, coalition internationale rassemblant plus de 150 experts et organisations. Tous militent pour l’abolition universelle de la GPA, dénoncée comme une marchandisation du corps des femmes.
Leur action a pesé dans le processus législatif : en septembre, les deux organisations ont présenté aux députés équatoriens un rapport de la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes, Reem Alsalem, mettant en lumière les atteintes liées à la gestation pour autrui.
Durant plusieurs jours, Quito et Guayaquil ont accueilli conférences, débats et auditions. À l’Université Hemisferios, en présence du vice-président Victor Manuel Valle, les impacts sociaux et juridiques de la GPA ont été discutés devant un large public. À l’Université San Francisco de Quito, jeunes et leaders d’opinion se sont confrontés au sujet dans une salle comble.
Le Dr Bernard García Larraín, directeur exécutif de la Déclaration de Casablanca, a multiplié les interventions, du forum de l’Assemblée nationale aux rencontres avec la société civile et les médias locaux. L’objectif : rappeler les dérives constatées à l’international et la nécessité d’un cadre clair pour protéger les femmes et les enfants.
La GPA assimilée à une violence
Dans son rapport, la Commission équatorienne a explicitement qualifié la gestation pour autrui de violence faite aux femmes et aux filles. L’argumentaire s’appuie à la fois sur les atteintes physiques et psychologiques subies par les mères porteuses, et sur les risques de dérives commerciales qui transforment la maternité en prestation contractuelle.
Cette reconnaissance marque une étape importante : l’Équateur s’aligne ainsi sur les recommandations de la Déclaration de Casablanca, qui appelle les États à interdire la GPA, refuser toute validité juridique aux contrats de gestation, et poursuivre les intermédiaires comme les commanditaires.
Le vote de la Commission ne constitue qu’une étape : le projet doit encore être débattu et voté en séance plénière de l’Assemblée nationale. Mais le signal politique est fort. Dans un contexte où certains pays occidentaux relancent le débat autour d’une prétendue « GPA éthique », l’Équateur choisit une autre voie, celle de la prohibition explicite.
Les promoteurs de l’interdiction estiment qu’il s’agit d’une question de dignité humaine, de protection des plus vulnérables et de cohérence bioéthique. « La gestation pour autrui n’est pas une solution médicale, mais un marché », martèlent les défenseurs de cette ligne, qui espèrent voir d’autres nations suivre l’exemple équatorien.
Alors que le débat refait surface en France, certains milieux politiques et associatifs invoquant la possibilité d’une « GPA éthique », la décision équatorienne fait figure de contrepoint. Pour ses opposants, cette notion n’est qu’une tromperie sémantique destinée à masquer une réalité : celle d’un contrat où le corps de la femme est instrumentalisé.
Reste à savoir si le législateur français acceptera de regarder du côté de Quito, où l’Assemblée nationale est en passe d’inscrire dans le marbre ce que beaucoup considèrent déjà comme une évidence : la maternité ne se loue pas.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..



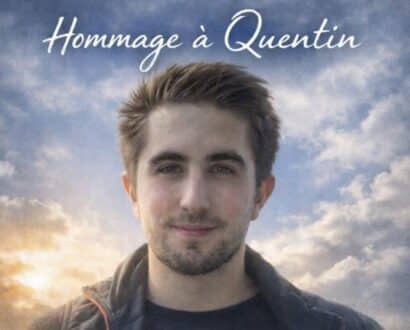
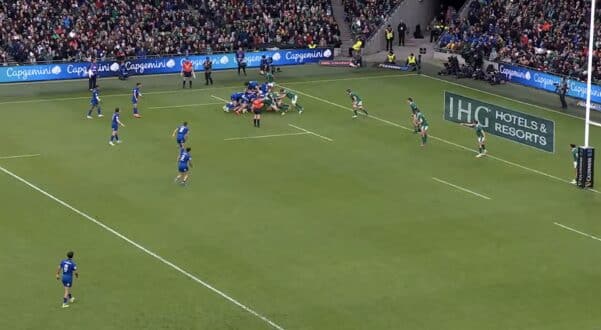

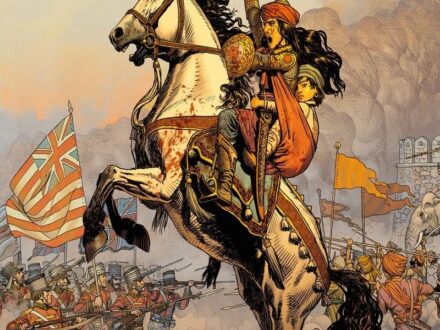



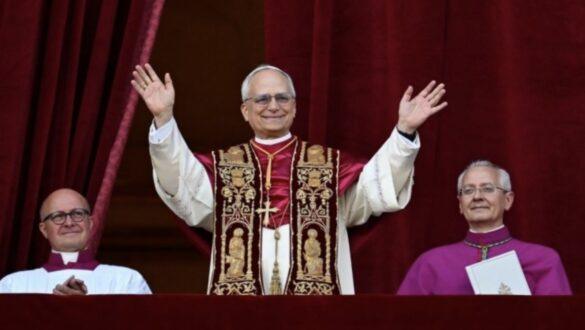


Une réponse à “Équateur. Vers l’interdiction de la GPA, reconnue comme une violence contre les femmes”
la vente d’enfants, comme un vulgaire article, l’interdiction de la location d’utérus d’une pauvresse, voilà des parlementaires humains et non boutiquiers